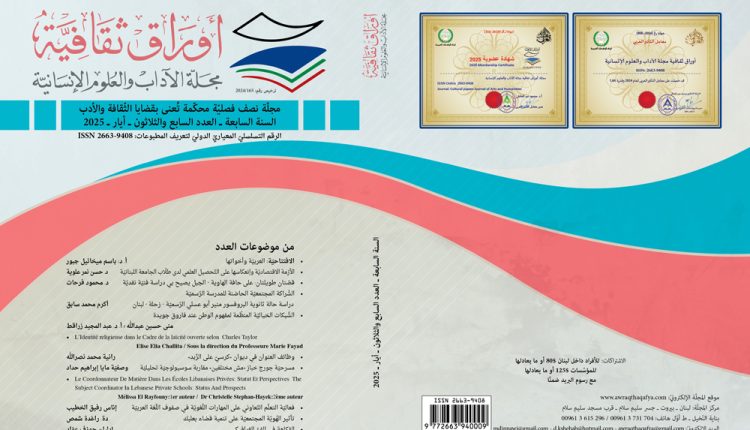عنوان البحث: L'Identité religieuse dans le Cadre de la laïcité ouverte selon Charles Taylor
اسم الكاتب: Elise Elia Challita, Professeure Marie Fayad
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013715
L’Identité religieuse dans le Cadre de la laïcité ouverte selon
Charles Taylor
الهُويّة الدّينيّة في إطار “العلمانيّة المنفتحة تشارلز تايلور “
([1]) Elise Elia Challita أليز إيليا شليطا
[2]Sous la direction du Professeure Marie Fayad إشراف: البروفسور ماري فياض
تاريخ الإرسال:18-4-2025 تاريخ القبول:25-4-2025
Résumé – abstract turnitin: 7%
Cette contribution s’attache à explorer la place de l’identité religieuse au sein de la laïcité ouverte, en s’interrogeant sur la nécessité de reconnaître la diversité culturelle des citoyens. L’étude met en lumière la différence entre deux modèles types de laïcité et opte pour le modèle élastique ouvert vis-à-vis de la diversité culturelle et religieuse. Il s’agit notamment de montrer comment la liberté de la conscience prime sur la neutralité aveugle de l’Etat républicain laïc. Cette réflexion s’inscrit dans une démarche visant à réévaluer les conditions de possibilité d’un vivre-ensemble démocratique positif.
Mots clés: l’identité religieuse; le pluralisme culturel; la sécularité; la laïcité républicaine; la laïcité ouverte; la neutralité de l’Etat; l’accommodement raisonnable.
الملخّص
تسعى هذه المساهمة إلى استكشاف مكان الهّويّة الدّينيّة داخل العلمانيّة المفتوحة، من خلال التّساؤل حول الحاجة إلى الاعتراف بالتّنوع الثقافي للمواطنين. تسلط الدّراسة الضوء على الفرق بين النموذجين التقليديين للعلمانيّة، وتختار النموذج المرن المنفتح على التنوع الثّقافي والدّيني. ويتضمن ذلك إظهار كيف أن حرية الضمير لها الأولوية على الحياد الأعمى للدولة الجمهورية العلمانية. يشكل هذا التأمل جزءًا من نهج يهدف إلى إعادة تقييم ظروف إمكانية العيش المشترك الديمقراطي الإيجابي..
الكلمات المفتاحيّة: الهُوية الدّينيّة؛ التّعدّدية الثقافيّة؛ العلمانيّة؛ العلمانيّة الجمهوريّة؛ العلمانيّة المفتوحة؛ حياد الدولة؛ سكن معقول.
Introduction
La délibération autour de “l’identité” paraît présenter un intérêt remarquable. Cette recherche sur ce qu’est l’identité et la quête d’une précision sur l’interrogation “qui suis-je ?”, se transforme en un point important dans nos discours quotidiens. À vrai dire, la modernité valorise les choix individuels, le parcours personnel et la capacité de l’individu à façonner sa propre identité. Dans cette optique de valorisation des choix individuels, la modernité se présente comme un terrain propice à la pluri-culturalité des choix. Sur le plan socio-politique, cette diversité culturelle pose un défi majeur aux systèmes de gouvernances.
Dans cette ligne de pensée qui vise à réconcilier tous ces enjeux, Taylor braque les lumières dans sa philosophie sur la relation entre l’identité et le besoin de la reconnaissance. En effet, il argumente que l’idéal d’authenticité continu à façonner notre image de soi à l’époque moderne. Les répercussions de cet idéal seront propices, d’une façon consciente ou inconsciente, à l’application des politiques visant la reconnaissance de notre originalité sur le plan social.
En effet, la philosophie politique contemporaine est aux prises avec la question du “vivre ensemble” positif. Ce dernier noue ses enjeux autour de deux polarisations nécessaires à son aboutissement:
- a) La réalisation authentique du soi tant au niveau personnel que social.
- b) La reconnaissance de cette originalité, donc la concrétisation de l’idéal d’authenticité sur le plan social.
Taylor estime que la laïcité, surtout le modèle ouvert – reconnaissant, offre un moyen idéal pour garantir la liberté de l’expression (la liberté de conscience) des individus et la reconnaissance des valeurs particulières dans l’espace public. Il s’engage, dans ses œuvres autour de la laïcité, à montrer que la laïcité n’est pas une donnée figée. La laïcité conçue comme élastique dans la perspective de Taylor, doit garantir des fins plus estimables que la seule exigence de la neutralité de l’Etat face à la diversité culturelle. Selon lui, la finalité morale de la laïcité demeure, essentiellement, dans son effort de préserver la liberté de conscience de l’individu. Cette attention, portée sur la finalité morale de la laïcité, conduit Taylor à distinguer et à opposer deux idéaux types de la laïcité: “le modèle républicain” et “le modèle ouvert –reconnaissant”. L’Etat, selon les exigences du modèle républicain doit se montrer neutre vis-à-vis des revendications identitaires des citoyens. Tandis que, l’Etat laïc ouvert reconnaît la particularité religieuse et culturelle des communautés. Il permet ainsi, l’expression de cette particularité dans la sphère publique. Ce projet politique avancé par Taylor, se fonde sur une prémisse ontologique qui conçoit l’individu enraciné dans sa communauté et dépendant d’elle.
Cette approche ontologique, qui met en relief la relation nécessaire entre l’individu et sa religion, met en évidence que la non-reconnaissance des identités culturelles cause le repli sur soi et engendre des conflits violents. La non-reconnaissance est en fait une injustice sociale qui enfante le ressentiment et la haine. Selon Taylor, la vraie priorité des décideurs politiques serait la lutte contre “le recrutement des jeunes par des tueurs, par des fanatiques”. La laïcité ouverte se présente ainsi comme un moyen pour corriger les injustices sociales et prévenir le terrorisme.
Notre problématique est la suivante:
L’identité individuelle qui est, selon Taylor, dépendante de sa communauté, réclame la reconnaissance de la particularité de ses choix individuels et la reconnaissance de sa tradition dans l’espace public. Mais, toute tradition est susceptible de se présenter comme un espace favorisant l’isolement et la rupture, au moins, avec les autres qui ne partagent pas les mêmes normes traditionnelles. Cette rupture, qui s’exprime par un refus de participer à la vie sociale commune, favorise une attitude méfiante vis-à-vis de ce qui est diffèrent, un repli radical sur les normes culturelles de la communauté et une attitude méfiante vis-à-vis de la différence. Dans ce sens, les valeurs culturelles limitent souvent la participation à la vie sociale et conduisent à la fragmentation de la société sous l’effet de la diversité culturelle. Or, Taylor admet une ouverture, par le biais de la laïcité ouverte, sur cet espace clos que représente “l’horizon moral ” et culturel des communautés pour assurer l’intégration des communautés dans l’espace public. La reconnaissance de la diversité culturelle devient, selon lui, une obligation afin d’assurer un vivre ensemble positif. Ainsi, maintes questions s’imposent: comment l’individu se définit-il aujourd’hui ? Dans quelle mesure l’identité religieuse est-elle formatrice de l’individu ? comment nuancer entre ” sécularisme ” et “la laïcité” ? Et enfin, comment la “laïcité ouverte” se présente-t-elle comme un moyen qui garantit la dignité de l’homme ?
1.La Place de la Religion dans la Formation de l’Identité
La religion est l’ensemble des croyances et des pratiques que l’individu et certaines institutions adoptent. Pour Taylor, le point marqueur de la croyance religieuse est que la religion offre généralement un arrière-plan de croyances qui transcendent la vie humaine. Durant des siècles, la croyance en une puissance transcendante de la vie humaine a forgé et a organisé les structures politiques et l’unité de la société (Baubérot & Milot, 2011). Pourtant, pour certains, la modernité marque une tendance nouvelle qui consiste à concevoir l’organisation sociale et la politique sans rattachement à la foi (Tayor, 2011). Selon Taylor, ce “retrait” de la religion au niveau de “l’imaginaire social”[3], s’explique par l’avènement des nouvelles transformations, entres autres: l’émergence d’un “idéal social” moderne qui a créé une conception d’une identité isolée et d’un moi qui doit suivre librement ses choix “authentiques”. Taylor retrace la genèse de la transformation de ces idéaux en focalisant sa recherche sur la relocalisation du “sens religieux” qui se passe, aux temps modernes, à l’intérieur du sujet. Ainsi, Taylor vise à réviser les: “voies par lesquelles nous sommes passés sur cinq siècles d’un monde religieux à un monde séculier.” (Gauchet, 2014, p. 38). En effet, Taylor explicite une thèse qui sous-tend que la modernité ne va pas de pair avec la disparition de la religion, mais transforme notre sens religieux. À ce sujet, dans l’un de ses entretiens intitulé Le Pluralisme religieux, Taylor déclare que: “la religion ne disparaît pas ; elle se transforme”. (Taylor, 2010).
La modernité qui, selon Taylor, limite toute connaissance sous un modèle scientifique, place la vérité dans la nature seule ou à l’intérieur du sujet, niant alors tout recours aux notions transcendantales. Le recours à la transcendance n’est plus un choix viable dans la modernité. L’accent est plutôt mis sur la valorisation de “l’humain en soi” et sur le progrès scientifique. Cette “distinction transcendant/ immanent” (Taylor, 2011, p. 37), ouvre la voie de l’interprétation de la religion grâce à “une stratégie prudente” (Taylor, 2011, p. 37), élaborée par Taylor dans l’Âge Séculier. Par cette stratégie, ce philosophe tient à montrer que la religion, au moins dans son but initial qui est la recherche de la plénitude spirituelle, est encore bien présente dans la modernité, mais sous une nouvelle version. En effet, le rapport entre l’identité religieuse et l’intégration dans la société, se concrétise par la conception du sujet humain qui, selon Taylor, cherche à se définir socialement en établissant “les termes de son rapport à lui- même” (Gauchet, 1998, p. 122); de vivre et d’exprimer son authenticité dans la sphère publique. Dans ce sens, les croyances surtout religieuses, se transforment et “se muent en identités” (Gauchet, 1998, p. 121).
La religion ne se limite pas aux pratiques religieuses, mais s’avère beaucoup plus importante et constitutive pour l’identité. D’ailleurs, l’identité religieuse se place à l’intersection des deux pôles: le social et le privé. La place que notre identité religieuse occupe, ne se limite pas à l’intimité de notre vécu personnel, elle se manifeste en expansion dans la sphère publique. Cet enjeu avance un nouveau débat politico- philosophique qui porte sur une révision de l’interaction entre l’espace public et de l’espace intime, et sur les liens qu’entretiennent ces deux espaces. Dans ce contexte, les croyances qui constituent pour Taylor les “horizons de significations indispensables”, jouent un rôle important dans la formation de l’identité. Elles se révèlent de notre fort intérieur, constituent notre héritage culturel et forment une façon authentique d’exister. Afin d’entrer en relation avec autrui, et “pour nouer un dialogue ; elles deviennent ce sur la base de quoi l’échange s’établit.” (Gauchet, 1998, p. 121). Le but de Taylor est de signaler que malgré le “retrait” de la pratique religieuse et la montée de l’athéisme en occident, l’expérience de la plénitude spirituelle et de son importance pour chaque individu, demeure une cause première dans l’affirmation de l’identité. Il n’oublie pas pourtant, de signer que le besoin de l’expérience de la plénitude que ressent l’individu moderne peut parfois “le conduire plus loin” (Taylor, 2011, p. 883). Taylor devance ainsi, que malgré les conflits et l’ambivalence face à la pratique religieuse, l’enjeu que représente “l’identité religieuse” aux sociétés politiques libérales, offre une perspective inédite sur l’étude: “des liens entre foi, identités politiques nationales / communautaires et modes de vie.” (Taylor, 2011, p. 884). Ces liens “relâchés”, comme le signale Taylor, ne doivent pas pourtant sous-estimer le phénomène de l’appartenance religieuse et de l’identité religieuse qui “restent importantes dans le monde moderne.” (Taylor, 2011, p. 878).
Dans ce sens, Taylor affirme que la référence religieuse reste “puissante dans la mémoire” (Taylor, 2011, p. 890). Selon lui, cette référence se manifeste sous deux formes. Elle peut se montrer “chaude”, donc révélatrice d’une “identité religieuse” pratiquante et engagée dans le contexte religieux et moral d’une certaine religion. “Cette forme qui exige une identité forte et participative” (Taylor, 2011, p. 890), se retire de la sphère publique occidentale. Ce retrait se transforme en une forme plus “froide” de “l’identité religieuse”. Pour Taylor, le retrait se manifeste essentiellement dans une attitude plus ou moins malléable et changeante envers la religion officielle de l’État. Néanmoins, cette identité dans ces deux formes, révèle l’importance de la religion en dirigeant l’attention sur l’espace public dans un “monde pluraliste”. Ceci fait que: “le discours religieux est de plus en plus appelé à se dérouler dans l’espace public.” (Taylor, 2011, p. 907).
2.La Société Sécularisée: la ¨Perspective de Charles Taylor
Du côté de Taylor, la “sécularité” est un terme souvent évoqué, mais “n’est cependant pas clair” (Taylor, 2011, p. 11). Il s’étend principalement sur les formes et les modalités qu’ont prises les sociétés modernes surtout les sociétés occidentales. Taylor présente dans L’Âge séculier, les différentes théories qui ont conceptualisé la “sécularité”. Celle-ci a pris plusieurs significations: dans sa première facette, elle signifie une société “libre de toute “attache religieuse” (Taylor, 2011, p. 12), et indique une caractéristique renversante de nos “modes de structuration” de la société. C’est “un processus de transformation” (Gauchet, 2014, p.42) qui plaide pour une libération signifiante vis-à-vis des systèmes politiques prémodernes. La marque distinctive des sociétés antérieures, réside dans une approche qui consiste à tout organiser autour de l’existence de Dieu.
Dans ce sens, Taylor exprime que la divergence principale existante entre les sociétés prémodernes et les sociétés modernes, se manifeste dans l’absence de ce lien entre l’organisation politique de la société et l’obligation de la croyance en Dieu: “dans nos sociétés “séculières”, on peut s’engager pleinement en politique sans jamais rencontrer Dieu.” (Taylor, 2011, p. 12). Autrement dit, la “sécularité” par sa première signifiance et dans sa première modalité, débouche sur le côté social et signifie: “le retrait de la religion de l’espace public”. Une deuxième signification émerge de ce que nous pensons quand nous évoquons le terme “sécularité”. Nous réfléchissons comme le remarque Taylor au: “déclin de la croyance et de la pratique religieuse” (Taylor, 2011, p. 14). Cette deuxième facette marque avec ampleur le changement des sociétés modernes. Cette théorie avance une définition de la “sécularité” qui s’appuie sur une conception de la modernité qui va de pair avec la disparition de l’aspect religieux. L’abolition de la croyance en une source transcendantale est relative à une tendance moderne en s’accrochant beaucoup plus fermement à la raison scientifique, vu la crédibilité de ses résultats. Mais ce à quoi Taylor s’intéresse, c’est de définir et de dégager un troisième type de la “sécularité». Il vise à rétablir, par sa conceptualisation de la laïcité ouverte, le sens de la religion dans la sphère publique et privé[4].
3.L’ambivalence des idéaux de la modernité
Taylor estime que le fond commun des sociétés modernes est “l’idéal social d’autosuffisance”. L’émergence de ce nouveau principe sur lequel la modernité place ses convictions, concrétise l’attitude moderne qui plaide “un humanisme purement autosuffisant” (Taylor, 2011, p. 42). Par ses approches morales, la modernité tend à restreindre le but et la fin ultime de la vie humaine dans un seul et unique objectif: “l’épanouissement humain” (Taylor, 2011, p. 42). Les sociétés développées sous cet idéal d’autosuffisance, d’autonomie et d’authenticité “étouffent” la nature humaine par “les limites imposées à la connaissance” (Taylor, 2011, p. 49). De la sorte, les identités religieuses risquent de ne pas être reconnues dans leurs options religieuses. La “sécularité” ouvre donc, la voie à la pluralité des options et des choix. Sa genèse est corollaire à l’avènement des concepts démocratiques d’égalité et de liberté. Dans ce sens, elle ne peut être simplement conçue comme le “retrait de la religion”, mais doit être considérée aussi par son ouverture à la reconnaissance de la multitude des choix identitaires (Taylor, 2011).
- La “Laïcité” et la “Sécularisation”
Étant conçue comme un phénomène politique distinctif des sociétés occidentales, la laïcité présente l’un des “foyers d’inquiétude” (Gauchet, 1998, p. 9) pour les sociétés qui n’ont pas encore réussi à l’appliquer ou à l’appréhender au niveau conceptuel. En effet, la “laïcité” est un concept en soi-même complexe et un phénomène politique problématique. Pourtant, et malgré l’ambiguïté rapportée au niveau de l’analyse du concept, la “laïcité” constitue une “composante essentielle de toute démocratie libérale.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 10). Dans une tentative de rendre le terme plus clair, Taylor s’engage à repenser et à délimiter le concept. Pour lui, l’embarras se porte tout d’abord, autour de la conceptualisation et de la définition du terme. Dans ce sens, Taylor dégage deux niveaux d’ambiguïté: la première confusion repose sur une définition commune qui reconnaissance”. Nous nous basons sur ces deux modèles afin de mettre en relief la différence entre la “laïcité républicaine” et la “laïcité ouverte”. Selon Taylor, nous confondons souvent la définition de la “laïcité” avec celle de la “sécularité». Même en admettant que “la séparation entre l’État et la religion” constitue un dénominateur commun entre les deux termes, Taylor scande les divergences entre les deux phénomènes. Dans le chapitre “How to define secularism” extrait de Boundaries of toleration, Taylor précise les points de vue conceptuels concernant le sécularisme. Il établit deux conceptualisations différentes souvent abordées dans le cadre de la sécularité. La première définition tient à représenter le sécularisme, en évoquant l’exigence de la part de l’État à “contrôler la religion” (Taylor, 2014, p. 62). Dans ce sens, l’État vise à imposer une limitation ou une restriction de la religion dans la “sphère publique”. En outre, Taylor mentionne une deuxième approche qui offre une définition plus englobante de la sécularité. Cette définition que lui-même soutient et défend, tend à concevoir la sécularité hors du spectre de l’aspect religieux et tend principalement à définir le sécularisme en insistant sur le côté politico-social de la sécularité. L’objectif principal de cette approche est de concevoir la sécularité comme: “un moyen pour aménager la diversité religieuse, et métaphysico-philosophique des différents points de vue (entre autres, les visions non religieuses et antireligieuses) d’une façon juste et démocratique.”. La sécularité selon cette définition, devient un moyen de “pacification” et de “stabilisation de l’espace public” sans pour autant devenir une lutte contre la religion. D’ailleurs, Taylor se sert de cette définition pour offrir plus tard une meilleure conceptualisation du rôle de la “laïcité”. Dans le but d’achever cette conceptualisation, il avance la thèse suivante: le terrain commun entre la “laïcité” et la “sécularisation” est la “séparation de l’État de la sphère religieuse”, mais cette séparation ne constitue, pour Taylor qu’une: “zone grise et des tensions, parfois même des contradictions” (Maclure & Taylor, 2010, p. 11). L’explication de la “laïcité” par le biais des formules invoquant justement la séparation “n’épuise pas à elle seule le sens de la laïcité.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 11).
Dans le but d’amorcer une définition plus rigoureuse de la “laïcité”, Taylor élucide une deuxième ambiguïté qui pivote autour de la nature différente des deux concepts. Il explique alors, que le “processus de la laïcisation” et le “processus de sécularisation” s’avèrent différents et se reflètent sur des champs divergents:
- a) La “laïcité” est un “régime politique” (Maclure & Taylor, 2010, p. 24). C’est un système de gouvernance qui consiste primordialement à répondre aux défis que lance la diversité culturelle des sociétés religieuses. La “laïcité” consiste alors, à appliquer par les moyens juridiques et exécutifs des principes favorisant la séparation. Cette dernière se manifeste par la séparation de “l’ordre religieux” de “l’ordre politique”, dans le but de préserver “l’autonomie” de l’État et sa “neutralité” vis-à-vis des multitudes notions culturelles. Dans ce sens, la laïcité se définit par: “le processus à la faveur duquel l’État affirme son indépendance par rapport à la religion.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 24).
- b) En revanche, la “sécularité”, est un “phénomène sociologique” (Maclure & Taylor, 2010, p. 24) qui va de pair avec une nouvelle conception philosophique du monde. Représentant alors, des nouvelles perspectives et des convictions d’ordre individuel, qui se présentent dans la société moderne par une vision philosophique du monde sans une référence à un ordre transcendantal ou théologique. Ce phénomène élucide une “mutation séculière” récente dans l’histoire des sociétés modernes, et se concrétise par un changement radical vis- à-vis des pratiques de la religion et de la foi (Taylor, 2011). La “sécularisation”: “s’incarne dans les conceptions du monde et les modes de vie des personnes.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 24). En d’autres termes, la “sécularisation” a contribué au “retrait de la religion” de la sphère publique. Elle a ouvert une nouvelle possibilité qui consiste à organiser la société en insistant sur les valeurs mondaines, humaines sans nécessairement se référer aux “valeurs religieuses transcendantes”.
- La Laïcité: les “Principes Constitutifs” et les “Modes Opératoires”
Comme nous l’avons déjà mis en relief, il existe un lien étroit entre l’ordre religieux et la laïcité. Ces deux pôles peuvent coexister et peuvent aussi manifester des sources de dilemme et de tension. Le lien et la dynamique entre la “laïcité” et la religion peuvent paraître d’ordre disjonctif ou bien jointif. Ce lien est amorcé ou bien atténué selon les conditions de chaque pays qui tend vers la laïcisation. Tout dépend de notre définition de la “laïcité”. Ainsi, la nature de ce lien “complexe” est dans les deux cas d’ordre contingent et s’avère plutôt accidentel que substantiel dans le processus de la laïcisation des sociétés. Malgré une tendance commune à conceptualiser la “laïcité” en la ramenant à la seule exigence de séparer “l’ordre religieux” de “l’ordre politique”, elle se fonde, selon Taylor, sur des “principes” et des “finalités” qui dépassent l’exigence de la “séparation”. La laïcité puise sa raison d’être historique dans cet effort d’émancipation du pouvoir politique de la main mise religieuse afin de rendre l’État indépendant. “L’autonomisation” de l’État est, dans ce contexte, un principe fondateur de la laïcité, mais la “séparation” ne s’avère pas être le but unique ni la “finalité ultime” de la laïcité. En d’autres termes, la séparation de la religion du pouvoir étatique ne constitue pas “l’élément central” (Baubérot & Melot, 2011, p. 64) de la “laïcité” puisqu’elle s’avère être un “moyen” garantissant l’indépendance du gouvernement politique. Pour les philosophes, les sociologues et même pour Taylor, qui se sont lancés dans des études sur la laïcité en tant que régime politique et en tant qu’analyse conceptuelle du terme, la laïcité estime garantir des fins plus estimables et plus nécessaires.
Taylor fait la distinction entre les “principes” fondateurs de la laïcité et les “moyens”. Il offre une distinction conceptuelle entre les deux en distinguant nettement la finalité et l’objectif de chacun de ces deux éléments. Dans ce sens, il affirme que:
- a) “La laïcité repose selon nous sur deux grands principes, soit l’égalité de respect et la liberté des consciences” (Maclure & Taylor, 2010, p. 30). Selon cette définition, les “principes” indiqués constituent le fond et la raison d’être des régimes laïcs. Taylor affirme que le noyau et la finalité de toute laïcité résident dans ces principes-là. Les principes invoquent, en plus de leurs natures substantives pour la laïcité, “une valeur morale” (Maclure & Taylor, 2010, p. 30). Cette dernière est ce que les régimes laïcs doivent achever dans leurs efforts de laïcisation de leurs sociétés. Ces “principes” proposent que l’État laïc ait comme visée essentielle et finalité ultime le “respect de la liberté des consciences ou l’autonomie morale des individus” (Maclure & Taylor, 2010, p. 31), ainsi que le respect de leurs convictions morales.
- b) En revanche, les “modes opératoires” sont d’ordre “des moyens”. Taylor les classifie dans l’ordre des moyens à partir desquels les principes peuvent être réalisés. Ils sont, selon sa perspective, “la séparation de l’Église et de l’État” et la “neutralité de l’État envers les religions et les mouvements de pensée séculiers.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 33). Dans cette optique de distinction, Taylor estime que la “séparation” et la “neutralité” se limitent exclusivement à: “l’ordre des moyens pour garantir ce qui est véritablement recherché” (Baubérot & Melot, 2011, p. 64). La “neutralité” de l’État laïc devient dans le sens taylorien, un moyen qui doit être justement conçu comme: “l’exigence restrictive que l’État doit s’imposer afin de ne favoriser ni de gêner, directement ou indirectement, aucune religion et aucune famille de pensée.” (Baubérot & Melot, 2011, p. 66). Ainsi, la “séparation” demeure un moyen au service de l’autonomie de l’État et non un “principe inhérent” à la laïcité, ni une obligation déterminante pour les régimes laïcs. Dans le but d’amorcer l’importance de la distinction entre les “principes” et les “modes opérationnels”, Taylor étaie son analyse du concept “laïcité” sur cette distinction entre les «principes» et les “modes opératoires”, dans La Laïcité et la liberté de conscience. Ces “modes opératoires” sont, d’une part la “neutralité” de l’État, c’est-à-dire son impartialité vis-à-vis des différentes conceptions séculières ou religieuses, et d’autre part, la “séparation” de la sphère politique pour favoriser son indépendance vis-à-vis de l’ordre religieux. Ces deux pôles assurent une position de gouvernance “neutre” et “autonome”. Ils présentent, pour Taylor, des exigences nécessaires pour la réalisation et la concrétisation des “principes de la laïcité”. Pourtant, ils sont et doivent continuellement être au service des “principes” afin de pouvoir les appliquer. À cet égard, Taylor explique que toute tentative de laïcisation doit préserver les “principes de la laïcité”, mais les “modes opératoires” peuvent être révisés ou bien réinterprétés selon le contexte historique et les conditions de chaque pays. Taylor estime que les “modes opératoires” découlent de ces “principes” et assurent leurs applications. Dans ce sens, ils sont secondaires et non substantifs. Toutefois, ils s’avèrent être: “des arrangements institutionnels indispensables” (Maclure & Taylor, 2010, p. 30), ce qui fait que même si les “modes opératoires” de la laïcité ne sont pas en eux-mêmes des “principes fondateurs de la laïcité” ils demeurent essentiels pour sa concrétisation. Ainsi, Taylor met en relief l’importance de la “neutralité” de l’État laïc, et légitime la nécessité de “la séparation des deux sphères politique et religieuse”, sans pour autant les mettre au niveau des “finalités” de la laïcité. Dans ce but, il explique que, pour que tous les citoyens puissent jouir de ces principes, l’État ne doit pas adopter ou favoriser l’adoption d’une religion ou d’une notion philosophique, puisqu’une fois adoptée, cette religion risque de devenir dominante et pesante sur des groupes qui ne partagent pas les mêmes convictions. Taylor repense le concept de la “laïcité” et estime que: “l’ensemble des régimes politiques visent à réaliser les principes du respect égal et de la liberté de conscience comme des régimes de laïcité” (Maclure & Taylor, 2010, p. 30), malgré la nature de la relation que les États souhaitent établir avec la religion. En reposant sa conception de la laïcité sur une distinction entre “les principes” qu’il considère être “d’ordre moral”, Taylor scande l’importance de la “finalité morale” des principes de la laïcité. Ainsi “l’égale dignité” de tous les citoyens se fonde sur une “valeur morale” (Maclure & Taylor, 2010, p. 30) que le régime politique laïc et démocrate doit reconnaître. Pour assurer ce principe, l’État doit “accorder le même respect à tous ses citoyens” (Maclure & Taylor, 2010, p. 30), malgré leurs choix individuels et leurs convictions personnelles ou spirituelles. Il doit se montrer neutre vis-à-vis de la pluralité des choix.
7.Les Enjeux de la “Laïcité Républicaine”
Taylor avance une distinction entre les “principes” de la laïcité et les “moyens”. Ainsi, il range les “principes” au niveau constitutif donc fondamental, pour la concrétisation de la «finalité morale» de la laïcité. Or, les “modes opératoires” sont au contraire, non constitutifs et n’assurent que la réalisation de ces “principes” aux niveaux juridique et législatif. Cette distinction est essentielle pour Taylor, elle permet une clarification de la laïcité “de point de vue conceptuel” (Maclure & Taylor, 2010, p. 55), ainsi qu’une meilleure application du régime laïc au niveau politico-social. Cette réinterprétation de la laïcité permet à Taylor d’expliquer les différents “régimes de la laïcité” appliqués par les États par le biais de cette distinction même. Elle lui permet également de s’en servir comme un outil conceptuel important afin de “penser la laïcité” d’une façon plus “adéquate”. D’ailleurs, Taylor établit une distinction entre deux régimes, tout en les reposant sur cette distinction et sur la façon dont les États conçoivent la dynamique entre “les principes” et les “moyens” de la laïcité. Pour lui, la perspective que les États adoptent en actualisant la laïcité, débouche sur la relation entre la sphère religieuse et la sphère politique, et s’étend sur la dynamique interactive entre la “sphère publique” et la “sphère privée”. Dans cette perspective, Taylor signale deux formes principales de la laïcité: la première est “républicaine” et la deuxième est “libérale-pluraliste”. Dans l’interprétation taylorienne de la laïcité, la forme “républicaine” offre un modèle qui accorde à la laïcité: “la mission de favoriser, en plus du respect de l’égalité morale et de la liberté de conscience, l’émancipation des individus et l’essor d’une identité civique commune.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 46). Dans ce sens, la “laïcité républicaine” conçoit ses fondements constitutifs en focalisant son attention sur la religion et l’espace commun. Cette forme de laïcité contribue à l’émergence d’un idéal type des citoyens autonomes et raisonnables. Elle plaide pour “une forme de la laïcité plus rigide” (Maclure & Taylor, 2010, p. 39) vis-à-vis de la religion. Autrement dit, l’État “laïc républicain” impose au nom de sa conception de la laïcité, la primauté de la séparation des deux sphères et l’exigence de sa “neutralité” vis-à-vis de la diversité identitaire. La forme «républicaine» s’avère par conséquent, stricte et exigeante au niveau de la “séparation de la sphère politique de la sphère religieuse”, elle nécessite dans ce but la prohibition de «l’identité religieuse» dans la sphère publique. Cette forme de la laïcité se caractérise ainsi, par sa tendance à restreindre la diversité sous prétexte égalitaire et neutre. Dans la perspective républicaine, l’État laïc semble être “plus restrictif envers la pratique religieuse” (Maclure & Taylor, 2010, p. 43) et nécessite une homogénéisation et une neutralisation de la sphère publique. L’État se montre, de la sorte, intolérant face à la pluralité religieuse qui peut se manifester dans la sphère publique. Dans la perspective de Taylor, l’État “laïc républicain” centre son attention sur la réalisation des moyens garantissant la “séparation” et la “neutralité” de l’État, et néglige “la liberté de conscience” et “l’égalité morale” des citoyens. Pourtant, ces deux éléments constituent pour Taylor, le noyau principal qui doit être préservé dans la laïcité, ce qui va amener Taylor à soulever des contestations sur les enjeux de ce type de gouvernance laïque. Le premier enjeu problématique contesté par Taylor, est la position sous-jacente adoptée par l’État laïc républicain, qui consiste pour lui en: “une opinion ou un point de vue négatif” (Maclure & Taylor, 2010, p. 41) vis-à-vis de la religion et de ses adeptes. En plaidant par-là la nécessité de la séparation, l’opinion engendre une position négative envers la religion en la considérant “in- compatible” (Maclure & Taylor, 2010, p. 40) avec notre conception moderne de l’autonomie individuelle. En conséquence, elle adopte une position discriminatrice et intolérante face aux identités religieuses. De ce fait, selon Taylor, le principe de “l’égalité” et de la “liberté de conscience” plaidés par ce régime même, ne sont plus sauvegardés avec le modèle républicain. Du reste, le “modèle républicain de la laïcité” demeure “un instrument” (Maclure & Taylor, 2010, p. 42) au service de la réalisation de “la séparation” et non au service des “principes” constitutifs de la laïcité. Or, Taylor estime que “l’engagement véritable de l’État” (Maclure & Taylor, 2010, p. 43) doit demeurer ailleurs, dans la réalisation de l’esprit de la laïcité qui réside principalement dans l’effort de maintenir une égalité sociale et de promouvoir la liberté de l’expression et la liberté de penser. Dans La laïcité et la liberté de conscience, Taylor cherche à soulever un deuxième enjeu qui pivote autour de l’incapacité de “la laïcité républicaine” à former une “intégration civique” saine (Maclure & Taylor, 2010, p. 43). Dans le cadre de la “laïcité républicaine”, Taylor souligne que “l’intégration civique” exige: “l’effacement ou la neutralisation des marqueurs identitaires”. (Maclure & Taylor, 2010, p. 44). Dit autrement, afin de stabiliser la paix sociale et de promouvoir “l’intégration civique”, le modèle de la “laïcité républicaine” estime que la prohibition de ‘appartenance religieuse dans la sphère publique est nécessaire. Cette dernière constitue par sa neutralité une plateforme commune et homogène face à la diversité. L’objectif principal demeure le développement d’une “identité civique” commune pour tous les citoyens. Or, cette “identité civique” homogénéisée est fortement contestée dans la perspective taylorienne. Dans ce sens, Taylor considère que “l’intégration sociale” n’est engendrée que par “le dialogue”social et la “reconnaissance de la diversité”. Ainsi affirme-t-il que: “le développement d’un sentiment d’appartenance et d’identification dans les sociétés diversifiées passe alors davantage par une “reconnaissance raisonnable ” de la différence.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 44).
8.La “Laïcité Ouverte”: la Perspective Taylorienne
Taylor présente la laïcité par ses aspects distincts et dégage des enjeux contestables. La critique qu’il adresse à la “laïcité républicaine” se situe dans l’optique d’une redéfinition de la laïcité. Il cherche à montrer essentiellement l’élasticité conceptuelle du terme et la malléabilité des “principes constitutifs” et des “modes institutionnels” de la laïcité. Dans ce sens, il élucide la dynamique d’interaction entre ces éléments distincts et constitutifs de la laïcité. Dans son effort à expliquer la variété des régimes laïcs, il vise à montrer que: “la laïcité n’a jamais été une construction dogmatique.” (Maclure & Taylor, 2010, p. 45). Selon lui, la laïcité restera continuellement une “tentative” sujette à l’interprétation. Dans La laïcité et liberté de conscience, il soutient un modèle d’une “laïcité libérale-pluraliste”. Ce modèle plutôt reconnaissant, privilégie à l’instar du modèle républicain, la nécessité de la “neutralité” de l’État vis-à-vis de la diversité religieuse. Pourtant, les points de divergences s’étayent sur le besoin de “la reconnaissance” de la diversité religieuse et sur: “l’importance pour plusieurs de la dimension spirituelle de l’existence.”. (Maclure & Taylor, 2010, p. 74). Cette divergence principale de la «laïcité ouverte» avec d’autres régimes laïcs, exige de sa part, une centralisation sur un principe capital, celui de la “liberté de conscience” (Maclure & Taylor, 2010, p. 74). La “laïcité ouverte” vers laquelle Taylor s’oriente, permet une gestation optimale de la diversité, une réalisation des particularités identitaires, ainsi qu’une réalisation des choix subjectifs. Elle autorise la liberté de l’expression de “l’identité religieuse” et de sa pratique dans la sphère publique. Dans les limites d’un “aménagement raisonnable” de la diversité, elle centre son attention sur les principes de la «liberté de conscience” et “l’égale dignité”. Au demeurant, le but capital de Taylor est de montrer que la laïcité ne représente pas une réalité «intemporelle» (Bauberot & Milot, p. 1001), mais plutôt un résultat des enjeux politico-sociaux qui exigent un effort constant de redéfinition, afin d’arriver à un terme convenable et spécifique de chaque société. Nous aborderons ci-dessous, ce que cette laïcité tient à représenter et comment elle permet au niveau social un “vivre ensemble” positif.
9.”L’Accommodement Raisonnable”: un Point Crucial dans la “Laïcité Ouverte”
La “laïcité ouverte” repense l’enjeu du “lien social” et les points structurants de l’organisation d’un meilleur espace public. Par l’adoption du point de vue de la “laïcité libérale et plurale”, Taylor aspire à favoriser l’intégration des diversités identitaires, tout particulièrement l’intégration des “identités religieuses”. Ceci exige une légitimation des nouvelles mesures juridiques permettant l’acceptation ou bien la manifestation de la diversité au niveau social. Cet “idéal type” de la laïcité s’oppose à la “laïcité républicaine” du fait qu’il promeut une nouvelle dynamique entre “l’espace public” et “l’espace privé”. “La visibilité de l’appartenance religieuse” (Baubérot & Melot, 2011, p. 111) devient alors, pour les interpréteurs de “la laïcité ouverte”, un prolongement nécessaire du principe de la “liberté de conscience”. Celle-ci conçoit le principe de la “liberté de conscience” incluant nécessairement l’autorisation de l’expression et de la pratique des convictions individuelles. Cette exigence permet au niveau pratique, une réhabilitation de l’espace social commun et de l’équilibre entre les revendications identitaires provenant de la majorité et de la minorité. Dans ce sens, les adeptes de la “laïcité ouverte” poussent encore plus loin le débat sur le droit de l’expression de «l’identité religieuse». Le “principe d’accommodement” devient, dans cette perspective, “une obligation juridique” (Maclure & Taylor, 2010, p. 85). Cette obligation se manifeste au niveau légal “l’accommodement” de certaines lois pour renforcer la participation à l’espace public et diminuer la discrimination. Cette obligation juridique vise à repenser les normes instaurées par la majorité, là où: “les personnes possédant des caractéristiques physiques ou particulières (dont l’état physique, l’âge, l’ethnicité, la langue et la religion” (Maclure & Taylor, 2010, p. 84), risquent de subir une indignation discriminatoire. L’enjeu le plus marquant se noue donc autour de l’exigence de la “non-discrimination”. Cette approche non-discriminatoire face aux réclamations identitaires, repose sur un besoin vital de reconnaissance sans pour autant compromettre la “neutralité” de l’État. En revanche, les adeptes du modèle républicain exposent des preuves contre la visibilité des aspects religieux dans l’espace public en soutenant l’exigence de la “neutralité de l’État”. Nous nous baserons sur les preuves avancées dans Laïcité sans frontières, que nous résumons par les démonstrations suivantes:
- a) L’affichage de l’identité religieuse risque d’être interprété par certains comme “encouragement de l’agrégation communautaire” (Baubérot, Melot, 2011, p. 111). Autrement dit, l’affichage des convictions religieuses dans l’espace public peut amorcer le sentiment de l’appartenance à la “communauté de foi” (Baubérot & Melot, 2011, p.111). Le risque de mettre l’appartenance à la communauté en premier, contribue d’une façon latente à se désintéresser des normes communes de la citoyenneté.
- b) “Une deuxième argumentation repose sur la présomption du refus de partager les valeurs communes.” (Baubérot & Melot, 2011, p. 112). Les adeptes de cet argument estiment que les valeurs religieuses partagées au niveau de la communauté, ne facilitent pas l’intégration des individus dans une société plus large. c) La religion ne favorise pas une adhésion aux normes de la modernité. Elle présente un: “danger de recul à l’égard des acquis moraux de la société moderne.” (Baubérot & Melot, 2011, p. 112), surtout à l’égard de l’autonomie de l’individu et de l’égalité des sexes.
Or, les adeptes de la “laïcité ouverte” comme Taylor, soutiennent une thèse contraire, car ces argumentations présentent une part de la vérité et néglige l’autre part. Pour eux, la vie collective” doit réinterpréter ses normes en fonction des exigences sociales. La “vie collective” ne représente pas une donnée figée, mais une réalité qui doit obéir aux exigences du statu quo.
Conclusion: La nécessité de “Repenser la Laïcité républicaine”
En présupposant une malléabilité conceptuelle de la laïcité, Taylor estime que la “laïcité ouverte” sera par ce fait même, mieux apte à répondre aux exigences socio-politiques modernes. Il s’appuie d’ailleurs, sur la nécessité de préserver la “finalité morale” de la laïcité en considérant qu’elle représente une valeur fondamentale pour toute tentative de laïcisation de la société. Il aspire par la suite, à braquer les lumières sur la possibilité de repenser les modes applicatifs ou institutionnels de cette “laïcité ouverte”. Par son projet politique de la “laïcité ouverte” et plurale, il fraie le chemin vers la résolution de la problématique de la pluralité religieuse. Ainsi, le défi lancé aux systèmes de gouvernance peut être résolu en maintenant les valeurs de la démocratie libérale sur lesquelles cette laïcité repose. En effet, la “laïcité ouverte” améliore la conception «démocratique libérale» en la gratifiant d’une dimension plus relationnelle. Cette laïcité souligne l’importance de “la reconnaissance” et l’exprime par sa disposition tolérante vis-à-vis de la multitude. Dans ce sens, Taylor cerne la “finalité de la laïcité” dans ses principes fondateurs suivants: “la liberté de la conscience” et “l’égale dignité morale”. La valeur de ce type de laïcité réside dans son appel humain qui se réalise par son abord reconnaissant: “cette reconnaissance vise à préserver la dignité de la personne, à ses propres yeux et à ceux d’autrui.” (Baubérot & Melot, 2011, p. 93). Taylor étaie par la “laïcité ouverte”, une conception laïque qui approuve l’ouverture aux différentes conceptions des biens et la valorisation de l’autonomie de l’individu. Les convictions individuelles qui ne s’opposent pas aux droits des autres sont donc valorisées et respectées par l’État. Cette “laïcité ouverte” à la diversité est reconnaissante de l’importance de la religion pour chaque individu. Elle soutient alors, les revendications identitaires et encourage leurs manifestations dans la sphère publique. De la sorte, la laïcité va de pair avec les idéaux libéraux, qui accordent une attention particulière à l’autonomie individuelle et à la diversité résultante des initiatives et des persuasions singulières. Dit autrement, la “laïcité ouverte” respecte cette autonomie individuelle qui acquiert une place dans le corps législatif laïc. De même, la “laïcité ouverte” autorise le droit à la différence et ouvre la voie à sa manifestation. Taylor remet la philosophie au sein de la sphère politique, tout particulièrement au sein de l’ontologie. Il vise ainsi, à attribuer un sens plus profond à l’approche politique. Ce projet politique acquiert sa forme et puise ses racines dans le socle ontologique de sa philosophie. Sa conception particulière d’une identité qui se meut dans un champ de préférences morales, sous-tend un lien inévitable entre le sujet et ses convictions. Ces dernières peuvent acquérir la forme d’une appartenance religieuse. En effet, ses conceptions religieuses qui se nouent autour des notions des biens, jouent un rôle capital dans la formation de l’individu et permet de saisir comment la conscience individuelle se forme. Dans ce sens, Taylor veut réconcilier deux moments définitifs au niveau de son projet politique et au niveau de sa conception ontologique du sujet humain: L’autonomie de la conscience et la “dimension dialogique” de la «sphère individuelle» et de la sphère collective.
Références
1-Baubérot, J., & Milot, M. (2011). Laïcités sans frontières. pp. 64- 100. Paris: Seuil
2- Gauchet, M. (1998). La religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité. -3-pp.121-141. Paris: Gallimard. Gauchet, M. (2014).
4-Le désenchantement désenchanté. Dans: Charles Taylor: Religion et Sécularisation. Sous la direction de Sylvie Taussig. pp.30-42. Paris: CNRS
5- Taylor, C. (2003 a). Les sources du moi. La formation de l’identité moderne. (Traduit de l’anglais par Charlotte Melancon). Pp.19-583. Paris: Points.
6-Taylor, C. (2003 b). Cross-purposes: the liberal communitarian debate. Dans: Debates in contemporary political philosophy. An anthropology. Sous la direction de Derek Bibliographie 89 Matevers & Jon Pike. (pp.195-201). London: Routledge in association with the Open University.
7-Taylor, C ( 2010). Le Pluralisme religieux: “est le fait marquant de la modernité”
8-Taylor, C., & Maclure, J. (2010). La laïcité et la liberté de conscience. pp. 30-117. Montréal: Boréal.
9-Taylor, C. (2011). L’Age séculier. pp. 37, 883-907. Paris: Les Editions du Seuil.
10-Boréal. Taylor, C. (2014). How to define secularism. Dans: Boundaries of toleration. Sous la direction de Charles Taylor et d’Alfred Stefan. pp. 62-70. New York: Columbia University Press.
[1]-Doctorante en philosophie politique à l’université Saint Esprit kaslik USEK. Email: elisechallita@gmail.com طالبة دكتوراه في الفلسفة السياسيّة من جامعة الروح القدس – الكسليك – لبنان.
[2] – بروفسور في الفلسفة السياسية في جامعة روح القدس الكسليك – لبنان.
Professeur en philosophie politique à l’université du Saint Esprit Kaslik USEK. Titulaire d’un doctorat en philosophie politique, Marie Fayad est professeure à la Faculté de Philosophie et des Sciences humaines de l’USEK. Elle est également responsable du Laboratoire Sophia, un centre de recherche dédié à la philosophie juridique, morale et politique, Email: mariefayad@usek.edu.lb
[3]– Une terminologie propre à Taylor, qui désigne les idéaux sociaux adoptés par les communautés. Ces idéaux profilent une image idéale à laquelle l’homme aspire atteindre.
[4]– Le « retrait de la religion » se passe progressivement et prend forme sous la véhémence du pouvoir des nouveaux « idéaux sociaux », entre autres: « l’autonomie radicale » du sujet. L’individu devient le noyau de toute conception. Les sociétés ne prennent plus forme grâce à une source divine, mais émanent de la « volonté libre » des citoyens. Cette survalorisation de la volonté libre débouche nécessairement sur une pluralité des convictions. Dans ce sens, Taylor écrit que nous vivons de plus en plus dans un monde aux « modernités multiples » (Taylor, 2011, p. 48).