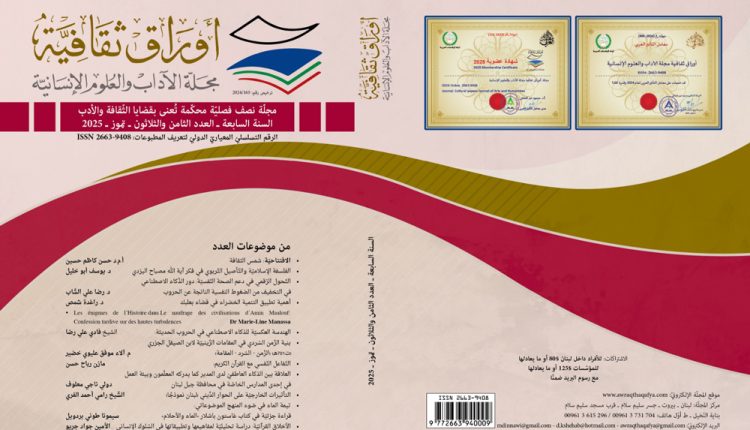عنوان البحث: Les enjeux du conflit et les défis du politique selon Julien Freund
اسم الكاتب: Elise Elia Challita, Professeure Marie Fayad
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013810
Les enjeux du conflit et les défis du politique selon Julien Freund
رهانات الصّراع وتحديّات السياسة من منظور جوليان فروند
Elise Elia Challita اليز إيليا شليطا([1])
Sous la direction du Professeure Marie Fayad أ.د. ماري فياض)[2](
تاريخ الإرسال:22-6-2025 تاريخ القبول:30-6-2025
Résumé
Cette contribution s’attache à explorer la pensée de Julien Freund qui s’inscrit dans la lignée de la philosophie politique réaliste. Le conflit, sous cette perspective, est reconnu comme un phénomène inné et naturellement associé à l’essence du politique. Son anéantissement est alors, impossible, d’où la nécessité de repenser le rôle du politique et l’enjeu du conflit en son sein. Le politique est essentiellement conflictuel et notre objectif est de gérer et d’aménager les crises qui surgissent dans la sphère politique. Cet article explore les enjeux du conflit dans la pensée freundienne, en insistant sur son rôle ambivalent et structurant dans la vie collective. Il met en lumière les défis que doit relever l’action politique dans un monde où la paix n’est jamais donnée, mais délibérée politiquement.
Mots clés: Le conflit; l’ambivalence du conflit; conflit naturel; l’intelligence politique; l’ennemi; la paix.
الملخّص
تهدف هذه المساهمة إلى استكشاف فكر جوليان فروند الذي يندرج ضمن تقاليد الفلسفة السياسيّة الواقعية. يُنظر إلى الصراع، من هذا المنظور، على أنه ظاهرة فطرية ومرتبطة بطبيعة السياسي. وبالتالي، فإنّ القضاء عليه يُعد أمرًا مستحيلاً، ما يستدعي إعادة التفكير في دور السياسة وفي رهانات الصّراع داخلها. فالمجال السياسي بطبيعته مجال صراعي، وهدفنا يتمثل في إدارة الأزمات وتنظيمها داخل هذه السّاحة. يستعرض هذا المقال رهانات الصّراع في فكر فروند، مع التركيز على دوره المزدوج والبنيوي في الحياة الجماعيّة، كما يُبرز التّحديات التي تواجه الفعل السياسي في عالم لا تُمنح فيه السِلم تلقائيًا، بل تُبنى من خلال القرار السياسي.
الكلمات المفتاحيّة: الصراع؛ ازدواجية الصراع؛ الصراع الطبيعي؛ الذكاء السياسي؛ العدو؛ السلام.
Introduction
Le conflit est, selon la perspective freundienne, une composante essentielle à la vie sociétale. Contrairement à de nombreux théoriciens, Freund affirme qu’il ne faut pas tenter d’en protéger la société comme d’une maladie. Loin d’être un facteur de désintégration des rapports sociaux, le conflit a ses enjeux paradoxaux par la dynamique de son ambivalence même et le double rôle de l’inimitié de ses acteurs (Freund, 1983, p.88). Ainsi, il propose une lecture pertinente du rôle du conflit dans l’essence du politique. Celle-ci demeure, selon sa perspective, une essence conflictuelle par excellence.
Notre problématique est la suivante: Dans quelle mesure la saisie des enjeux de la conflictualité, produisent une conception suffisamment positive de l’antagonisme politique?
1- Le conflit: une force pour le changement
La société est définie par Freund comme une ‘donnée’[3] fondatrice de la nature humaine. Comme ‘donnée’, elle est un présupposé fondamental du politique et une disposition permanente que les êtres humains ne sauraient dépasser. Freund doit cette conception à Vilfredo Pareto duquel il a appris que «le changement ne se comprend que par rapport à quelque chose de permanent et que c’est par le changement, par l’histoire, que l’homme reste fidèle à lui-même» (De La Touanne, 2002, p.7). Partant de cette conception, Freund considère que la société est issue de la dynamique des interactions sociales dont le conflit est la générativité interne du changement:
«Le conflit ne devient sociologiquement intelligible que si on conçoit la société comme une donnée de l’existence humaine et comme un tissu de relations que l’activité humaine transforme sans cesse, le conflit étant un des facteurs de ces continuelles modifications.» (Freund, 1983, p. 180).
En dépit de la particularité de chacune de ses occurrences, le conflit est animé par un mouvement qui constitue en général une force intégratrice commune dans les conflits politiques. Cette dynamique du conflit joue un rôle attractif pour le recrutement d’une diversité de partisans qui s’intègrent et participent d’une façon ou d’une autre au conflit: «Les attitudes des participants directs ou indirects sont tous aussi multiformes” (Freund, 1983, p.190). Par sa force intégratrice, le conflit est en mesure de combiner les éléments opposés qui ne peuvent se dissoudre dans l’homogénéité du tissu sociétal. Le conflit est ainsi un recruteur de la collectivité.
Or, «une intégration politique suppose qu’au préalable on désintègre des structures qui refusent l’intégration et qui opposent une résistance qu’en général on ne réussit à briser que par un conflit ou par une guerre civile» (Freund, sociologie du conflit, p. 120). Si le conflit introduit une rupture dans le corps sociétal en établissant de manière directe ou indirecte des volontés qui s’opposent, il ne doit pas être toutefois considéré comme un élément négatif que nous devons à tout prix annuler mais plutôt l’appréhender comme un élément débloquant des situations politiques. En effet, Freund met au premier plan les différentes composantes sociales face aux risques et aux conséquences du conflit et favorise au deuxième plan la possibilité de résoudre une situation problématique persistante. C’est dans ce sens que le conflit est parfois un « déblocage » (Freund, p. 87) souhaité par les partisans.
Animé par une dynamique interne qui constitue un «ferment de désordre par dissolution des formes» (Freund, sociologie, p. 191), le conflit «empêche l’ossification du système» (Freund,1983, p. 116) caduque et «provoque à l’intérieur de la collectivité des ruptures du fait qu’il la jette dans une situation exceptionnelle» (Freund, 1983, p. 192). Cette provocation ne suit pas une lignée stable, mais connait plutôt plusieurs phases. Le conflit est parfois plus animé et plus intense dans l’une de ses phases. Comme il peut passer par des phases d’atténuation permettant de prendre d’autres mesures et de reprendre sa force. Selon Freund, les sociétés peuvent réussir peu à peu à aménager le conflit et la violence qui lui est inhérente. Ce qui est marquant, pour lui, c’est le calme de la dernière phase du conflit, son importance réside dans le but final, celui «d’épuiser l’ennemi sans s’épuiser soi-même» (Freund, 1983, p. 193).
Grâce à cette caractéristique qui fait du conflit un mobilisateur de la masse, la surexcitation de la couche sociétale permettra de former des nouvelles relations en intégrant dans ses cadres des éléments qui ont été auparavant isolés ou écartés. Le conflit se caractérise surtout par son facteur innovateur auquel Freund attribue la vertu de la créativité (Freund, 1983, p. 115); il favorise une création qui ne se fait pas à partir d’ex nihilo, mais présuppose un rapport de force préexistant naturellement dans les structures de la société. Freund s’aligne effectivement avec les philosophes et sociologues qui considèrent le conflit non pas comme un élément perturbateur, mais comme un catalyseur des modifications pertinentes des formes sociétales. Ainsi pour Freund, la dynamique du conflit devient, par sa force intégratrice, un moteur déclencheur du changement: il provoque des ruptures et suscite l’innovation en stimulant le flux permanent des mutations. Il entretient ainsi l’évolution de la vie d’une société comme il détermine son devenir en ouvrant de nouvelles perspectives.
2- L’ambivalence et la régulation politique
Le conflit, de par sa nature, est un phénomène révélateur des interactions entre les puissances impliquées dans toute dynamique sociétale. Le jeu politique qui anime le conflit ne devient pas seulement un jeu de violence, mais aussi une dynamique enchevêtrée qui dépend d’un rapport de dualité: l’antagonisme.
Par ‘antagonisme’, Freund entend les antinomies et les incompatibilités (Freund, 1983, p.148) naturellement présentes dans toute société, telles les divergences morales, philosophiques, politiques et économiques. Les antinomies sont des éléments naturels, latents, voire «éternels» (Freund, 1983, p. 152). Les divergences dans les dynamiques sociétales n’aboutissent nécessairement pas à des chocs violents et ne sont pas toujours créatrices de désordre. Cependant, elles dégénèrent, dans certains contextes, en conflits. L’usage du terme ‘antagonisme’ signale l’influence d’Héraclite sur la pensée freudienne. Nous remarquons d’ailleurs que Freund réanime à travers son œuvre la notion de la lutte des forces opposées et nous assistons à l’incorporation de ces forces antagonistes intégratrices dans la genèse du corps politique. À l’instar d’Héraclite, Freund fait du polemos la cause première de tout changement.
Dans le conflit (ou polemos), le potentiel de l’inimitié lève le voile sur l’un des traits majeurs que revêt l’antagonisme: «l’ambivalence[4]» (Freund, 1983, p. 117). Porteur d’une dynamique ambivalente, le conflit devient le lieu de la manifestation des deux forces opposées à l’instar des présupposés. Freund met en avant cette notion sur le plan pragmatique en considérant que c’est dans ce caractère intrinsèquement ambivalent de la dynamique de l’antagonisme que se tient un enjeu politique considérable animant le conflit. A travers l’histoire, l’ambivalence du conflit manifeste ses effets tantôt positifs (évolution, innovation), tantôt négatifs (destruction, désintégration, rupture). Toujours est-il qu’il peut être également avec le temps un enjeu de ‘régulation’.
En effet, le conflit peut conduire à l’exclusion sociale et à la destruction et l’isolation s’il se sert de l’agression et de l’hostilité en se fixant comme but la destruction: «Le conflit a tendance, particulièrement dans ses phases aiguës, à se fermer sur lui-même, à devenir prisonnier de son enjeu et par conséquent à ignorer tout le reste» (Freund, 1983, p. 122). D’autre part, le conflit peut être, dans les conditions normales et équilibrées, une force créatrice d’un nouvel ordre positif et à ce titre un facteur de régulation de la cellule sociale (Freund, 1983, p. 119) en contribuant à «l’intégration politique» (Freund, 1983, p. 120). Ainsi, tout conflit ne mène pas nécessairement à la destruction totale.
Selon la conception sociale freundienne, issue de l’influence wébérienne pragmatique[5], les divergences antagonistes du conflit sont souvent irréconciliables et l’idée de les annuler pour les pacifier est irréalisable. Pour Freund, l’antagonisme ne peut pas être résolu par négociation ou par une synthèse-dépassement selon le processus hégélien de l’«Aufhebung[6]» (Hegel, 1970, p. 530). S’il s’agit d’un compromis, ce n’est pas pour faire la conciliation des contraires – car jamais l’un ne se laisse absorber ou transcender par l’autre – mais pour instaurer un équilibre toujours provisoire entre deux puissances antagonistes: ‘la régulation politique’ (Benoist, 2008, §23).
Compte tenu de la situation paradoxale dans laquelle se trouvent les politiques du compromis et de négociation, l’emploi de l’expression ‘régulation politique’ suggère une volonté de maîtrise du fonctionnement politique et du devenir de la société. Comme Pareto, Freund pense que l’ordre social se fonde sur un ‘équilibre’ entre les puissances antagonistes mais tout l’enjeu est de maintenir cet équilibre qui ne relève pas que d’une politique publique, mais qu’il appartient surtout à l’action permanente du pouvoir public de toujours réguler l’ambivalence en usant de son autorité. C’est pourquoi ‘la régulation politique’ est une construction qui se développe dans le temps.
Ainsi, l’imbrication étroite entre l’intégration de la dynamique ambivalente et le recours à l’autorité de la régulation politique constitue une clé de voûte dans la mise en ordre de la société politique.
3- L’inimitié politique et son enjeu paradoxal entre guerre et paix
Ce qui est intéressant dans la conception freundienne de ‘l’ennemi politique’, c’est qu’il accorde un double rôle paradoxal à son existence politiquement indispensable: D’une part, il permet une centralisation de la sphère intérieure contre l’agresseur étranger; et d’autre part, une concrétisation de la volonté d’une unité politique dans le jeu des puissances interétatiques.
D’une part, l’identification d’un ennemi extérieur dans la guerre interétatique, permet une unification de la sphère interne pour la défense de la nation. De la sorte, Freund fait écho à Simmel qui signale l’effet positif de l’ennemi sur la dynamique intérieure d’un pays. Cependant, l’enjeu devient critique dans l’évolution de la guerre au risque de nuire à la sphère interne par l’effondrement:
«L’état de conflit […] resserre si fort les éléments et leur fait subir une impulsion si unitaire, qu’ils sont obligés soit de se supporter, soit de se repousser complètement ; et c’est aussi pour cette raison que pour un État traversé d’oppositions intérieures, une guerre extérieure peut être le moyen ultime de les surmonter, mais parfois aussi de faire s’effondrer définitivement tout l’ensemble » (Simmel, 2010, p. 323).
D’autre part, la guerre dans le jeu des puissances interétatiques, «perdrait toute signification si elle considérait l’(ennemi) comme un être à exterminer après la victoire, donc après la guerre», affirme Freund ( 2004, p. 498). Et il ajoute que «la fin de la guerre n’est pas la disparition collective par extermination physique de l’ennemi, mais la ruine de sa puissance» (Freund, 2004, p. 498). Cependant, il fait signaler que la dynamique politique requiert souvent le pouvoir rusé d’identifier un ‘ennemi politique’ et la capacité de former des alliés afin de s’affirmer dans le jeu de puissance international. Reconnaître l’ennemi, c’est donc pour Freund un procédé politique pour établir des limites à la guerre et envisager avec lui un accord de paix lorsque l’équilibre des puissances signale qu’aucun État n’est assez fort pour dominer l’autre. C’est grâce à ce procédé de reconnaissance de l’ennemi politique que Freund conçoit la concrétisation de la volonté d’une unité politique internationale. C’est probablement dans cette optique que Freund a fait du présupposé ami/ennemi le propre de la politique extérieure. Selon la tradition réaliste, la société internationale n’est pas régentée par un pouvoir politique reconnu par les différents États qui demeurent donc ‘anarchiques’; de surcroît, il n’existe aucune instance supérieure internationale capable de pacifier tous les États en guerre: d’où l’importance du processus de la reconnaissance de l’ennemi qui joue son rôle particulier dans les relations internationales. Cela permet que les États se reconnaissent mutuellement dans la guerre et dans la paix. «Reconnaître son ennemi, c’est pour un État se donner les moyens de sa survie» (Pitiot, 2012, p. 59).
En effet, l’ennemi politique est un aspect essentiel de la vie politique et ne doit pas être assimilé à un criminel: «Criminaliser l’ennemi aux yeux de Freund, c’est non seulement nier sa qualité militaire de combattant, mais c’est aussi nier l’une des tâches essentielles de la politique qui consiste à régler les conflits et à négocier la paix par les voies diplomatiques» (Pitiot, 2012, p. 60). S’il est, en dernier lieu, l’interlocuteur avec lequel la paix se conclut, aucune négociation diplomatique ne peut être concevable avec un ennemi criminel (Soro, 2023, p. 57). L’ennemi politique a alors un caractère vital qui donne sens à l’activité politique en déterminant la diplomatie des collectivités dans les alliances; c’est pourquoi il est inutile de le nier et de sous-estimer l’enjeu de son double rôle dans le processus de politique de guerre et de paix. Comme on signe la paix avec l’ennemi politique contre lequel on a fait la guerre (et non avec un ami), la ‘paix politique’ est alors l’issue politique de la guerre. Elle n’est donc pas un état permanent ou un impératif moral, mais elle devient concevable à partir de la guerre. Ainsi Les deux concepts, ‘guerre’ et ‘paix’, sont-ils deux concepts paradoxalement indissociables chez Freund. D’où l’enjeu de l’action de l’inimitié guerrière dans la dynamique politique freundienne pour le processus de paix politique.
La paix politique «consiste à la fois dans la paix intérieure ou civile entre les groupes subordonnés à l’intérieur d’un État et dans la paix internationale entre les États» (Freund, 1987, p. 152). Dans cette détermination de la notion de ‘paix politique’, nous retrouvons chez Freund un double rôle dans deux lieux d’action pour l’État. D’une part, il est un artifice politique et juridique destiné à pacifier sa propre communauté politique en s’imposant comme une autorité souveraine pour la concorde intérieure. Cette prémisse aboutit à une deuxième qui la complète et l’harmonise sur le plan international d’une manière pragmatique: l’État prend la forme de l’ennemi politique dans le conflit armé (guerre) contre d’autres États agresseurs et joue le rôle de négociateur dans toute tentative diplomatique visant la paix dans les rapports interétatiques. L’Etat-ennemi est un agent concret de négociation pour la paix. Si c’est avec lui qu’on scelle la paix, son rôle devient alors central dans le pronostic de guerre et de paix à la fois. C’est dans cette dynamique que tous les efforts internationaux se consolident et s’entremêlent.
Si l’identification de l’ennemi est cruciale, son déni inhibe et bloque la paix: «la non reconnaissance de l’ennemi est un obstacle à la paix» (Freund, 2004, p. 496). Sa négation pose un défi palpable à l’instauration de la paix, nous demeurons, grâce au rejet de son existence, dans le conflit ouvert et virtuel. Pitiot (2012), dans son analyse de présupposé ami/ennemi freundien, approfondit le rôle de l’ennemi latent et masqué dans la sphère du politique en apportant une attention sur l’enjeu de la multiplicité des formes de l’inimitié et tout particulièrement, l’ennemi non reconnu en tant que tel dans l’essence du politique. Nous admettons alors, selon cette optique, que l’existence de l’ennemi en politique est un fait empirique que tout État politique doit envisager au préalable afin de maintenir une politique équilibrée dans le jeu mondial.
4 -Le droit à la résistance et la réinstauration de la justice
Le discours philosophique[7] accorde en général au collectif le droit de se révolter contre un régime tyrannique ou le droit de résister à une autorité qui se montre violatrice du corps collectif[8]. Ce droit, qui constitue un principe d’exception en opposition à la norme en politique, est accordé essentiellement à un peuple qui se révolte contre une oppression et non pas à des individus au titre d’une opinion ou d’une volonté individuelle. Dans certains cas exceptionnels, le droit à la résistance est accordé à une minorité consciencieuse et vigilante qui refuse de se soumettre à un commandement oppressif et qui voit dans la résistance un acte politique nécessaire pour la réinstauration de la justice.
Le narratif autour de l’insurrection constitue une des pièces centrales dans l’histoire du politique en général, et de la philosophie du contrat social en particulier. Selon Freund, la justification du ‘droit à la résistance’ se retrouve fondamentalement dans la thèse du contrat social[9]:
«Du moment que le fondement du pouvoir réside en un contrat par lequel le peuple délègue au roi la charge de le protéger, il est clair qu’en cas de rupture ou de menaces de rupture du pacte, l’obligation d’obéir devient caduque, que le peuple peut reprendre sa liberté et qu’il se trouve fondé à combattre les initiatives de celui qui, par son comportement, a annulé le pacte» (Freund, 1983, p.180).
Pour lui, le phénomène de l’insurrection est un sujet ambigu. Par souci d’apporter plus de clarification sur ce sujet, il pose la problématique qui oscille entre deux positions opposées: soutenir la justification et la légitimité de la résistance ou opter pour l’ordre étatique même s’il se montre injuste.
Freund propose d’abord de penser les motivations des individus qui exécutent l’acte de la résistance. Ce qu’il propose de faire, c’est de s’interroger sur la résistance en soi au lieu de l’aborder par son objectif (le bouleversement d’un ordre injuste qui est lui-même justifiable). Il se demande alors si ‘le sujet’ est autorisé à faire usage du droit à la résistance» (Freund, 1983, p. 182). Cette interrogation est capitale puisqu’elle met en doute les motivations qui seront à leur tour questionnées. Sous prétexte que toutes les définitions et les justifications qui s’y rapportent sont vagues et ambiguës, il rappelle que la nature même du politique se fonde sur l’oppression et, faisant écho à ce propos à la conception wéberienne[10] du politique, il répète après lui que le politique est l’art d’exercer une dominance sur un autre groupe. L’oppression est, selon cette optique, «enracinée dans tout pouvoir» (Freund, 1983, p.185) et la question de la légitimité de la résistance devient alors plus difficile à être reconnue, surtout lorsque la résistance du peuple est ‘violente’ (Freund, 1983,p.185).
Le nerf de son argumentation sur ce sujet porte essentiellement sur la nécessité de séparer les normes et les exigences de la recherche juridique de celle du politique. Son objectif primaire – celui d’autonomiser les essences afin de pouvoir les penser dans leurs aspects transcendantaux et généraux – exige de sa part un effort d’abstraction afin de cerner ce qui est propre à chaque sphère. Cet effort de clarification des concepts met la thèse freudienne sur un nouveau virage qui marquera son avancement. À ce sujet, il insiste sur le principe que l’oppression est une notion politique et qu’elle doit être saisie dans un contexte qui lui est adapté. Pour cerner l’eidos (concept phénoménologique husserlien) du phénomène de l’oppression, il faut donc le saisir dans son champ de manifestation, dans son milieu naturel et non selon le codage et les principes du droit.
Freund cherche alors le critère qui permet à la conscience humaine de répondre à la question suivante: «Existerait-il un critère purement juridique (en prenant garde de ne pas introduire subrepticement des considérations morales) capable de justifier la violence de la résistance et non la violence de l’oppression?» (Freund, 1983, p. 187). Et il présente alors la nature du droit comme radicalement différente de celle du politique. Cette distinction met en relief la nature divergente du politique et du droit. Le droit qui est de l’ordre du ‘social’ (Freund, 1983) cherche à aménager le collectif dans sa dimension générale et ne peut pas légiférer ce qui est particulier. Par conséquent, la justification de la violence sous toutes ses formes ne peut pas être juridiquement acceptable. Le fait d’attribuer une valeur juridique en effectuant une législation de l’acte de la résistance à une minorité ou à une volonté individuelle n’est pas compatible avec la nature même du droit, surtout que cela va à l’encontre du principe de sa finalité. Le droit à la résistance, qui attribue une force législative d’un groupe sur un autre, «constitue une justification de la violence pour lui donner une apparence de légalité» (Freund, 1983, p.188). Ce serait l’exercice du despotisme au nom de la résistance légitime. De surcroît, la législation d’un acte de violence effectué sous prétexte de la résistance engendre une rupture d’équilibre au sein du tissu sociétal.
La finalité de la thèse freudienne se trouve ici à son point culminant: partant de la conceptualisation wébérienne, Freund refuse d’accorder à cet acte d’insurrection le «soi-disant droit à la résistance» (Freund, 1983, p. 185) et lui enlève toute signification juridique. Même s’il justifiait cet acte contre l’oppression, il limite toutefois sa légitimité au cadre de l’exception dans le jeu politique. Son opinion penche alors en faveur du gouvernement établi plutôt qu’à l’acte de l’insurrection. La violence civile demeure pour lui un échec conceptuel et un signe de discordance, même si elle se manifestait comme un acte justifié par une volonté créatrice d’un ordre plus parfait, plus humain ou plus juste.
5 –L’intelligence du politique et la canalisation de la violence
L’intelligence du politique, c’est la capacité du politique à saisir les enjeux, les dynamiques conflictuelles et les intérêts particuliers des adversaires. Par cette intelligence, l’État doit être capable d’analyser les rapports de force et de les comprendre afin de pouvoir élaborer des stratégies et des réactions appropriées à chaque type de violence socio-politique. Ainsi, Freund fait du politique une compétence et un talent d’anticipation qui a pour but final la canalisation des conflits.
Par l’intelligence du politique, les enjeux de la violence sont saisis. L’activité politique est condamnée à la violence qu’elle doit sans cesse essayer de convertir en maniant le degré de l’intensité de cette violence prévue. Dit autrement, nous ne pouvons pas séparer la politique de la violence. Le conflit, qui est l’une des données naturelles de cette essence politique, sera toujours une occurrence manifeste dans la société: «Il n’y a de politique que là où il y a un ennemi. Cela signifie que la violence et la peur sont au cœur de la politique» (Freund, 2004, p. 444). Freund qui considère alors que la violence est un aspect originel et constitutif du fait social (Freund, 2004, p. 35), conçoit l’homme comme un être violent, ayant recours à la violence dans plusieurs secteurs de sa vie. Effectivement, l’histoire témoigne de la violence des humains et de la nécessité de cette dernière. Plusieurs philosophes, particulièrement Nietzsche, pensent que le manque de violence chez l’individu ou dans les nations est un signe de décadence et de mollesse, esthétiquement et éthiquement indésirable. La violence n’est donc pas une pathologie sociale, mais plutôt une occurrence normale que l’État politique doit contrôler à l’aide de tactiques et de stratégies afin d’empêcher son escalade. Mais cette violence doit être associée à la notion de puissance: «La violence consiste en un rapport de puissance et pas simplement de force, se déroulant entre plusieurs êtres (au moins deux) ou groupements humains» (Freund, 1983, p.98). Par cette définition perspicace de la violence, Freund élucide la ruse omniprésente au cœur du politique. La puissance est l’art du potentiel, se distinguant de la force qui se manifeste dans le domaine concret. Freund cherche, par cette distinction, à mettre en perspective la finalité du politique: le bon développement stratégique et l’aménagement rusé des ressources d’un État. Le pouvoir étatique devient, selon cette optique, un usage sage de la puissance et non de la force ou de la violence. Le politique ne se contente pas de penser théoriquement les aprioris mais aussi de penser le terrain. Son rôle est de bâtir des stratégies et de maintenir l’ordre par la régulation pour défendre les citoyens.
Par l’intelligence du politique, les dynamiques conflictuelles sont planifiées selon les objectifs. L’objectif du politique est alors de gérer les conflits et de limiter l’escalade de la violence afin de maintenir le bien commun. L’État, monopole de la violence, doit dans ce sens contraindre l’intensité de l’agressivité naturelle présente instinctivement chez les citoyens et restreindre la pulsion de domination en canalisant cet instinct par la tactique politique. Or, les transgressions sont «un phénomène social aussi ordinaire que la règle ou le châtiment» (Freund, 1983, p. 206). C’est pourquoi le parachèvement de cet objectif n’est pas uniquement le fruit de l’établissement des lois et des normes garantissant l’ordre et la paix sociétaux, mais il résulte plutôt d’une réponse politique adéquate qui réussit à canaliser et à gérer la violence. Selon Freund, cette réponse politique adéquate se cristallise par «l’économie des moyens, la surprise et la tactique» (Freund, 1983, p. 223). Effectivement, le politique doit avoir à ses dispositions un ensemble des moyens qui sont configurés spécifiquement pour traiter les occurrences conflictuelles. La réponse politique a besoin nécessairement d’une mise en place d’une stratégie, ce qui implique alors la ruse. Freund entend par ‘stratégie’ l’art de planifier un conflit. C’est «un aspect de la politique au même titre que la diplomatie» (Freund, 1983, p. 228). Toutefois, Freund qui nous offre une réinterprétation de la philosophie d’Aristote accorde à l’art de la planification plus d’importance que le discours normatif sur la guerre et la paix. Le politique devient l’art de prévoir et d’établir un plan d’action, une gestion des forces et non un discours rhétorique: c’est par la bonne tactique qu’une victoire peut être remportée.
Par l’intelligence du politique, la guerre contre l’ennemi est règlementée par le droit. Bien investi du pouvoir de décision, le politique tente la réglementation de la guerre en constituant des limitations par les accords ou conventions internationales. Pour parvenir à dompter la violence, la barbarie et la brutalité sont contenues par la fonction dissuasive du ‘droit de la guerre’[11]. Freund estime que l’État parfait est celui qui réussit à «transformer la lutte indistincte en combat réglementé» (Freund, 1983, p. 79). La lutte transformée en combat ou même en une simple rivalité est non seulement dépourvue d’agressivité, mais également soumise à un ensemble bien déterminé de règles que tous les partisans doivent respecter mutuellement (Freund, 1983, p. 78). En contrepartie, Freund n’hésite pas à approuver l’usage de la force pour défendre un État de droit contesté par la violence illégitime (Freund, 1983, p. 336). D’ailleurs il reconnaît dans Sociologie du conflit que «le droit international est une régulation des relations internationales à partir des guerres et du rapport de force qu’elles ont chaque fois créé. Les relations internationales sont commandées par l’issue des guerres» (Pitiot, 2012, p. 41).
Conclusion: Ainsi selon Freund, les enjeux du conflit sont pratiquement les défis du politique. Le conflit peut, par sa force intégratrice, favoriser la générativité du changement pour un devenir meilleur et jouer le rôle de régulateur de la vie sociale. Enfin, l’inimitié politique, qui se manifeste dans les luttes et les guerres, devrait mener à la canalisation de la violence dans les conflits pour la paix grâce à ‘l’intelligence du politique.
Références:
-Boulé, H. (2008). Julien Freund, philosophe de la résistance. Mémoire
présenté à faculté de philosophie. Québec: Université Laval. file:///C:/Users/pcc/Downloads/25213.pdf
-De la Touanne, S. (2005). Julien Freund penseur “machiavélien” de la Politique. Paris:D’Harmattan.
-Simmel, G. (1995). Le conflit. Préface de Julien Freund. Traduction de
Sibylle Muller. Belval, France: Circé/Poche. Circé. (Œuvre originale publiée en 1908)
-Pitiot, J.-B. (2012). Guerre et polémologie dans la pensée de Julien Freund (Mémoire de master, Université Panthéon-Assas, Master Sécurité et défense). Université Panthéon-Assas.
-Freund, J. (1983). La sociologie du conflit. 1ère édition. Paris: Presse universitaire de France.
-Freund, J. (1984). Philosophie et sociologie. Louvain-la-Neuve: Cabay.
-Freund, J. ( 2004). L’Essence du politique (1965). 3ème édition. Paris: Dalloz.
-Freund, J. ( 1991). L’aventure du politique. Entretiens avec Charles Blanchet. Paris: Critérion. 249 pages.
-Hegel, G. W. F. (1970). Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé (M. de Gandillac, Trad.). Gallimard. (Œuvre originale publiée en 1830)
-Hobbes, T. (1997). Leviathan (P. Aquin, Trad.). Gallimard. (Œuvre originale publiée en 1651).
[1]-Doctorante en philosophie politique à l’université Saint Esprit kaslik USEK. Email: elisechallita@gmail.com
طالبة دكتوراه في الفلسفة السياسيّة من جامعة الروح القدس – الكسليك – لبنان.
[2]– بروفسور في الفلسفة السياسية في جامعة روح القدس الكسليك – لبنان.
- Professeur en philosophie politique à l’université du Saint Esp
- rit Kaslik USEK.
Titulaire d’un doctorat en philosophie politique, Marie Fayad est professeure à la Faculté de Philosophie et des Sciences humaines de l’USEK. Elle est également responsable du Laboratoire Sophia, un centre de recherche dédié à la philosophie juridique, morale et politique. Email: mariefayad@usek.edu.lb
[3]– Le concept freundien de donnée est une disposition fondatrice et indépassable: « la donnée doit être une disposition générale et permanente de la nature humaine que les êtres ne sauraient dépasser au cours du développement historique des civilisations » (Freund, 1991, p. 39).
[4]– L’usage du terme ‘ambivalence’ est significatif. Dans son sens étymologique, le mot provient du latin ‘ambi’ signifiant ‘les deux’ et de ‘valentia’ ou ‘valere’ signifiant ‘force’ ou ‘valeur’.
[5]– Selon weber, l’antagonisme présente une tension omniprésente pouvant stimuler le conflit.
[6]– ‘Aufhebung’, ou «négativité positive»: le fait de nier une structure décousue ou fausse, tout en maintenant les éléments dont on peut avoir recours pour poser une nouvelle stucture… concept central de la philosophie de Hegel, caractérise le processus de dépassement d’une contradiction dialectique où les éléments opposés sont à la fois affirmés et éliminés et ainsi maintenus, non hypostasiés (non considérés comme existants réellement), dans une synthèse conciliatrice. (Hegel, (1970). Encyclopédie des sciences philosophiques, trad. Bernard Bourgeois, tome I. Paris: Vrin. p. 530.
[8] -La résistance à l’oppression est un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
[9] -Le contrat social, par définition, est un accord par lequel les hommes constituent le pouvoir commun de façon libre, consentie et volontaire. Par conséquent, ils parviennent à coexister paisiblement. Dans l’histoire de la philosophie politique, Grotius fut le premier à le théoriser et parmi les plus célèbres qui l’ont suivi furent Thomas Hobbes (Leviathan,1651), John Locke (son ‘hypothèse de rébellion’ dans le Second Treatise on government, 1691), puis Rousseau (Du contrat social, 1762). (Cf. Chap I )
[10] -Pour Max Weber, la politique est l’exercice d’une dominance d’un groupe sur un autre (Cf. chap 1).
[11]– Comme ‘droits de la guerre’ nous citons: déclaration de guerre, interdiction de certains moyens ou de certaines armes, armistices et traités, statut du prisonnier de guerre …