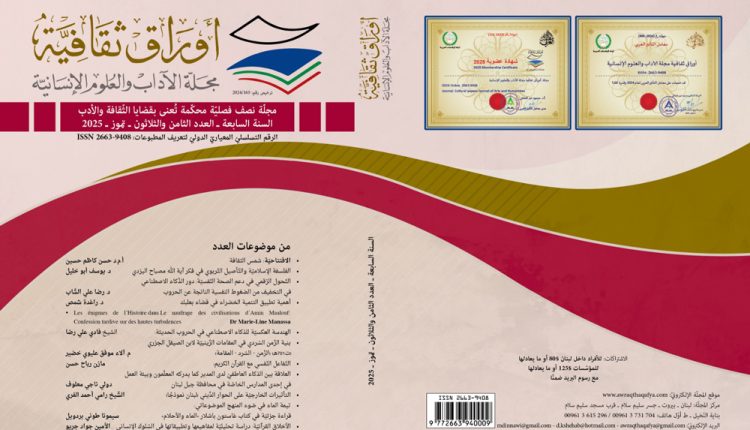عنوان البحث: Réflexions sur l’inspiration marocaine et la créativité de Gebran Tarazi
اسم الكاتب: Dr. Dima Hamdan
تاريخ النشر: 2025/07/16
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013826
Réflexions sur l’inspiration marocaine et la créativité de Gebran Tarazi
تأملات في الإلهام المغربي والإبداع في مسيرة جبران طرزي
د. ديما حمدان[1]Dr. Dima Hamdan
تاريخ الإرسال: 20-6-2025 تاريخ القبول: 1-7-2025
Abstract
Fils d’une célèbre famille d’artisans et d’antiquaires, riche d’un multiple ancrage culturel, levantin, marocain et francophone, Gebran Tarazi est un artiste et écrivain libanais d’expression française, imprégné de cet héritage pluriel qui a un impact sur le domaine de la création.
L’œuvre artistique et littéraire de Gebran Tarazi vibre au monde : aux différences culturelles et identitaires, aux écoles littéraires, aux conceptions philosophiques et aux courants artistiques. Imbu d’une culture holistique et conscient du pouvoir créatif de son versant humaniste, l’écrivain transcende les frontières culturelles en les ramenant à leur source originelle, une et unique, à laquelle il est sensible par nature. Le processus créatif se développe dans l’interaction entre la tradition et la modernité.
Si l’éducation familiale renforce cette tendance, or, il serait judicieux de mettre en valeur l’apport culturel du séjour de l’artiste au royaume chérifien du Maroc avec lequel sa famille entretient des rapports solides. Le langage abstrait de l’art marocain s’empare de Gebran Tarazi dont l’œuvre artistique et littéraire porte l’impact.
Cet aspect, digne d’être médité, vise à faire découvrir un génie libanais à partir d’un angle de vue biographique, et à mettre en valeur une œuvre hétéroclite qui regorge de mémoires et de cultures. Il déclenche des questions qui s’articulent autour de l’impact de la fascination de l’artiste par le Maroc.
Comment l’initiation de Gebran Tarazi à l’art arabesque féconde-t-elle une quête existentielle qui s’exprime par la littérature où sont ébranlés les fondements de l’écriture classique ? Ecrivain d’expression française, comment façonne-t-il la langue française pour en extraire son essence humaniste, cette même essence qui constitue le tissu de la culture marocaine qu’il s’approprie dans la création littéraire?
L’objectif est de voir dans quelle mesure la rencontre du Levant avec le Maroc modèle et module le renouvellement de la création littéraire chez Gebran Tarazi, et de mettre en valeur l’apport d’une figure de proue du patrimoine culturel libanais dont l’œuvre, qui est au carrefour des cultures, est nourrie de l’altérité culturelle qui la ramène à sa libanité, une libanité francophone humaniste.
Mots-clés: Liban – Maroc – littérature – modernité – art abstrait – francophonie
الملخص
إن الفنان والكاتب اللبناني الفرنكوفوني جبران طرزي متشبع بإرث متعدد المشارب؛ ومنها: الثقافيّة المشرقيّة والمغربيّة والفرنسيّة، وهو ابن عائلة عريقة وطويلة الباع في مجال الحرفيات وتجارة الآثار.
يتميز نتاج جبران طرزي الفني والأدبي بتفاعله مع الاختلاف الثقافي واختلاف الهوية كما والمدارس الأدبية والمفاهيم الفلسفيّة والتّيارات الفنيّة. وهدف الكاتب هو تجاوز الحدود الثقافيّة والتّسامي بها ليعيدها إلى أصلها الواحد. فبالنسبة إليه؛ تتطور عمليّة الابداع من خلال التفاعل الخلاق بين التراث والحداثة. ويتغذى هذا الاتجاه من مصدرين أساسيين، وهما التربية العائلية الفنية التي تلقاها؛ وارتباط عائلته الوثيق بالمملكة المغربيّة وثقافتها وفن الأرابيسك بخاصة، فأسهمت هذه الركائز في تشكيل مفهوم الابداع الفني والأدبي الناقد.
من هنا؛ يتأتى اهتمامنا بإرث المبدع جبران طرزي الأدبي بخاصة إذ يستحق دراسة متنوعة الأبعاد، وسنعرض منها وحسب مقتضيات البحث، بابًا يتعلق بمنظور الرّحلة الذاتيّة الغنيّة التي عاشها الكاتب، متأثرًا ببيئته كما وبالغيريّة الثقافيّة؛ فأثمر هذا التفاعل نتاجات متنوعة الأشكال والمدارس الأدبيّة والتي أضحت بحد ذاتها ذاكرة الثقافات باختلافها في ما بينها.
وتستند هذه الدراسة على إشكاليّة تأثر نتاج جبران طرزي الأدبي بالفن التّجريدي؛ وببعده الوجودي وعلى صدى التّجريد في الحداثة الأدبيّة. وبناء عليه؛ تتألف هيكليّة المبحث إلى شقين، فيُعنى الأول بدراسة بيئة الكاتب البيثقافيّة، وأمّا الشقّ الثاني؛ فيعنى بعرض جولة أفق على آثاره الأدبيّة. وما نذكر هو في خدمة هدفي البحث وهما؛ إبراز وقع الثقافة المغربية في تشكيل وترتيب نظرة المؤلف إلى الأدب، وإبراز جبران طرزي كعلم من أعلام الفكر اللبناني الفرنكوفوني اTنساني.
الكلمات الدالة: لبنان – المملكة المغربية – الأدب – الحداثة – الفن التجريدي – الفرنكوفونية
Introduction
Issu d’une famille levantine passionnée d’artisanat et de commerce des antiquités, connue pour avoir fondé des ateliers d’arts, et pour avoir étalé son talent jusqu’au Maroc où elle s’est installée pendant des années, Gebran Tarazi (1944-2010) eut la chance de s’ouvrir aux différences entre cultures et de s’imposer en tant qu’artiste et écrivain libanais. L’éducation, les principes moraux et les racines identitaires de la famille Tarazi ont suscité son amour pour l’artisanat oriental et pour la culture marocaine. Subjugué par l’humeur de la terre chérifienne, la noblesse des valeurs du peuple marocain, la diversité culturelle, et l’art traditionnel ancré dans les racines de l’Histoire du Royaume, l’œil de l’artiste conçoit d’une manière inouïe cet héritage, où le condensé de la tradition créatrice et de la modernité constitue un tournant dans l’histoire de la francophonie libanaise.
Le projet artistique tarazien à caractère multidimensionnel, fort d’un héritage familial d’envergure internationale, s’enrichit d’expériences artistiques qui vibrent au versant marocain de l’orient de l’artiste, orient pluriel qui surpasse ses propres frontières. Le parcours à la fois artistique et littéraire fait montre de la tendance de Gebran Tarazi au brassage de l’art abstrait chrétien et l’art abstrait islamique, brassage artistique qui fait fructifier une écriture littéraire déroutante parce qu’elle déclenche une question majeure sur les limites, ou mieux, les non limites de la création.
Dans l’objectif de mettre en valeur cette question et de viser la clarté du propos, la présente recherche circonscrit la problématique du pouvoir illimité de la création par une étude de l’inspiration marocaine particulièrement de Gebran Tarazi:
- comment le lien entre Gebran Tarazi et le Maroc s’est-il affiché dans son œuvre?
- Comment son identité s’est-elle sustentée de la culture marocaine? Autrement dit, comment a-t-elle contribué à consacrer l’arabisme culturel, le christianisme et l’orientalisme, ainsi que sa naissance en tant qu’artiste-écrivain?
Nous allons traiter la problématique en deux temps: le premier portera sur la présentation du contexte général qui favorise l’accueil de l’influence marocaine par l’artiste-écrivain; le second se penchera sur sa production littéraire telle qu’elle ensemence la conscience artistique marocaine dans son heureuse rencontre avec les différentes cultures humaines.
- L’Environnement Interculturel De Gebran Tarazi
Il serait important de mettre en relief le parcours familial qui conduit Gebran Tarazi au Maroc, parcours dont les influences sont fructificatrices. Ses attaches familiales datent de l’année 1793, lorsque le père quitte la Turquie et s’installe à Damas, travaillant comme tailleur et brodeur. En 1860, l’arrière-grand-père de Gebran, Dimitri Tarazi, séjourne à Beyrouth où il effectue le commerce d’antiquités et de la publication de cartes postales; ensuite, il manifeste son intérêt à préserver et à diffuser le patrimoine oriental. Aussi a-t-il fondé des ateliers d’artisanat à Beyrouth, à Damas, à Jérusalem et au Caire.
Gebran Tarazi grandit dans une maison au style architectural damasquiné. L’art fait partie du tissu de la vie quotidienne de l’artiste, jusqu’à ce qu’un tournant se produise dans sa famille. En effet, le père, Alfred Tarazi, œuvre à transférer l’entreprise familiale dont il est gérant à l’époque avec son frère, au Royaume du Maroc en 1946. La fondation Tarazi érige l’hôtel Saint-Georges à Casablanca, rue Murdoch; c’est un bel hôtel de cinq étages, inauguré en 1953. Il mérite une couverture médiatique, en raison de sa beauté architecturale mauresque et de son aménagement marqué par le raffinement de l’art islamique. À Rabat, Alfred Tarazi édifie une succursale composée de 25 chambres dont la beauté unique en fait le plus bel hôtel d’Afrique du Nord selon les clients.
C’est à Rabat que la famille Tarazi s’installe et se consacre au commerce. Les deux frères gèrent le magasin Tarazi, spécialisé dans les produits orientaux, au 9, rue Dar Al Makhzan.
Dans le cadre des relations entre le Liban et l’honorable Royaume du Maroc, le grand-père Alfred Tarazi développe une relation d’amitié avec Sa Majesté le Roi Mohammed V. En juin 1959, Sa Majesté le Roi envoie une campagne diplomatique en Orient arabe après l’indépendance ; la famille Tarazi reçut le Ministre Marocain des Affaires étrangères à l’aéroport de Beyrouth. À l’hôtel Alcazar, construit par les Tarazi à Beyrouth pendant l’âge d’or que connaissait alors le Liban, la famille Tarazi accueille Sa Majesté le roi Mohammed V et un certain nombre d’ambassadeurs.
Dans le contexte d’échange de passion pour les arts et le patrimoine, elle offre au palais royal marocain un luxueux diwan damascain, digne de Sa Majesté le Roi. Le divan damascain a été rendu par le Roi sous le conseil des conseillers, car il ne fait pas partie de la culture marocaine. Il fut rapatrié et installé à Beyrouth dans le salon d’Alfred Tarazi, père de Gebran Tarazi.
Quoi qu’il en soit, la culture marocaine imprègne l’éducation culturelle et intellectuelle de Gebran Tarazi. Elle ajoute à ses écrits un caractère unique qui lui a valu une place particulière dans la littérature francophone moderne. Ses œuvres peu nombreuses, mais de facture savante, traversent les différents genres littéraires, à savoir:
- Journal, 1970-1980
- Le Pressoir à olives, roman-récit publié chez L’Harmattan, 1996
- L’essai critique littéraire intitulé Besoin d’Orient, 2007
Gebran Tarazi reçoit son éducation au Royaume du Maroc, où s’enflamme sa passion pour la lecture. La meilleure preuve en est la découverte de la «Librairie Aux Belles Images», avenue Mohammed V à Rabat. Il se lie d’amitié avec le propriétaire de la librairie, qui devint bientôt son guide culturel. Sa référence à la librairie et à l’amitié dans le domaine de la culture fut le point de départ de son amour dévoué pour la philosophie occidentale, la philosophie orientale et pour la littérature mondiale, notamment celle qui porte le sceau de la modernité.
Gebran Tarazi interagit avec la société marocaine à Rabat. Il maîtrise le dialecte marocain et l’art de la conversation. De plus, il est témoin de l’époque du protectorat français et de la célébration de l’indépendance du Royaume en 1956.
L’amour pour le Maroc éveille ses soupçons sur l’existence, l’histoire, les relations humaines, l’amour, l’écriture, la poésie, l’arabisme culturel, l’héroïsme du peuple fort et invincible, le patrimoine, la modernité, la créativité artistique, la réalité et l’imagination, ainsi que le commerce d’antiquités familial, néanmoins qui s’est effondré lors de l’indépendance vu que la plupart des clients étaient des étrangers. En effet, Gebran Tarazi et sa famille rentrent au Liban en 1959 et s’y installent définitivement. Mû par la nostalgie du noble royaume, il y retourne pendant les mois d’été. Ces retours furent émaillés de voyages en France, en Italie, au Yémen, en Irak ainsi qu’à d’autres pays où il collectionne de nombreux objets patrimoniaux.
Au Liban, il poursuit son parcours créatif qui s’est manifesté dans la culture, l’art et la littérature, et qui s’est exprimé par une obsession existentielle du noble Royaume. Dans ce contexte, nous mettrons en lumière les mérites du Maroc dans son œuvre littéraire qui porte l’empreinte de l’art arabesque. Le principe d’abstraction artistique est à la base de son ouvrage Douze saisons (2017), dont les 12 séries de dessins sont inspirées par l’art arabesque et l’art islamique en général.
Il évoque son admiration pour les artistes marocains qui jouissent d’une liberté artistique et d’une indépendance par rapport aux modèles de ce qu’il appelle l’art international et la littérature mondiale, et qui s’inspirent de l’art de la composition géométrique abstraite, avec ses dimensions spirituelles, poétiques et philosophiques.
Ainsi, l’héritage islamique et multiculturel le renvoie à sa tendance orientale qui dépasse les frontières de la tradition, de la géographie et de l’histoire de la guerre au Liban et de la lutte pour l’indépendance.
II- La Culture Marocaine Dans L’œuvre Littéraire de Gebran Tarazi
Gebran Tarazi est en quête de l’Orient en dehors des frontières géographiques et historiques. C’est à l’honorable Royaume du Maroc que l’on doit cette recherche existentielle et le fait qu’elle soit devenue une empreinte de l’héritage culturel. L’écrivain-artiste puise les thèmes de ses œuvres dans l’histoire, la géographie et la culture marocaines, étant motivé par le vœu de voir s’interpénétrer les cultures, sans pour autant qu’elles se confondent l’une dans l’autre. Nous verrons ainsi comment la réalité puise sa puissance dans l’imaginaire.
Ses ouvrages se caractérisent par l’intensité du sens porté autour de l’arabisme culturel, du brassage des cultures et de la transcendance des différences religieuses et culturelles. L’écrivain est loin de l’utopie culturelle : il s’attache à la terre d’accueil où il reçut son éducation. Il est nécessaire de passer en revue le contenu de chacune des œuvres, afin que nous puissions en rendre justice autant que possible.
Journal (1970-1980) :
Journal ne constitue pas une révélation de la vie intime de l’écrivain, mais plutôt un tour d’horizon des espaces qui renferment sa double inspiration, orientale et marocaine. Lorsqu’il en est de la culture marocaine, la mémoire des kiosques disséminés dans les ruelles de l’ancienne ville de Fès et la mémoire des artisans authentiques préservant le patrimoine, semblent exercer un charme sur l’écrivain.
Journal est un témoignage de la beauté de la ville de Fès, beauté qui revient au voile féminin, au mystère, au parfum du safran et à l’art traditionnel qui y cohabite avec la vitalité du présent. Ruelles et rues vibrent de vie. Les portes de la ville s’ouvrent largement au spectateur: le mouvement des chariots commerciaux, l’architecture caractérisée par sa décoration en mosaïque et la beauté des fontaines à eau éblouissent le regard. L’évocation de ce spectacle est reprise dans Journal, mais la répétition est différente d’elle-même. Il est trompeur de penser que Gebran Tarazi se répète: son écriture est un retour qui se renouvelle constamment à lui-même parce que le regard authentique n’a pas de double.
Loin de porter un regard de touriste sur la ville de Fès, il se livre à l’écoute de ce qui la fait vivre profondément. C’était plutôt la ville qui parle à son profond désir de poésie, ville où il vibre à l’art abstrait et à la littérature. Fès le captive vu son mélange religieux et culturel. La diversité de la beauté est un principe de base dans l’esthétique tarazienne. C’est la ville-poésie… n’étant pas avant la poésie, mais la poésie même!
Dans ses mémoires qui remontent au 14 octobre de la même année, il raconte avoir appris à teindre le cuir. Cet apprentissage révèle l’amour des couleurs et la maîtrise de tonalités et des teintes. L’art de la nuance des couleurs se ressent dans les dessins abstraits où la couleur crée des limites entre les formes géométriques. Cette expérience artistique nous ramène à la ville de Fès, où les artisans ont préservé l’artisanat authentique du tannage avec une utilisation habile et créative des nuances des couleurs.
Fès occupe l’écrivain dans un de ses mémoires qu’il écrit en octobre 1971, où il évoque, dans une relation intertextuelle avec la littérature de voyage, les mémoires de l’écrivaine franco-américaine Anaïs Nin qui incarne la vision poétique de la ville et qui semble sortir d’un rêve. C’est la ville qui a conquis le cœur de nombreux écrivains-voyageurs. Selon Anaïs Nin, la ville de Fès est d’une beauté exceptionnelle et déroutante qui frôle l’indicible.
Gebran Tarazi est pleinement conscient de la beauté qui transcende les limites de la raison, car la vie est littérature ; la littérature est poésie qui refait la réalité. L’écrivain cherche à Fès la vérité de l’existence. C’est la ville qui suscite le questionnement et qui garde la sagesse de la beauté. C’est la ville de la non-trivialité et de l’imagination.
Artiste à l’œil savant, Gebran Tarazi évoque la ville de Rabat, terre des révélations qui vont au-delà du conflit entre la vieille ville et la ville moderne: il y voit l’incarnation des aspects complémentaires de la vie qu’ils soient traditionnels ou modernes. Cependant, c’est du parfum historique de la vieille ville, des rues commerciales vivantes, de l’art de converser, des étaux de bijouterie, des boutiques de tailleurs, des vendeurs de réglisse, d’instruments de musique, d’épices et des humbles restaurants qui sentent la viande que se forme l’inclination de l’écrivain levantin pour la ville ancienne. Quant au touriste étranger, selon lui, il ne peut en être autrement: les scènes issues du patrimoine populaire, les mosquées, les tanneurs, les huttes, les conteurs et les récits de mariage traditionnel finissent par le séduire.
De loin, les villes semblent disparaître dans le vaste désert qui se profile à l’horizon. C’est l’univers dans la ville de Rabat… le désert étant un autre univers duquel l’écrivain se sent provenir. L’étendue de sable rappelle le désir infini de trouver la patrie d’origine; ce désir est déclenché grâce à la dimension spirituelle du désert. Le désert est un motif qui est au centre de la littérature et de l’art, et qui se manifeste dans l’écriture littéraire comme dans le souvenir et la musique. C’est la musique du silence et de l’âme. Cet aspect rappelle la vie spirituelle au Maroc, à travers ce qu’on appelle les coins soufis.
Ainsi, Journal montre que Gebran Tarazi est influencé par l’art du tissage de tapis et par les motifs géométriques complexes de la tapisserie bédouine. L’écrivain porte un regard critique sur la nature de l’art bédouin qui porte l’empreinte du nomadisme. Les circonstances de la vie, comme la peur de l’invasion et de la violence entre tribus, nuisent au plaisir artistique des tisserands. L’art bédouin est motivé par le mouvement de la vie, l’ouverture aux horizons, l’état psychologique de l’individu et du groupe comme la joie et par l’état mental comme la contemplation; il a des dimensions sociales, psychologiques et spirituelles.
Dans sa vision réaliste de l’art bédouin, nous percevons le regret et la crainte pour l’avenir de l’artisanat. En effet, cet art créatif finit par disparaître en raison de sa fonction utilitaire. C’est le sort des tapis bédouins qui finissent par être utilisés sous les pieds des humains et qui subissent la pire des profanations. L’art artisanal des peuples nomades est loin qu’il soit apprécié pour sa valeur esthétique. L’écrivain développe sa vision pessimiste d’un art éphémère, éphémère pour toutes les raisons citées. Les motifs artistiques émergent de la dialectique de la continuité et de la fin, de la réalité et de l’imaginaire, du sens esthétique et de la fonction utilitaire. Selon Gebran Tarazi, les produits artisanaux bédouins devraient être appréciés: toute belle création bédouine mérite d’être affichée dans les musées dédiés aux œuvres des grands artistes.
Besoin d’Orient:
Le manifeste Besoin d’Orient est le miroir de l’Orient tel qu’il est ouvert à l’autre. Pour Gebran Tarazi, chaque culture locale fait partie des cultures mondiales, néanmoins ne s’y dissout pas. Reproduire les valeurs héritées sous leur forme rigide, est un fait qui condamne le patrimoine à l’éphémère. C’est ainsi que l’artiste pense la modernité en tant que phénomène d’innovation constante qui s’abreuve à la source, néanmoins avec un détachement même par rapport à la source.
En effet, sa relation avec la culture marocaine émane de son étude des arts orientaux, plus précisément l’art de la décoration islamique. Il découvre alors l’art de la nuance et le mélange des couleurs, ainsi que l’interpénétration des motifs géométriques. Gebran Tarazi fut éduqué à l’art islamique abstrait. Son esthétique ainsi que sa production littéraire soulèvent un intérêt portant sur la nature et les dimensions de l’abstraction artistique et leur rapport à la modernité. Cette vision devient problématique du moment où nous pensons à la manière avec laquelle elle traverse l’écriture littéraire.
Sa tendance à l’art abstrait se transforme en une préoccupation poétique, spirituelle et existentielle qui tourne essentiellement autour de la problématique suivante: est-il possible de créer de l’art moderne tout en restant authentiquement arabe? En effet, la production littéraire et l’art de Gebran Tarazi découlent de cette problématique qui forme une théorie qui lui est propre en art et en littérature. Cette théorie émane de la recherche d’un état d’équilibre entre des pôles contradictoires, et elle produit le concept Qayem-Nayem qui incarne la relation entre la ligne verticale et la ligne horizontale. Cette relation est fondée sur le mouvement, l’harmonie et l’équilibre. Plus le lecteur et le spectateur s’efforcent de saisir la signification de ce principe, plus les contradictions semblent s’entrecroiser, comme si le cycle de vie se renouvelait.
Tout patrimoine est vivant et est prêt à revivre. La créativité assure la continuité du patrimoine et l’empêche de disparaître. Ce que Gebran Tarazi dessine, c’est l’impensé. La créativité exige d’atteindre le pouvoir de la transcendance. Gebran Tarazi étend cette vision sur l’art cinématographique, l’écriture littéraire et la photographie artistique. Il dénonce la production stéréotypée et la répétition qui empêchent de relancer le questionnement.
Dans Besoin d’Orient, il se prononce sur la francophonie et sur ce qu’elle a provoqué en termes d’anxiété culturelle en Afrique, en raison de la crainte de voir l’arabisme culturel se dissoudre dans la culture occidentale. Bien qu’ouverte aux cultures étrangères, la culture marocaine est enracinée dans le patrimoine artistique, grâce au sentiment d’appartenance et à la conscience collective.
Le pressoir à olives:
Ce roman contient l’essence de la vie au Maroc où Gebran Tarazi s’est inspiré de la recherche des racines, de l’identité originelle et du sens de l’existence. Cette quête existentielle reflète son angoisse, elle est au centre de l’intrigue dramatique, où un jeune homme nommé Roufa incarne le personnage de l’écrivain.
Roufa est le fils d’un commerçant artisan de la vieille ville de Rabat. Errant dans les rues pour y trouver des réponses à des questions existentielles, il entreprend des conversations avec ses amis et sa famille et répète ses supplications éperdues auprès du Saint et ermite syrien (syriaque), Siméon le Stylite (389-459). Loin qu’elle soit linéaire, la narration se fait déambulation: elle devient sinueuse, surréaliste et par suite déroutante, elle se déroule au gré de la fantaisie du personnage. Roufa surpasse la réalité et essaye de se ressaisir devant tant d’obstacles qui se résument en une question fondamentale: pourquoi le vrai moi se dérobe-t-il à l’être humain? Les conversations que Roufa entreprend avec ses connaissances, sa famille et Siméon le Stylite, le transforment en un personnage furieux, abattu, révolté et interrogateur. Il est à l’image de l’écrivain.
Roufa est en proie à une crise existentielle qui se manifeste dans sa relation avec les rues de la vieille ville, ces rues que nous assimilons au labyrinthe intérieur de l’être humain ; dans ces rues, il erre dans le marché des bijoux et des parfums et rend visite aux artisans, s’interrogeant dans une vision renouvelée, sur l’importance de la modernité dans la perpétuité du patrimoine.
Le fait de n’adhérer à aucune pensée et de vivre dans le détachement, est le mode d’être de Roufa, ce personnage instable qui est en proie à la confusion. En effet, le désert marocain, où l’horizon sans limites a inspiré l’isolement de Saint Siméon le Stylite, se prolonge jusqu’à la mer Méditerranée, comme si la mer était une extension du désert. Des errances de Roufa résulte l’indétermination perceptive où l’océan et la mer se dissolvent dans un moment de confusion onirique.
Obnubilé par la tourmente existentielle, Roufa est attentif à la fleur de mimosa qui est une source majeure de la teinture du cuir au Maroc, mais qui symbolise notamment l’élégance, la résistance et la liberté.
Le roman reflète l’interaction de Gebran Tarazi avec l’art architectural et la nature qui stimulent son regard d’artiste. La charge descriptive intense met en valeur l’expérience sensorielle du jeune Roufa, liée à son identité: il pense être originaire d’un endroit lointain où la couleur des briques qui recouvre les bâtiments et les clôtures, est répandue. Cependant, cet endroit n’est pas nommé. Il revient au lecteur de mentionner que la couleur des briques rappelle la ville de Marrakech, surnommée la «Ville Rouge», en raison de la couleur chaude, accueillante, réceptive, stimulante des sens. Ailleurs, Roufa note que l’endroit d’où il vient est également vert; c’est une caractéristique distinctive de la ville de Rabat. Comment ne pas évoquer la couleur du désert lointain, alors que le vide imbibé de silence absolu devient sa demeure originelle.
La crise intérieure s’empare de Roufa sur le plan de ses relations humaines, de son sentiment d’amour, de son refus du mariage traditionnel et de la culture de l’art artisanal. Il visite les artisans pour les encourager à produire et à créer des œuvres innovantes ; à son avis, l’artisanat traditionnel marocain et l’artisanat traditionnel levantin doivent être érigés au niveau des musées occidentaux.
Pour le jeune Roufa, la croyance est un sentiment profond et pur envers le Créateur, sentiment plus proche du mysticisme que de la simple prière murmurée, car sa fonction est la purification de l’âme et la transcendance. L’ouverture de Roufa, le chrétien, à l’Islam, et son interaction avec l’appel à la prière, reflètent la sensibilité à la musique de l’âme et à la langue arabe en ce qu’elle est porteuse de la dimension spirituelle.
Le roman aborde également l’aspect historique qui constitue la réalité de l’intrigue dramatique et montre le point de vue de Gebran Tarazi quant au protectorat français. Il évoque l’insistance des héros marocains à obtenir leur indépendance.
Le roman incarne l’ère des transformations dans le domaine de l’artisanat et des échanges commerciaux entre l’Afrique du Nord, le Proche-Orient et l’Europe: ce sont des transformations qui contribuent à la propagation du mouvement d’urbanisation économique et industrielle. Le roman montre l’impact de la fin du protectorat sur le destin des artisans et des antiquaires: l’absence des clients étrangers coïncide avec l’indépendance du Maroc.
L’écrivain défend le principe de l’interculturalisme et du dépassement des différences. Parmi les caractéristiques de son appartenance arabe, l’usage du dialecte marocain ; ainsi les termes: «dar», «djellaba», «hadji», «medersa», «caftan», «bled». A l’image de l’écrivain, Roufa se sert de l’arabisme linguistique pour résister à ce qui ne relève pas de la véritable identité. Maîtriser la langue de l’Autre ne signifie point oublier sa propre identité linguistique.
Miroir de son époque, le roman expose deux aspects représentatifs de la culture marocaine: la musique et la chevalerie. Le jeune homme Idris, personnage du roman, est un joueur de flûte amazigh: il oscille entre son amour pour la musique et la fantasia qui relève de l’héroïsme militaire. Le Nay est un instrument connu dans la musique traditionnelle; la fantasia incarne la puissance et la résistance.
Le pressoir à olives est un témoignage de l’époque qui expose bien d’autres thèmes comme l’art de la conversation, l’amitié, … c’est un roman d’avant-garde qui pose la question du rapport de l’homme avec l’existence et l’identité authentique. L’écriture littéraire est une tentative de traverser et de transcender la dialectique des identités. Il s’agit d’un roman pré-textuel, où le moi du personnage principal Roufa disparait derrière l’impensé, l’inexprimé et l’inachevé.
Sur le plan littéraire, l’écrivain adopte une approche narrative minimaliste. Le style narratif moderne est caractérisé par la répétition de la dialectique des identités: la répétition marque l’effort d’atteindre l’essence de l’existence et la vérité de l’homme. La vérité de l’existence est gardienne de secrets, son langage est suggestif, elliptique, exclamatif et interrogatif parce que l’accès à soi est un mystère.
Les caractéristiques abstraites de l’expression narrative se croisent avec l’art de l’essai et l’art de la rhétorique, pour rappeler Besoin d’Orient à ce propos. Elles sont particulièrement évidentes dans la phrase concise qui correspond à l’art de l’allusion. C’est ainsi que Le pressoir à olives est un roman-récit.
L’architecture narrative met en lumière l’influence du désert et de l’art du zellige marqué par les motifs géométriques stylisés dans l’espace-temps. Les phrases semblent avoir une structure en mosaïque. Le lecteur participe à la quête de l’identité au travers de la recherche de l’unité du texte narratif, à nature poétique, et la recherche de l’unité de sens. Le talent poétique de l’artiste-écrivain émerge, représentant le but ultime de son rêve créatif.
Le titre du roman, Le pressoir à olives, illustre également l’influence du Maroc sur la production littéraire. L’Afrique du Nord, le Maroc en particulier, et la région méditerranéenne, le Liban en particulier, constituent l’espace de la culture de l’olivier qui symbolise la sainteté. Le Maroc et le Liban sont unis par la sainteté. De plus, l’huile d’olive représente la lumière, la vue et la perspicacité, et l’olive symbolise la paix. Quant aux noyaux d’olive, on les broie en vue de les utiliser pour le chauffage domestique. L’ancien pressoir à olives est fait de pierre qui est un élément terreux; la terre est l’espace de l’identité. Le titre du roman évoque un retour à la terre, à la paix et à l’art artisanal cher.
Nous observons le symbolisme du titre par rapport au contenu du roman. Le verbe «presser» indique l’effort exercé pour faire ressortir l’huile, l’essence et la lumière. Nous y voyons le destin du personnage principal, Roufa, qui cherche l’essence de l’homme et de l’existence. N’est-ce pas là la fonction de l’écriture littéraire chez Gebran Tarazi, celle d’un pressoir créatif qui permet de révéler l’essence de l’homme, de l’art et de l’existence?
En conclusion, le tour d’horizon des œuvres montre l’influence de la culture marocaine. L’écriture constitue l’identité à la fois réelle et poétique, et crée le mode d’être entre l’image et le mot, le fixe et le transformé, la question et le mirage de la réponse, le point d’exclamation et le point d’interrogation et l’incarnation effacée par l’abstraction.
Il faut avouer que Gebran Tarazi écrit comme il dessine. Le projet artistique culmine en un projet littéraire en prose qui porte l’essence de la poésie. Et si c’était le contraire? Autrement dit, comment le désir poétique avoué mais non concrétisé, déclenche-t-il le volcan pictural tarazien pendant des années? Comment justifier ce détour si la poésie fut le projet initial de l’artiste?
[1] – professeure titulaire à l’Université Libanaise. Elle y enseigne la langue et la littérature françaises. Chargée de missions académiques, entre autres: membre du comité de pilotage pour la réforme des programmes universitaires; coordinatrice du français et des thèses en cotutelle à l’Ecole Doctorale à l’Université Libanaise.Email: dimahamdan1617@hotmail.com
باحثة في اللغة الفرنسية وآدابها في الجامعة اللبنانية. تولت مهمّات أكاديميّة وإدارية. رئيسة الفرقة البحثيّة وعضو المجلس العلمي ومنسقة ملف المنح الجامعية المشتركة في معهد الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة.