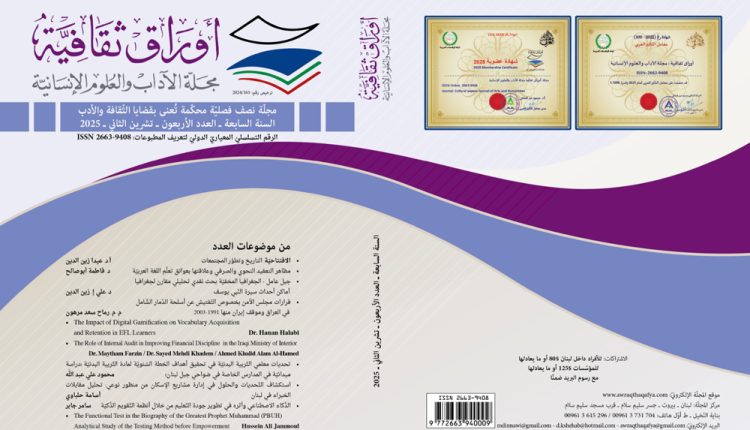Penser le corps à l’école : enjeux esthétiques, pédagogiques et politiques de la danse contemporaine créative au Liban
عنوان البحث: Penser le corps à l’école : enjeux esthétiques, pédagogiques et politiques de la danse contemporaine créative au Liban
اسم الكاتب: Chantal Rabay
تاريخ النشر: 2025/11/14
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 40
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/014022
Penser le corps à l’école : enjeux esthétiques, pédagogiques et politiques de la danse contemporaine créative au Liban
مقاربة الجسد في المدرسة: الرهانات الجمالية والتربوية والسياسية للرقص المعاصر الإبداعي في لبنان
شانتال أنطوان رابيه([1]) Chantal Rabay
تاريخ الإرسال: 17-10-2025 تاريخ القبول 29-10-2025
Résumé turitin :9%
Dans le contexte libanais, le corps demeure un espace de tension entre normes sociales, héritages religieux et désirs d’émancipation. À l’école, il est souvent réduit à un instrument de discipline, marginalisant les formes d’expression corporelle créative. Cet article interroge la possibilité d’intégrer la danse contemporaine créative dans le milieu scolaire libanais comme dispositif esthétique, pédagogique et politique. S’appuyant sur les théories de la corporéité (Merleau-Ponty, Laban, Foucault) et de l’éducation artistique (Dewey, Freire), la recherche analyse la manière dont la danse peut transformer le rapport au savoir, redonner au corps sa dimension cognitive et instaurer une pédagogie de la sensibilité. Elle met en lumière la valeur citoyenne et critique du geste dansé, capable de construire un espace de dialogue entre tradition et modernité, individu et collectif, liberté et éducation. En replaçant le corps au centre du processus éducatif, la danse contemporaine créative apparaît comme un levier de reconstruction symbolique et culturelle au Liban.
Mots-clés :
Danse contemporaine – Éducation – Corporéité – Esthétique – Pédagogie – Liberté – Liban
الملخص: في السّياق اللبناني، يبقى الجسد مساحة توتر بين الأعراف الاجتماعيّة، والموروثات الدّينيّة، والرّغبة في التحرّر. وفي المدرسة، يُختزل غالبًا إلى أداة للانضباط، ما يهمّش أشكال التّعبير الحركي والإبداعي. تبحث هذه الدّراسة في إمكانيّة إدماج الرقص المعاصر الإبداعي في البيئة المدرسيّة اللبنانيّة بوصفه آلية جماليّة وتربويّة وسياسيّة. بالاستناد إلى نظريات الجسد (ميرلو بونتي، لابان، فوكو) ونظريات التربية الفنية (ديوي، فريري)، تحلل الدراسة كيف يمكن للرقص أن يُعيد تعريف العلاقة بالمعرفة، وأن يمنح الجسد بُعده الإدراكي، وأن يؤسس لتربية قائمة على الحسّ والإبداع. كما تُبرز القيمة المواطنية والنقدية للحركة الراقصة بوصفها أداة للحوار بين التقليد والحداثة، وبين الفرد والجماعة، وبين الحرية والتربية. ومن خلال إعادة الجسد إلى مركز العملية التعليمية، يظهر الرقص المعاصر الإبداعي كوسيلة لإعادة البناء الرمزي والثقافي في لبنان.
الكلمات المفتاحيّة: الرّقص المعاصر – التربية – الجسد – الجماليات – البيداغوجيا – الحريّة – لبنان.
Introduction
La danse contemporaine créative demeure quasi absente du système éducatif libanais, où le corps est perçu comme un objet de régulation plutôt que comme un vecteur de sens. Or, dans les pédagogies artistiques contemporaines, le corps constitue un espace de connaissance, de perception et de construction du sens. Cette recherche se propose d’interroger le rôle que pourrait jouer la danse contemporaine créative dans la reconfiguration du rapport entre éducation, corporéité et culture au Liban.
Importance de la recherche
La réflexion sur la place du corps dans l’éducation libanaise dépasse le cadre esthétique : elle interroge les fondements culturels, politiques et confessionnels de la transmission du savoir. Dans un contexte où dominent la parole et le conformisme, la danse contemporaine offre un mode d’apprentissage alternatif ancré dans la sensibilité, la créativité et la liberté régulée. Comprendre l’intérêt de cette intégration permet de repenser le rôle de l’école comme espace de formation du citoyen sensible, critique et autonome.
Cette étude revêt donc une importance à la fois pédagogique, sociale et culturelle, en ce qu’elle propose un modèle d’éducation du corps pensé comme outil d’émancipation et de cohésion.
Problématique
Dans quelle mesure l’intégration de la danse contemporaine créative dans le milieu scolaire libanais peut-elle participer à la formation d’un sujet réflexif et sensible, capable de se réapproprier son corps et de développer un rapport critique au savoir et à la culture ?
Hypothèse principale
L’introduction de la danse contemporaine créative à l’école libanaise pourrait constituer un levier de transformation pédagogique et culturelle. En plaçant la corporéité au centre de l’expérience d’apprentissage, elle permettrait d’unir cognition, émotion et création, tout en ouvrant la voie à une éducation citoyenne fondée sur la sensibilité, la liberté et le dialogue.
Objectifs de la recherche
Cet article se propose d’analyser, dans un premier temps, les représentations culturelles et institutionnelles du corps dans le système éducatif libanais ; d’examiner, dans un second temps, les apports esthétiques et cognitifs de la danse contemporaine créative dans l’apprentissage ; d’évaluer ensuite la portée pédagogique et sociale de la corporéité artistique dans la construction du sujet élève ; et, enfin, de proposer un cadre théorique pour l’intégration de la danse contemporaine créative dans le curriculum scolaire au Liban.
Études antérieures
Cette recherche s’inscrit dans la continuité de plusieurs travaux :
- Les théories du corps discipliné (Foucault, 1975), de la corporéité vécue (Merleau-Ponty, 1945) et du geste poétique (Valéry, 1957).
- Les approches pédagogiques de Laban (1958) et Dewey (1934) sur l’éducation artistique comme expérience cognitive.
- Les perspectives critiques de Freire (1974) sur la pédagogie de la liberté et de la conscientisation.
- Les études récentes sur la danse à l’école (Germain-Thomas, 2017 ; Frimat, 2011 ; Lacince, 2007), qui démontrent la valeur éducative et sociale du geste dansé.
Ces références constituent le socle conceptuel sur lequel repose l’analyse de la présente recherche.
Méthodologie
Cette étude adopte une méthodologie qualitative, théorique et comparative :
- Approche documentaire et analytique des textes philosophiques et pédagogiques portant sur la corporéité et l’éducation artistique.
- Analyse contextuelle du système éducatif libanais, de ses représentations culturelles du corps et de la place des arts dans les curricula.
- Perspective sociologique et esthétique articulant les dimensions symboliques, politiques et pédagogiques du geste dansé.
Cette démarche, à la croisée entre la sociologie de l’art et la pédagogie critique, a pour but de montrer comment la danse contemporaine, dans sa forme créative, peut se transformer en un espace de résistance symbolique ainsi que d’apprentissage de la liberté.
Le corps à l’école libanaise : entre norme et docilité
Dans le milieu scolaire libanais, la danse demeure à la marge, confinée à un rôle périphérique dans les cours d’éducation physique (CNRDP[2],1994), sans légitimité artistique ni valeur cognitive. Cette absence ne procède pas d’un hasard institutionnel, mais révèle un rapport culturel ambivalent au corps : celui-ci est perçu moins comme vecteur de sens que comme objet de contrôle et de régulation. Le corps, au Liban, porte la marque d’une construction historique et confessionnelle où la spontanéité gestuelle suscite la méfiance et où le mouvement libre apparaît comme une transgression symbolique. Or, dans les pédagogies artistiques contemporaines, le corps constitue un espace de connaissance, de perception et de construction du sens ; les théories contemporaines de la corporéité et de l’éducation artistique – de Foucault (1975) à Laban (1958), de Merleau-Ponty (1945) à Valéry (1957) – convergent pour reconnaître le corps comme lieu premier de la connaissance, médiateur entre l’individuel et le collectif, entre le sensible et l’intellectuel. Dans cette perspective, l’introduction de la danse contemporaine créative à l’école ne représenterait pas une simple diversification des activités artistiques, mais une reconfiguration profonde du rapport au savoir et à la culture.
Dès lors, une question fondamentale se pose : dans quelle mesure l’intégration de la danse contemporaine créative en milieu scolaire libanais peut-elle participer à la formation d’un sujet sensible, réflexif et critique, capable de se réapproprier son corps dans un contexte social où celui-ci demeure soumis aux contraintes communautaires, confessionnelles et genrées ?
En posant cette question, il s’agit d’interroger l’école comme espace de production de la normativité corporelle et de penser la danse comme outil de résistance symbolique et cognitive à cette normativité.
Les systèmes éducatifs ayant intégré la danse à leur curriculum, notamment en France à travers le parcours d’éducation artistique et culturelle (Germain-Thomas, 2017), ont démontré la portée formatrice de la pratique chorégraphique. Loin d’être une activité de loisir, la danse y est conçue comme champ de construction esthétique, éthique et sociale (Lacince, 2000). Comme l’a aussi montré Foucault (1975), les institutions modernes participent à la production de « corps dociles », soumis à des logiques de surveillance, de hiérarchisation et de normalisation. L’école libanaise, héritière de ce modèle disciplinaire, tend, elle aussi, à réguler les gestes et les postures, assignant au corps un rôle fonctionnel plutôt que cognitif. Or, la danse contemporaine créative, en privilégiant la sincérité du geste sur la virtuosité, rompt avec cette docilité : elle instaure une pédagogie du corps sensible fondée sur la perception, la liberté et la créativité.
Inspirée de Laban (1958), cette approche pédagogique valorise le besoin naturel de danser, la spontanéité du mouvement et la création collective. Elle transforme l’élève en sujet de sa propre expérience, substituant à la logique de l’imitation celle de l’exploration. En cela, elle introduit dans le champ scolaire une phénoménologie du geste, où le savoir naît de la sensation et de l’incarnation. Par le travail du mouvement, l’élève développe la conscience de soi, la relation à l’autre et la capacité de cohabiter symboliquement : la classe devient un espace chorégraphique de citoyenneté, où le vivre-ensemble se construit par le corps en mouvement (Germain-Thomas, 2017).
Ce déplacement du paradigme éducatif suppose également une mutation de la posture enseignante ; selon Reboul (2007), l’enseignant ne doit pas simplement transmettre le savoir, mais plutôt poser des questions, éveiller la pensée critique chez l’élève, et favoriser un apprentissage où l’élève construit son savoir de façon plus active, ce qui s’apparente à une forme de médiation du processus d’enseignement-apprentissage. Ce dernier devient co-construction du sens, expérience de liberté régulée et d’émancipation critique. Dans une société fragmentée, la danse contemporaine créative offre ainsi un espace d’universalité, où le corps retrouve sa dimension politique et poétique. Ainsi, l’intégrer en milieu scolaire au Liban reviendrait à revaloriser la corporéité comme fondement du savoir et de la citoyenneté. En substituant à la pédagogie de la répétition une pédagogie de l’expérience sensible, elle permettrait de penser autrement la liberté : non comme rupture, mais comme mouvement incarné de la pensée.
Pourtant, une telle réforme suppose de questionner la place du corps dans la société où il demeure un enjeu culturel et politique majeur, situé au croisement du religieux, du social et du symbolique. Dès l’enfance, les gestes, les postures et la manière d’occuper l’espace traduisent un processus d’inculcation des normes. Michel Foucault (1975) a montré comment les institutions — école, famille, église, armée — façonnent des « corps dociles » : disciplinés, silencieux, alignés. L’école libanaise, inscrite dans cette logique, privilégie la parole et la conformité au détriment du ressenti et de la créativité. Le corps y est instrumentalisé comme vecteur de régulation et non comme espace de connaissance.
Or, comme l’ont souligné Valéry (1957) et Merleau-Ponty (1945), le corps constitue la condition originaire de toute expérience du monde. C’est à travers lui que se construit la pensée : « la chair du monde » (Merleau-Ponty, 1945) relie le sujet à son environnement, dans un rapport de co-présence sensible. Le corps dansant, selon Legendre (1978), ne se réduit pas à une fonction utilitaire ; il est signifiant, symbolique, producteur de sens. Refuser à l’élève l’accès à ce langage corporel, c’est l’amputer d’une dimension fondamentale de son humanité. Comme l’écrivait Elia (1992), l’éducation du corps ne doit pas viser la répression des affects, mais leur socialisation consciente : une « civilisation du corps ». Dans cette perspective, la danse contemporaine créative incarne une pédagogie du corps conscient : elle éduque la sensibilité, la perception et la présence à soi.
Cependant, cette approche se confronte à la complexité du contexte libanais. Comme l’a souligné Donahu (2000), dans une société pluriconfessionnelle, la structure communautaire confère au corps une dimension immédiatement religieuse et politique. Les normes de pudeur, de visibilité et de mouvement varient selon les appartenances confessionnelles, façonnant ainsi des comportements corporels différenciés dès l’enfance. Le corps féminin, notamment, concentre la tension entre modernité et tradition. En effet, dans les sociétés où la confession structure la vie publique, le corps devient immédiatement politisé. Danser en public revient à affirmer une autonomie du corps, perçue comme transgressive. Or, cette transgression, replacée dans un cadre éducatif, prend valeur d’apprentissage : elle permet à l’élève de redécouvrir son corps comme espace de sens et de liberté, et non comme objet de surveillance.
La danse contemporaine créative : poétique du mouvement et pédagogie du sensible
La danse contemporaine, en se détachant des modèles performatifs et en valorisant l’expérience sensorielle, offre un cadre adapté à cette réappropriation. Elle désérotise le corps, l’inscrit dans une démarche introspective où le mouvement devient langage. Ce processus développe la conscience perceptive et relationnelle : l’élève apprend à ressentir et à écouter. Ce double mouvement — vers soi et vers l’autre — fonde la corporéité comme expérience du monde (Merleau-Ponty, 1945). L’absence de la danse dans le système éducatif libanais prive ainsi l’élève d’une expérience d’incarnation et d’un accès à une pensée sensible. Dans une société fragmentée par les clivages confessionnels, le corps pourrait redevenir un langage commun, une grammaire du vivre-ensemble. La danse contemporaine créative offre un espace où la différence devient ressource. Chaque geste, chaque présence y est légitime, quelle que soit son intensité ou sa forme. Cet espace symbolique, où la hiérarchie s’efface, porte une dimension politique : il instaure la co-présence, condition d’une citoyenneté vécue. Comme le proposait Dewey (1934), la citoyenneté se fonde sur la participation et le dialogue ; la création chorégraphique collective en est une traduction concrète. L’élève y apprend la coopération, l’écoute et la coresponsabilité, transformant la scène en microcosme social.
Mais la danse est aussi un instrument cognitif. Les neurosciences (Vincent, 2018) ont démontré que le mouvement stimule la plasticité cérébrale et renforce les connexions entre perception, émotion et cognition. Le corps en mouvement devient moteur de pensée. De même, Gardner (2006) a montré que la danse mobilise plusieurs formes d’intelligence : kinesthésique, logico-mathématique, linguistique, spatiale, musicale, interpersonnelle et intrapersonnelle. Elle éveille donc la conscience de soi tout en développant la compréhension d’autrui. Ces dimensions cognitives et affectives, souvent marginalisées par un système éducatif fondé sur la mémorisation, constituent pourtant les fondements d’une éducation intégrale.
Une telle transformation ne peut toutefois advenir sans reconnaissance institutionnelle du corps. Tant que la danse sera assimilée à une activité sportive, elle demeurera privée de sa portée artistique et réflexive. Reconnaitre la danse comme discipline artistique signifierait admettre que le corps sensible produit un savoir à part entière. Cette reconnaissance suppose la formation d’enseignants spécialisés, capables de transmettre une pédagogie du mouvement et non de la performance.
Néanmoins, introduire la danse dans un contexte social encore marqué par la peur du corps demande prudence et progressivité. L’idée de « zone du permis » offre une voie : créer des espaces de liberté encadrée où l’élève peut expérimenter sans transgresser brutalement les normes. Il ne s’agit pas de provoquer, mais d’ouvrir des brèches symboliques. En effet, la notion de « zone du permis désigne un espace intermédiaire entre la règle et la transgression, au sein duquel l’élève est autorisé à explorer, détourner et transformer les cadres normatifs de l’action. Ce concept repose sur l’idée qu’un apprentissage véritable — notamment dans les domaines artistiques — suppose un déplacement symbolique : apprendre ne se réduit pas à répéter, mais à oser expérimenter dans un cadre où l’erreur et l’improvisation sont non seulement tolérées mais encouragées (Svendler Nielsen & Burridge, 2015). La zone du permis peut être ainsi comprise comme une stratégie de résistance douce à l’ordre disciplinaire de l’école. Elle n’abolit pas les normes — elle les reconfigure temporairement, en créant des marges d’autonomie à l’intérieur du système. Loin d’un espace anarchique, elle instaure un contrat pédagogique implicite fondé sur la confiance : l’élève y apprend à se situer entre l’obéissance et la créativité, entre le respect des consignes et l’invention de soi.
La danse devient ainsi un laboratoire de la liberté : un lieu d’émancipation graduelle conforme à la pédagogie critique de Freire (1974), qui vise la prise de conscience et la transformation des structures sociales. En ce sens, la danse contemporaine créative détient une fonction éminemment politique. Elle apprend à penser autrement : à habiter le corps autrement, à habiter le monde autrement. Chaque geste improvisé devient affirmation de subjectivité et résistance à l’automatisme. L’élève découvre, par la liberté du mouvement, la liberté de la pensée ; il expérimente la dialectique entre corporéité et conscience, fondement de la phénoménologie du vécu. Introduite à l’école, la danse devient un outil de formation critique et esthétique, où le geste se fait pensée incarnée.
Pourtant, les représentations sociales de la danse au Liban demeurent un obstacle majeur. Souvent associée à la frivolité, à la féminité ou à l’occidentalisation, elle pâtit d’une stigmatisation culturelle durable. Moscovici (1984) a montré que ces représentations conditionnent les comportements collectifs. Les transformer exige une stratégie à long terme : exposer les élèves à la danse dès le plus jeune âge, multiplier les ateliers, les spectacles, les échanges, afin d’ancrer l’idée que danser, c’est penser. La répétition de l’expérience esthétique modifie la perception et permet la construction d’une culture chorégraphique nationale, affranchie des préjugés. Cette démarche ne s’oppose pas à la tradition ; elle la prolonge. La dabké, danse patrimoniale libanaise reconnue par l’UNESCO comme patrimoine immatériel, reste un pilier identitaire. Cependant, seule la confrontation entre tradition et création peut donner naissance à une pédagogie de la continuité. En intégrant la danse contemporaine à côté de la dabké, l’école offrirait aux élèves la possibilité de réinventer leur héritage en langage contemporain. Ce métissage entre gestuelle quotidienne et mémoire collective renforcerait l’identité culturelle tout en l’ouvrant à l’universel.
Ainsi, la question du corps à l’école libanaise ne se réduit pas à une réflexion sur la danse : elle engage la finalité même de l’éducation. Introduire la danse contemporaine créative reviendrait à faire de l’école un lieu de subjectivation et de liberté, où l’élève construit du sens plutôt qu’il ne reproduit des savoirs. La corporéité devient alors le fondement de la citoyenneté : apprendre à écouter son corps, c’est apprendre à écouter l’autre ; exprimer son mouvement, c’est participer au dialogue social. Le corps, loin d’être un objet de contrôle, devient un médiateur éthique et esthétique entre soi et le monde.
Vers une éducation du corps pensant : enjeux esthétiques et cognitifs
Issue de la déconstruction des codes de la danse classique et moderne, la danse contemporaine créative valorise la singularité du geste, la spontanéité et la subjectivité. Cette dynamique de création non hiérarchique correspond aux fondements d’une éducation contemporaine centrée sur le processus plutôt que sur le résultat. En ce sens, la danse contemporaine créative offre un paradigme pédagogique alternatif : elle déplace la finalité de l’enseignement de la performance vers la connaissance de soi et de l’autre par le corps. L’élève n’y apprend pas à reproduire un modèle, mais à inventer le sien ; il devient auteur de son geste et co-constructeur du sens collectif.
Cette conception du geste comme vecteur de pensée rejoint ce que Louppe (2000) nomme la « poétique du mouvement ». Tout mouvement intentionnel et habité devient acte chorégraphique, qu’il soit issu du quotidien ou de l’imaginaire. Cette approche abolit la distinction entre mouvement noble et ordinaire : marcher, respirer ou tomber peuvent être des actes esthétiques dès lors qu’ils sont porteurs de conscience. Transposée au champ éducatif, cette philosophie du geste ouvre une pédagogie du sensible où l’élève apprend à percevoir la beauté dans l’ordinaire, à faire de son expérience corporelle une matière réflexive. Loin d’un apprentissage technique, il s’agit d’un apprentissage perceptif et symbolique : la danse devient un mode de connaissance incarnée.
Cette pédagogie repose sur plusieurs ruptures fondamentales instaurées par la danse contemporaine. La première concerne la déhiérarchisation du geste. En refusant la perfection formelle, la danse contemporaine légitime la diversité corporelle et expressive. Elle place la recherche de sens au-dessus de la conformité. L’élève n’est plus jugé sur la précision du mouvement, mais sur sa capacité à investir le geste d’une intention. Cette orientation pédagogique valorise la sensibilité et favorise l’auto-évaluation. Elle rejoint ainsi la conception humaniste de l’éducation, qui vise la formation de la conscience plutôt que l’acquisition de compétences normées. La deuxième rupture concerne la transformation de l’espace de la danse. En se libérant du cadre scénique traditionnel, la danse contemporaine a redéfini le lieu de la création. Tout espace peut devenir scène : la rue, la salle de classe, la cour d’école. Ce déplacement spatial a une portée pédagogique majeure. Il rend la création accessible et quotidienne, abolissant la séparation entre art et vie. En contexte scolaire libanais, il permettrait d’intégrer la danse dans les espaces de vie de l’école, transformant ces lieux en territoires d’expérimentation artistique. Ce processus d’appropriation développe chez l’élève une imagination spatiale et une conscience environnementale : il apprend à voir autrement son environnement, à lui donner forme et sens. Une troisième rupture concerne l’hybridité disciplinaire. La danse contemporaine dialogue avec le théâtre, la musique, les arts visuels ou les technologies numériques. Cette transversalité renforce sa pertinence éducative : elle permet de relier le corps à d’autres langages artistiques et symboliques. Dans une société où le numérique occupe une place dominante, cette hybridation ouvre la voie à des expériences pédagogiques innovantes. En associant mouvement, son et image, les élèves développent non seulement leur créativité, mais aussi leur esprit critique face aux technologies. La danse devient alors un outil de réappropriation du virtuel par le corps réel : elle recentre l’expérience sur la présence et la perception, contre la virtualisation des relations humaines. La quatrième rupture porte sur le rapport entre le mouvement et la musique. Dans la danse contemporaine, le corps ne suit plus la musique : il produit son propre rythme, fondé sur le souffle et la gravité. Ce rapport inversé introduit une écoute nouvelle : le danseur apprend à entendre son mouvement. Dans le cadre éducatif, cette autonomie corporelle favorise la concentration, la maîtrise de soi et la conscience temporelle. Le geste devient pensée rythmée. Cette approche fonde une éducation à la présence et à l’attention, compétences essentielles à tout apprentissage.
Sur le plan pédagogique, ces transformations s’inscrivent dans la conception de l’apprentissage comme expérience signifiante. Reboul (1980) définit l’apprentissage comme la capacité à reproduire une conduite adaptée à un contexte pertinent. Or, la danse contemporaine apprend précisément à adapter, à transformer, à inventer : elle mobilise l’intelligence kinesthésique pour comprendre et créer du sens. Frimat (2011) souligne que le geste dansé naît de la sensibilité, non de la simple exécution motrice : la sensation devient source de signification. L’élève apprend à distinguer entre réaction et perception, entre mouvement réflexe et mouvement conscient. Cette distinction, au cœur de la pédagogie du corps sensible, fonde un apprentissage réflexif où le sentir devient une forme de penser.
L’enseignant, dans ce cadre, n’incarne plus une autorité prescriptive mais un guide de l’expérience. Il facilite la prise de conscience, oriente l’attention et encourage la découverte. Cette posture d’accompagnement transforme la relation pédagogique : elle la rend horizontale et dialogique. L’enseignement de la danse contemporaine devient un processus de co-création où chacun participe à la production du sens. Cette configuration pédagogique rejoint la philosophie de l’éducation nouvelle, qui promeut la liberté, la coopération et la créativité comme principes éducatifs. Dans le contexte libanais, marqué par un modèle scolaire encore autoritaire, cette pédagogie du mouvement offrirait une première expérience concrète de la liberté régulée : une liberté expérimentée dans le respect de l’autre et de soi.
Sur le plan collectif, la danse contemporaine créative contribue au développement des compétences sociales et citoyennes. Les ateliers de création partagée favorisent la coopération, la tolérance et la négociation symbolique. Dans cette dynamique, l’élève apprend à articuler son geste à celui des autres, transformant ainsi le mouvement en un espace de co-construction du sens (Gauthier, 2020). Le corps devient un outil de médiation sociale : il enseigne l’écoute, la solidarité et la responsabilité. Cette expérience du collectif est une éducation à la citoyenneté vécue, où le rapport à l’autre n’est pas seulement théorique, mais corporellement ressenti. Dans une société fragmentée, cette pédagogie du corps partagé pourrait servir de modèle pour reconstruire le lien social.
Introduire la danse contemporaine créative dans le système scolaire libanais implique aussi une redéfinition du statut du savoir. Dans la tradition éducative locale, le savoir est associé à la parole et à la mémoire. La danse introduit une forme de connaissance incarnée, non verbale, fondée sur la perception. Elle remet en cause la hiérarchie entre disciplines intellectuelles et corporelles. Cette réhabilitation du corps pensant ouvre la voie à une éducation intégrale, conforme à la vision de l’UNESCO (2014), qui considère les arts comme vecteurs essentiels du développement global. Elle valorise des intelligences souvent marginalisées — kinesthésique, émotionnelle, intuitive — et les reconnaît comme légitimes dans le champ éducatif.
Par ailleurs, la pratique régulière de la danse contemporaine contribue à la santé physique et mentale. Elle favorise la respiration, la détente et la concentration, tout en canalisant les tensions émotionnelles. Dans un pays traversé par des crises sociales et politiques, cette pratique pourrait jouer un rôle thérapeutique et préventif. Elle permettrait aux élèves de transformer leurs émotions en énergie créative, favorisant ainsi la résilience individuelle et collective.
Enfin, l’enseignement de la danse contemporaine doit inclure une dimension critique et esthétique : apprendre à danser, c’est aussi apprendre à regarder. Former l’élève-spectateur, c’est l’initier à la lecture du mouvement, à l’interprétation des signes corporels, à la reconnaissance du geste comme porteur d’idées. Cette éducation du regard prolonge l’éducation du corps : elle développe la sensibilité esthétique et la capacité de dialogue. Elle prépare l’élève à devenir un citoyen capable d’écoute et d’interprétation, qualités essentielles dans une démocratie culturelle. L’intégration de la danse contemporaine créative dans le curriculum libanais ne serait donc pas une réforme marginale, mais une transformation systémique. Elle impliquerait la reconnaissance du corps comme source de savoir, la revalorisation du sensible dans l’éducation et la formation de pédagogues spécialisés. En articulant création, réflexion et collaboration, cette approche permettrait à l’école de devenir un espace de culture vivante, où le geste se fait connaissance, et la connaissance, mouvement. Par la danse, l’éducation libanaise pourrait ainsi renouer avec une vision humaniste et universelle du savoir, où le corps et la pensée ne s’opposent plus, mais s’inventent ensemble.
La danse comme espace de citoyenneté : dimensions sociales et politiques du geste
Réfléchir à l’introduction de la danse contemporaine créative en milieu scolaire libanais revient à interroger les fondements mêmes de l’éducation, du rapport au savoir et de la conception du corps dans la culture. Ce projet ne peut se réduire à une question de curriculum ou de réforme technique : il engage une transformation paradigmatique où le corps devient un opérateur de sens et un instrument d’émancipation. En ce sens, la danse contemporaine créative ne constitue pas un simple enrichissement esthétique du programme scolaire, mais une refondation symbolique de l’acte d’apprendre. Elle met en œuvre ce que Dewey (1934) appelait une « expérience esthétique », c’est-à-dire une expérience unifiante, où le sensible, l’intellectuel et le social se rejoignent dans une activité signifiante.
L’école libanaise, héritière d’un modèle académique fragmenté et vertical, valorise encore le savoir abstrait au détriment du vécu corporel. Cette dissociation entre l’esprit et le corps produit une forme d’aliénation éducative : l’élève apprend à penser sans sentir, à restituer sans expérimenter. La danse contemporaine, en revanche, repose sur une logique inverse : elle apprend à penser en agissant, à comprendre en ressentant. Ce renversement correspond à la conception phénoménologique du corps chez Merleau-Ponty (1945), pour qui la perception constitue la première forme de connaissance. En intégrant la danse à l’école, on réintroduit donc l’expérience vécue au cœur du processus éducatif, en accord avec les théories contemporaines de la cognition incarnée.
Cette transformation du rapport au savoir s’accompagne d’une reconfiguration du rapport à la culture. Au Liban, la culture est souvent envisagée sous le prisme de l’héritage — religieux, communautaire, linguistique — plutôt que comme une dynamique de création. La danse contemporaine créative, par sa nature expérimentale et dialogique, invite à concevoir la culture comme un processus d’invention continue. Elle favorise une pédagogie de la création où chaque élève devient producteur de sens. En explorant le geste, l’espace et le temps, l’élève réinvente son rapport au monde ; il devient acteur de la culture plutôt que simple dépositaire d’un patrimoine. Cette approche rejoint les travaux de Freire (1974), pour qui l’éducation authentique consiste à rendre l’apprenant conscient de sa capacité à transformer la réalité par la praxis. La danse contemporaine, en mobilisant la praxis corporelle, actualise cette conception : elle fait du mouvement un acte critique.
L’enjeu de cette intégration dépasse donc la sphère artistique pour toucher à celle du politique. Foucault (1975) a montré comment les institutions scolaires participent à la fabrication de corps disciplinés, à travers des dispositifs de surveillance et de normalisation. En introduisant la danse contemporaine créative dans ces espaces de contrôle, on introduit simultanément un espace de résistance. Le corps qui improvise, qui explore, qui ressent, devient un corps indocile — non pas au sens de la rébellion, mais au sens d’un corps réapproprié, conscient de sa liberté. La danse, dans ce contexte, est une pédagogie de l’autonomie : elle apprend à l’élève à habiter son corps comme un espace de pensée et non comme un objet d’obéissance.
Cette autonomie corporelle, cependant, ne s’oppose pas à la collectivité ; elle la fonde. La danse contemporaine créative enseigne la co-présence, la synchronisation, l’écoute de l’autre. Dans les ateliers de composition chorégraphique, la coopération ne relève pas d’une contrainte morale, mais d’une nécessité esthétique : aucun geste n’existe sans relation. Cette pratique concrétise ce que Dewey appelait « l’éducation démocratique » — une éducation qui apprend à vivre ensemble par l’expérience partagée. Dans une société libanaise fragmentée par les appartenances confessionnelles, la danse pourrait devenir un espace symbolique de réconciliation, où les différences cessent d’être des frontières pour devenir des matières de création.
La dimension citoyenne de la danse contemporaine prend ici tout son sens. En invitant les élèves à explorer le rapport entre le corps individuel et le collectif, elle les initie à la pluralité. Chaque improvisation devient un acte de dialogue : dialoguer avec soi, avec les autres, avec l’espace. Ce processus corporel prépare à la citoyenneté non par l’enseignement des valeurs, mais par leur mise en acte. Il développe la tolérance, l’écoute, la responsabilité partagée. La citoyenneté, dans ce cadre, n’est plus un contenu à transmettre, mais une expérience à vivre.
Cependant, pour que cette transformation soit effective, elle nécessite une reconnaissance institutionnelle et une formation adaptée des enseignants. Il ne suffit pas d’introduire la danse dans les programmes : il faut lui conférer une légitimité disciplinaire, avec ses objectifs, ses méthodes et ses évaluations spécifiques. L’enseignant doit être formé non seulement à la technique du mouvement, mais à la pédagogie du corps sensible. Il doit comprendre les enjeux esthétiques, symboliques et psychologiques du geste dansé. Ce profil dépasse la simple compétence sportive : il relève d’une posture artistique et éducative intégrée. Dans le contexte libanais, la mise en place de formations universitaires en pédagogie de la danse serait un préalable nécessaire. Elle permettrait de créer un corps enseignant capable d’assumer la double mission de l’art et de l’éducation.
L’intégration de la danse contemporaine créative à l’école soulève également des enjeux culturels et identitaires. La question n’est pas seulement de savoir comment enseigner la danse, mais quelle danse enseigner. Le dialogue entre la danse contemporaine et les formes traditionnelles — notamment la dabké — pourrait constituer un modèle de continuité culturelle. En articulant gestes ancestraux et explorations contemporaines, on éviterait l’opposition stérile entre modernité et tradition. Ce métissage des formes ouvrirait une pédagogie du mouvement enracinée dans le contexte libanais, tout en s’inscrivant dans une perspective universelle. La danse deviendrait ainsi un langage de médiation entre passé et futur, entre local et global.
Cette hybridité, loin de diluer l’identité, la renforce. Elle permet à l’élève de se reconnaître dans une culture vivante, en transformation. Loin d’imposer un modèle occidental de la danse, il s’agirait d’en adopter la philosophie : une philosophie du corps libre, du geste inventif et de la subjectivité reconnue. C’est cette philosophie, plus que la forme, qui pourrait bouleverser l’école libanaise. Elle enseignerait à l’élève que le savoir n’est pas extérieur à lui, mais inscrit dans son corps, dans ses perceptions et dans sa capacité à sentir.
Enfin, l’intégration de la danse contemporaine créative répond à une exigence anthropologique : celle de restaurer la continuité entre le corps, le langage et la pensée. Dans les sociétés modernes marquées par la dématérialisation et la fragmentation de l’expérience, la danse offre une résistance poétique à la perte du réel. Elle réaffirme le primat de la présence sur la représentation. En ce sens, elle rejoint la conception de Valéry (1957) pour qui « la danse est une pensée qui s’exprime par le corps ». Dans le contexte libanais, où le corps est souvent objet de suspicion ou de censure, cette réhabilitation du geste comme langage constitue un acte politique majeur.
La danse contemporaine créative, introduite dans les écoles, pourrait ainsi devenir un modèle d’éducation intégrale. Elle formerait des sujets capables de relier le sensible et le rationnel, le singulier et le collectif, le local et l’universel. Elle enseignerait à l’élève non seulement à bouger, mais à penser le mouvement — à percevoir le monde comme un espace d’interprétation et non de soumission. Dans cette perspective, l’école redeviendrait un lieu d’émancipation et de créativité, fidèle à sa vocation première : former des êtres pensants, sensibles et libres.
En conclusion, promouvoir la danse contemporaine créative dans le curriculum scolaire libanais, c’est affirmer une vision nouvelle du savoir et du vivre-ensemble. C’est reconnaître que l’éducation artistique n’est pas un luxe, mais une nécessité pour toute société qui aspire à la liberté. C’est aussi redonner au corps sa dignité de sujet pensant, capable de dire, d’inventer et de transformer. Comme le résume Louppe (2000), « danser, c’est inscrire dans le mouvement la conscience d’être au monde ». En ce sens, chaque geste dansé en milieu scolaire au Liban serait déjà un acte politique et poétique — un pas vers une société plus ouverte, plus consciente, et plus humaine.
Bibliographie
-1Centre National de Recherche et de Développement Pédagogique (CNRDP). (1994). Restructuration du système éducatif au Liban : Dossier I. CNRDP.
-2Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York, NY : Minton, Balch & Company.
-3Donahu, J. (2000). Les réseaux soufis au Liban. Centre pour l’étude du monde arabe moderne. http://www.cemam.usj.edu.lb/pdf_bulletins/2000/20-5.pdf
-4Elia, B. (1992). Pour une métaphysique de la corporéité. In J.-M. Place (Ed.), Revue d’esthétique, & la danse (p. 22).
-5Félix, J.-J. (2011). Enseigner l’art de la danse : L’acte artistique de danser et les fondements épistémologiques de la didactique de son enseignement. De Boeck.
-6Foucault, M. (1975). Surveiller et punir : Naissance de la prison. Gallimard.
-7Freire, P. (1974). Pédagogie des opprimés. Paris : François Maspero.
-8Frimat, F. (2011). Échauffements. In F. Frimat, Qu’est-ce que la danse contemporaine : Politiques de l’hybride. Presses Universitaires de France.
-9Frimat, F. (2011). Qu’est-ce que la danse contemporaine ? Politiques de l’hybride. Paris : Presses Universitaires de France.
-10Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons (Rev. ed.). New York, NY: Basic Books/Hachette Book Group.
-11Gauthier, C. (2020). Penser la danse contemporaine aujourd’hui : Spectateurs et gestes en quête de sens. La Pensée, 403, 119–132. https://doi.org/10.3917/lp.403.0119
-12Germain-Thomas, P. (2012). La danse contemporaine, une révolution réussie : Manifeste pour une danse du présent et de l’avenir. Éditions de l’Attribut.
-13Laban, R. (1958). Modern Educational Dance. London : MacDonald & Evans.
-14Lacince, N. (2007). Danse scolaire, objet de transgression en éducation. Corps et culture, (5). http://journals.openedition.org/corpsetculture/681. https://doi.org/10.4000/corpsetculture.681
-15Louppe, L. (2000). Poétique de la danse contemporaine. Bruxelles : Contredanse.
-16Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Paris : Gallimard.
-17Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. Dans Social Representations. Cambridge : Cambridge University Press.
-18Reboul, O. (2007). Qu’est-ce qu’apprendre ? Pour une philosophie de l’enseignement. Paris : Presses Universitaires de France.
-19Svendler Nielsen, C., & Burridge, S. (Eds.). (2015). Dance Education around the World: Perspectives on Dance, Young People and Change. London: Routledge.
-20Thorel-Hallez, De la mixité à la coéducation en danse contemporaine au collège : Analyse de l’activité d’enseignant-e-s d’éducation physique et sportive. L’Harmattan.
-21UNESCO. (2014). Promoting sustainable development through arts education. UNESCO
-22Valéry, P. (1957). Philosophie de la danse. In Œuvres (Tome 1). La Pléiade.
-23Vallet, G. (2009). Corps et socialisation. Idées économiques et sociales, 158, 53–63. https://doi.org/10.3917/idee.158.0053
-24Vincent, L. (2018). Faites danser votre cerveau. Éditions Odile Jacob.
[1]– Doctorant à l’Université Jésuite – Beyrouth – Liban – Faculté des Lettres – Département de Critique d’Art et Supervision Artistique -.Email: rabaychantal@gmail.com – telephone : 009613547152
طالبة دكتوراه في الجامعة اليسوعيّة – في بيروت- لبنان كليّة الفنون – قسم نقد الفن والإشراف الفني –
[2] Centre National de Recherche et de Développement Pédagogique, responsable du développement du curriculum libanais.