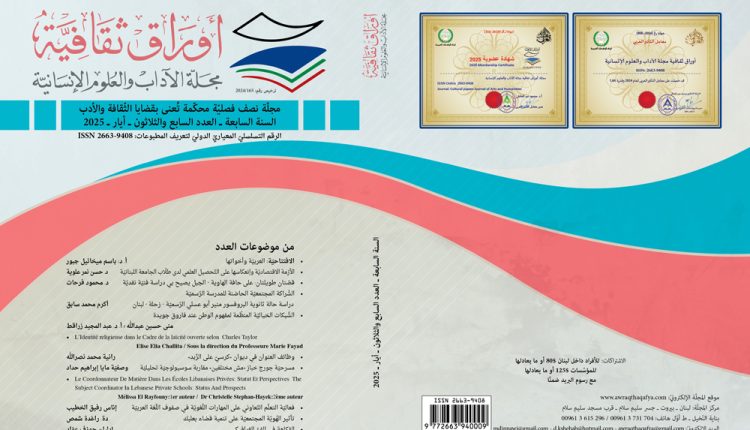عنوان البحث: LE COORDONNATEUR DE MATIÈRE DANS LES ÉCOLES LIBANAISES PRIVÉES : STATUT ET PERSPECTIVES
اسم الكاتب: ميليسا الريفوني، د. كريستل اسطفان حايك
تاريخ النشر: 2025/05/13
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 37
تحميل البحث بصيغة PDFADOI: https://aif-doi.org/awraq/013701
LE COORDONNATEUR DE MATIÈRE DANS LES ÉCOLES LIBANAISES PRIVÉES : STATUT ET PERSPECTIVES
THE SUBJECT COORDINATOR IN LEBANESE PRIVATE SCHOOLS: STATUS AND PROSPECTS
منسق المواد في المدارس الخاصة اللبنانية: النظام الأساسي والآفاق
منسق المادة في المدارس الخاصة اللبنانية: الوضع والآفاق
) [1] ميليسا الريفوني( Mélissa El Rayfouny :1er auteur
)[2]( د. كريستل اسطفان حايك Dr Christelle Stephan-Hayek:2ème auteur
تاريخ الإرسال:15-3-2025 تاريخ القبول: 30-3-2025
ملخص turnitin:10%
في لبنان، يؤدي المنسق دورًا رئيسًا في المدارس الخاصة. فهو مدير تربوي ينسق العمل داخل فريقه، ويقدم الدعم لمعلمي المدارس الابتدائيّة والثانويّة لإثراء ممارسات التدريس. وبهذه الطريقة، لا يكون المنسق “ناقلًا” للمعرفة الإجرائيّة المدونة لتطبيقها حرفيًا. يتضمن عمله جزءًا من التفكير والتحليل والمشاركة، والمناقشة والتفسير والإبداع وإعادة بناء خبرة المعلمين. في القطاع العام اللبناني، كما هو الحال في فرنسا، لا توجد هذه الوظيفة في المدارس. إنّ المستشار التربوي لدائرة التوجيه التربوي والمدرسي (DOPS) في لبنان والمستشار التربوي الإقليمي في فرنسا هما اللذان يدعمان، بالتّعاون مع IEN (المفتش الوطني للتعليم)، فرق التدريس في المدارس الابتدائيّة داخل المهنة. أمّا معلمو المدارس الثانوية، فهم من جانبهم محترفون في التّعلّم يبنون دوراتهم مع مراعاة تباين الطلاب في الفصل والبرامج المتاحة لهم داخل المدارس.
فإلى أي مدى يعتمد هيكل التعليم الخاص في لبنان على تدخل المنسق التربوي مع معلمي المدارس الابتدائيّة والثانويّة وما هي طبيعة عمل هذا الأخير؟
في هذه المقالة نقترح استكشاف أوصاف الوظائف الرئيسة لهذا المتخصص، في ثلاث مجموعات مدرسية في لبنان، من أجل مقارنتها واستنتاج الثوابت التي سنقوم بتحليلها.
الكلمات المفاتيح : منسق مادة، مشرف تربوي، مدرسة خاصة، لبنان، مستشار تربوي، ملف وظيفي
Résumé
Au Liban, le coordonnateur joue un rôle essentiel dans les écoles privées. Il est un responsable pédagogique qui harmonise le travail au sein de son équipe et assure un étayage aux enseignants du premier et du second degré pour enrichir les pratiques pédagogiques. De la sorte, le coordonnateur n’est pas « un transmetteur » des savoirs procéduraux codifiés à appliquer à la lettre. Son travail contient une part de raisonnement, d’analyse, de partage, de discussion, d’interprétation, de création et de reconstruction des savoir-faire des enseignants.
Dans le secteur public libanais, comme en France, cette fonction n’existe pas dans les établissements scolaires. C’est le conseiller pédagogique du Département de l’Orientation Pédagogique et Scolaire (DOPS) au Liban et le conseiller pédagogique de circonscription en France qui, en collaboration avec l’IEN (l’inspecteur de l’Éducation nationale), accompagne les équipes pédagogiques du premier degré au sein de la profession. Les enseignants du second degré, pour leur part, sont des professionnels des apprentissages qui construisent leurs cours en tenant compte de l’hétérogénéité des élèves en classe et des programmes mis à leur disposition au sein des écoles.
Dans quelle mesure la structure de l’enseignement privé au Liban repose-t-elle sur l’intervention d’un coordonnateur pédagogique auprès des enseignants du premier et second degré et quel est le profil de fonction de celui-ci?
Dans cet article, nous nous proposons d’explorer les descriptifs des fonctions principales de ce spécialiste, dans trois congrégations scolaires au Liban, afin de les comparer et d’en déduire des constantes que nous analyserons.
Mots-clés: coordonnateur de matière; supervision pédagogique; école privée; Liban; conseiller pédagogique; profil de fonction
Abstract
In Lebanon, the coordinator plays a key role in private schools. He is a pedagogical manager who harmonizes the work within his team and provides support to primary and secondary school teachers to enrich teaching practices. In this way, the coordinator is not a “transmitter” of codified procedural knowledge to be applied to the letter. His work contains a part of reasoning, analysis, sharing, discussion, interpretation, creation and reconstruction of teachers’ know-how. In the Lebanese public sector, as in France, this function does not exist in schools. It is the pedagogical advisor of the Department of Pedagogical and School Guidance (DOPS) in Lebanon and the district pedagogical advisor in France who, in collaboration with the IEN (the National Education Inspector), support primary school teaching teams within the profession. Secondary school teachers, for their part, are learning professionals who build their courses taking into account the heterogeneity of students in class and the programs made available to them within schools.
To what extent is the structure of private education in Lebanon based on the intervention of a pedagogical coordinator with primary and secondary school teachers and what is the job profile of the latter?
In this article we propose to explore the descriptions of the main functions of this specialist, in three school congregations in Lebanon, in order to compare them and deduce constants that we will analyze.
Keywords: subject coordinator; pedagogical supervisor; private school; Lebanon; educational advisor; job profile
Introduction
De nos jours, la coopération entre les enseignants, véritable pilier pédagogique du XXIe siècle, s’avère essentielle dans les écoles. L’enseignant n’est pas uniquement un professionnel qui applique, en milieu scolaire, des règles méthodologiques. Former les enseignants à la coopération entre collègues, représente un élément clé dans les grands récits des établissements scolaires afin de faire face à des réformes qui se succèdent dans le monde de l’Éducation.
L’enseignant est un praticien en formation continue qui réalise un travail didactique au sein d’une communauté éducative où « la réflexivité de chacun est un ingrédient de l’analyse collective du fonctionnement et un atout majeur dans la régulation des rapports professionnels et du travail en équipe » (Perrenoud, 2012, p. 58). Autrement dit, les enseignants en formation continue sont des praticiens réflexifs qui collaborent au sein de l’école pour améliorer et enrichir par la suite le processus d’enseignement/apprentissage.
Le travail collectif entre collègues acquiert ainsi un sens très large dans le contexte éducatif : il s’agit de la dynamique du travail collaboratif, la recherche-action coopérative, les savoirs en partage et surtout un « empowerment » de tous les enseignants.
Ainsi, ces derniers vont construire ensemble une équipe soudée au sein de l’établissement scolaire et s’adonner eux-mêmes à une forme de pratique réflexive et de métacommunication entre collègues.
Certes, le travail collectif entre les enseignants a besoin de supervision et d’encadrement. Dans le contexte scolaire, ceci est assuré, d’une part, par le responsable du cycle qui modélise et organise ce processus de coopération entre les enseignants. Il permet, en effet, de structurer, au niveau administratif, la collaboration entre pairs au sein de l’école puisque « les leaders ont beaucoup d’influence sur la culture de la collaboration et sont un ingrédient essentiel dans l’amélioration de l’école dans son ensemble » (Savoie, 2008, p. 26). Toujours selon Savoie (2008), le travail collectif entre pairs demande au responsable de cycle de fournir un appui, une assistance et des encouragements aux enseignants.
Le coordonnateur de matière, pour sa part, joue également un rôle essentiel au niveau de la collaboration entre collègues. Son travail au cours de ce processus n’est pas toujours aisé. Perrenoud (2012) cite Jean Rostand pour évoquer le travail du coordonnateur/formateur, qui devrait ainsi « former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les endoctriner, les armer sans les enrôler, leur communiquer une force, les séduire au vrai pour les amener à leur propre vérité et leur donner le meilleur de soi » (Perrenoud, 2012, p. 160). Autrement dit, le coordonnateur de matière prend la figure « d’un entraîneur » qui aide, renforce, encourage, guide, épaule, donne des conseils… au lieu d’être uniquement « un transmetteur » de modèles à appliquer en milieu scolaire. Il peut ainsi s’intégrer dans cette équipe de travail, intervenir dans les échanges et partager sa pratique, mais en gardant son statut de gestionnaire, de guide et d’encadrant.
Dans quelle mesure la structure de l’enseignement au Liban repose-t-elle sur l’intervention d’un coordonnateur pédagogique auprès des enseignants du premier et second degré et quel est le profil de fonction de celui-ci?
La revue de littérature permettra de présenter les rôles du conseiller pédagogique de circonscription et du coordonnateur de matière. Nous présenterons ensuite la méthodologie de travail. Puis, nous procèderons à la comparaison du statut du coordonnateur dans trois congrégations scolaires libanaises afin d’analyser, finalement, les résultats et identifier un éventuel profil commun du coordonnateur de matière au Liban.
1. Revue de littérature
1.1. Le conseiller pédagogique en France
Tant dans la Francophonie européenne que canadienne, Dupriez (2010) avance que le conseiller pédagogique de circonscription joue un rôle essentiel au sein de la communauté éducative. Il intervient auprès des enseignants du premier degré pour accompagner, soutenir et encadrer ces derniers au cours du processus enseignement/apprentissage. Autrement dit, ce spécialiste en Éducation, en collaboration avec l’IEP (l’Inspecteur de l’Éducation Nationale), s’investit dans le travail collectif entre les enseignants afin de modéliser ce processus, donner des directives et guider les enseignants en favorisant l’implantation des nouveaux programmes d’études ainsi que les activités éducatives au sein de la classe. Ainsi, selon Duschene (2016), le conseiller pédagogique devient :
Un formateur au sein de son groupe
Le conseiller pédagogique devrait planifier, préparer et concevoir des dispositifs de formation afin de faciliter le processus d’enseignement/apprentissage. Il devrait également partager ses expériences avec les enseignants et les aider à évoluer au sein de la profession en favorisant les expériences novatrices ainsi que la pratique réflexive.
Un support pour les enseignants
Selon Duschene (2016), le conseiller pédagogique devrait toujours maintenir des relations de collaboration avec les enseignants afin d’identifier leurs besoins et les aider à progresser, et ce, avec discernement.
Un conseiller
Le conseiller pédagogique devrait proposer à ses collègues des solutions aux pratiques problématiques. Duschene (2016) ajoute qu’il pourrait donner des conseils sur le choix du matériel didactique ainsi que les programmes de formation continue.
Un agent du changement
Le conseiller pédagogique devrait encourager les enseignants, selon Duschene (2016), à réaliser des pratiques réflexives et participer à la recherche-action coopérative entre pairs afin d’expérimenter de nouvelles méthodes et enrichir par la suite les pratiques pédagogiques.
Un expert du contenu
Le conseiller pédagogique devrait toujours s’assurer de la mise à jour des connaissances des enseignants et s’assurer de leur capacité de maitrise des pratiques.
Un expert de terrain
Duschene (2016) signale que le conseiller pédagogique devrait avoir des expériences approfondies du travail didactique qui se déroule sur le terrain en tenant compte de l’hétérogénéité des élèves en classe.
D’après ce qui précède, le conseiller pédagogique de circonscription joue un rôle essentiel dans le système français pour aider et guider les enseignants polyvalents. Ce processus d’encadrement, d’assistance et de support est assuré par un autre expert au Liban, notamment dans les écoles privées : le coordonnateur de matière.
1.2 Le conseiller pédagogique au Liban
Selon le Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (CRDP) au Liban, la supervision pédagogique s’est développée dans le secteur privé. Or, cette fonction est remplie par un autre expert dans les écoles publiques au Liban : le conseiller pédagogique.
Le Département de l’Orientation Pédagogique et Scolaire (DOPS) a ainsi sélectionné des conseillers qui devraient assumer des responsabilités dans les écoles publiques. Le référentiel de ce poste a été élaboré et diffusé dans un document officiel qui répertorie quatre domaines d’application des fonctions du conseiller pédagogique.
· Les pratiques professionnelles spécialisées
Selon le référentiel de compétences du CRDP (2017), le conseiller pédagogique aide et guide les enseignants au sein de l’école. Il supervise les méthodes d’enseignement de sa matière, analyse les données pour évaluer par la suite le degré d’efficacité du processus enseignement/apprentissage en fournissant aux enseignants un retour constructif ainsi que des recommandations. Ce spécialiste s’assure que les enseignants respectent les objectifs et les contenus des programmes officiels de sa discipline en répondant aux besoins des élèves. Ainsi, il active la coordination au sein de l’école afin de planifier les programmes éducatifs (le plan annuel, semestriel et hebdomadaire). De la sorte, il « travaille au plus haut niveau de maîtrise de la matière pédagogique dans la planification » (CRDP, 2017, p. 48).
Le conseiller pédagogique est également responsable de la diffusion des nouvelles méthodes pédagogiques ainsi que des ressources mises à sa disposition dans sa matière. Ainsi, il « se tient au courant des activités liées à la discipline » (CRDP, 2017, p. 50). Cet expert de la matière doit, par la suite, soutenir les enseignants dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques éducatives, pour favoriser le développement des programmes éducatifs au sein des écoles publiques, comme « il fournit un plan opérationnel aux activités suggérées » (CRDP, 2017, p. 51).
· Les relations professionnelles
Selon le référentiel de compétences du CRDP (2017), le conseiller pédagogique devrait toujours développer une communication efficace avec les différents partenaires au sein de l’école. Ainsi, il encourage la collaboration et le partage d’expériences entre collègues. Autrement dit, ce spécialiste accompagne les enseignants en vue de favoriser la construction d’un partenariat éducatif au sein de l’établissement scolaire. Il contribue à une coopération positive et favorise la cohésion d’équipe entre les enseignants, ce qui les aide à réaliser des objectifs communs et à enrichir les pratiques pédagogiques.
Le conseiller pédagogique joue également le rôle « d’un médiateur, quand il peut, dans la résolution des problèmes » (CRDP, 2017, p. 53). En effet, il suggère des solutions et propose des alternatives dans différentes situations.
· Le développement professionnel continu
Le conseiller pédagogique doit toujours participer à des formations pour favoriser son développement professionnel. Autrement dit, il doit toujours s’auto-évaluer et avoir un regard réflexif sur ses stratégies de travail afin de repérer les déficits et promouvoir après une auto-régulation de ses pratiques. Ainsi, cet expert de la matière « définit un plan de développement personnel répondant aux besoins de formations observés » (CRDP, 2017, p. 54).
Le conseiller pédagogique propose également aux enseignants, après l’évaluation de leurs pratiques, de participer à des formations pour favoriser leur développement professionnel. Autrement dit, il encourage ces derniers à s’auto-évaluer et à déterminer leurs besoins de formation pour favoriser leur évolution professionnelle. Ainsi, « il stimule les enseignants à participer à des recherches-actions » (CRDP, 2017, p. 57).
· L’éthique professionnelle
Selon le référentiel de compétences du CRDP (2017), le conseiller pédagogique doit toujours diffuser la culture du respect du règlement au sein de l’école. Autrement dit, il applique les lois et incite les enseignants à respecter le règlement intérieur de l’école ainsi que les autorités officielles.
De même, ce spécialiste se doit de montrer une image positive de sa profession en faisant preuve d’enthousiasme et de motivation dans la réalisation de son travail. Il doit également refléter « dans son comportement des convictions positives sur le rôle de l’éducation dans la réforme des sociétés » (CRDP, 2017, p. 59).
Après avoir exposé le profil de fonction, les compétences et les fonctions principales du conseiller pédagogique dans les écoles publiques au Liban, nous présenterons l’historique de la coordination pédagogique dans les écoles privées libanaises.
1.3 Le coordonnateur de matière : historique
Selon Haddad (1998), la coordination pédagogique au Liban remonte à plusieurs décennies visant à améliorer la qualité de l’enseignement au sein des établissements scolaires. Avant les années 1970, le système éducatif libanais était relativement structuré et les communautés religieuses dominaient en général le secteur de l’Éducation au Liban. Le coordonnateur de matière n’avait pas formellement un rôle dans le système éducatif libanais même si les initiatives locales cherchaient à enrichir les stratégies didactiques.
Bou Jaoude & Ghaith (2006) expliquent que la guerre civile en 1975 a profondément affecté l’enseignement au Liban. Des écoles ont été malheureusement détruites ou fermées. Afin d’entraver l’instabilité et les divisions internes du pays surtout dans les années post-guerre (à partir de 1990), la coordination pédagogique a été mise en place dans le système éducatif au Liban.
C’est pourquoi, à la fin de la guerre civile, les Libanais ont entrepris des réformes afin de renouveler le système éducatif et améliorer par la suite le processus enseignement/apprentissage.
Selon les référentiels libanais (Ministère de l’éducation et CRDP, 2017), « la supervision pédagogique s’est répandue dans les écoles privées, au niveau des matières et des classes et est passée […] [au] suivi du travail de l’enseignant, pour l’aider à résoudre les problèmes auxquels il est confronté au cours de ses pratiques professionnelles, pour développer ses performances et l’informer des nouveautés éducatives et scientifiques, en plus pour le préparer et le soutenir dans sa pratique professionnelle » (Ministère de l’éducation et CRDP, 2017, p. 45)
Le ministère de l’Éducation a œuvré en vue de reconstruire une infrastructure éducative de qualité pour les Libanais (crdp.org). Ainsi, une restructuration du système éducatif libanais a été réalisée en 1997 et un grand nombre d’acteurs se sont investis au sein des écoles. Ces derniers possèdent des responsabilités très diverses afin d’assurer, malgré les problèmes sociétaux qui ont surgi ces dernières années, une éducation de qualité aux Libanais. Tous ceux qui s’occupent de la pédagogie au Liban sont aujourd’hui convaincus que les programmes d’enseignement devraient être revus de manière radicale, afin d’implémenter de nouvelles stratégies didactiques qui puissent aider les élèves à progresser au cours du processus enseignement/apprentissage. De là vient le rôle du coordonnateur de matière dans les établissements scolaires privés libanais.
La configuration de notre système éducatif demande la présence du coordonnateur de matière au sein des écoles, afin de faire face aux défis et d’assurer la gestion de l’équipe des enseignants de chaque matière. Il s’agit d’un expert de la discipline qui est capable de suivre de près le travail des enseignants.
1.4. Les types de coordonnateurs dans le monde
Selon Perrenoud (2012), avec les réformes qui se succèdent sans interruption dans le monde de l’éducation, la tâche des enseignants dans les écoles du monde entier se complexifie et le partage des responsabilités devient primordial afin de répondre aux besoins des élèves. C’est pourquoi Kherroubi & Lebon (2017) constatent une évolution dans la division des rôles éducatifs au sein des établissements scolaires dans le monde. Le groupe de professionnels en éducation s’élargit, afin de soutenir les élèves, surtout ceux qui ont des difficultés d’apprentissage dans les écoles inclusives.
Ainsi, selon Kherroubi & Lebon (2017), afin d’organiser le travail collectif entre les enseignants et leur assurer un encadrement, il existe, dans la plupart des écoles dans le monde, différents types de coordonnateurs :
· Le coordonnateur de matière (ou de discipline) qui intervient auprès des enseignants afin de les accompagner, de les soutenir et de suivre leur travail didactique.
· Le coordonnateur de projet qui organise un projet d’établissement et surveille les phases d’exécution du projet (lancement et production). C’est un gestionnaire des équipes de travail entre les enseignants dans l’avancement du projet.
Selon Bourgeois (2010), tous les coordonnateurs jouent un rôle très important pour favoriser la réussite éducative au sein des établissements scolaires. En plus de leurs responsabilités professionnelles spécifiques, le coordonnateur de matière et le coordonnateur de projet devraient toujours favoriser la construction d’une équipe soudée entre les enseignants où chacun aurait confiance en ses capacités et serait capable de donner le meilleur de lui-même. Ils devraient également développer chez les enseignants la capacité d’insertion professionnelle pour favoriser la cohésion sociale au sein du groupe.
Mais, il ne faut pas nier que les écoles dans le monde sont très diversifiées. C’est pourquoi, ces différents spécialistes ne sont pas nécessairement tous présents dans chaque école. Ainsi, chaque établissement scolaire possède une structure bien déterminée. Le coordonnateur de matière occupe, par exemple, une place très importante dans les écoles libanaises du secteur privé.
Nous présenterons, dans ce qui suit, la méthodologie de recherche que nous adopterons afin d’identifier le profil du coordonnateur de matière au Liban.
2. Méthodologie
Comme les textes officiels du CRDP ne développent pas le profil de fonction du coordonnateur de matière dans les écoles (privées) au Liban, nous nous sommes penchée sur des documents élaborés par des établissements scolaires privés libanais. Nous voulons ainsi explorer les descriptifs des fonctions du coordonnateur de matière afin d’en tirer le rôle spécifique de ce dernier.
Dans cette perspective, notre recherche a été menée dans trois congrégations religieuses libanaises, qui dirigent des groupes d’établissements scolaires. Chacune de ces congrégations possède un bureau pédagogique qui a élaboré, au fil du temps, des textes administratifs et pédagogiques. Nous avons trouvé, dans ces documents, un profil de fonction du coordonnateur de matière pour chacune des congrégations.
Une étude comparative a été appliquée par la suite dans notre travail de recherche. Selon Verdalle, Vigour & Le Bianic (2012), réaliser des réflexions sur des particularités de deux ou trois éléments nous permet de déterminer les points de similarités et de différences « en faisant appel à des échelles d’analyses contrastées » (Verdalle, Vigour & Le Bianic, 2012, p. 5). Ceci nous permettra de tirer une conclusion à partir d’un rapprochement méthodologique.
Ainsi, notre étude propose de comparer d’abord les différentes fonctions de ce spécialiste dans les trois congrégations retenues (que nous désignerons respectivement par A, B et C) afin d’identifier, dans un deuxième temps, les écarts et les constantes et en déduire, enfin, le profil du coordonnateur de matière au Liban.
Les textes administratifs et pédagogiques de A et de B, sur lesquels se basent notre étude, sont des documents numériques disponibles en ligne par les bureaux pédagogiques de ces congrégations religieuses. Ils ont été publiés par des spécialistes et ont été mis à jour en 2024 et en 2025. Le texte administratif de C est un document sur papier, qui a été publié par le bureau pédagogique de cette congrégation en 2014.
A a été fondée en Orient en 1831 et comportait des religieuses. À cette époque, il y avait une hostilité à l’égard de l’éducation des filles. Mais, grâce à des missionnaires venus d’Amérique, la vie religieuse féminine s’est répandue, notamment sous sa forme cloitrée. Ouvrir des écoles catholiques autant pour les filles que pour les garçons était devenu essentiel pour sauvegarder la foi religieuse et l’instruction. De nos jours, cette congrégation dirige vingt-huit écoles catholiques ainsi que diverses institutions au Liban.
B, pour sa part, a été fondée en 1695 au Mont-Liban, comme émanation de l’Église antiochienne syriaque maronite, par quatre jeunes maronites d’Alep. Cette congrégation est devenue un ordre pontifical en 1732 et un modèle pour la législation maronite et pour l’établissement d’autres ordres monastiques pour les Chrétiens d’Orient. Cette congrégation compte cinquante monastères au Liban, quatorze écoles catholiques, deux hôpitaux, une université et plusieurs institutions.
C, finalement, est devenue apostolique en 1940 au Liban. La vie religieuse de cette congrégation reste toujours reliée à ses commencements. Après leur exode de la Syrie et leur installation définitive au Liban, les monastères de cette congrégation se sont multipliés surtout au Nord et au Keserouan. Ainsi, C possède aujourd’hui, au Liban, huit établissements scolaires ainsi que vingt-neuf couvents et maisons qui offrent aux Libanais un enseignement de qualité, ainsi qu’un service hospitalier, social paroissial et culturel.
3. Comparaison du statut du coordonnateur libanais dans trois congrégations scolaires au Liban
Dans cette partie, nous présenterons l’étude comparative du rôle du coordonnateur libanais dans les trois congrégations choisies, ce qui nous permettra de répondre à la problématique posée dans notre article. Nous exposerons, par la suite, la discussion et l’analyse des résultats obtenus qui justifient le but de notre recherche.
Nous avons choisi de comparer les contenus des documents étudiés à divers niveaux. C’est ainsi que nous allons mettre en regard :
1. La définition même de la fonction de « coordonnateur de matière »;
2. Les diplômes et l’expérience requis;
3. Les compétences requises;
4. Les fonctions didactiques attendues;
5. Les fonctions évaluatives attendues;
6. Les fonctions formatives attendues;
7. Les fonctions relationnelles attendues;
8. Les fonctions administratives attendues.
|
|
A |
B |
C |
|
1. Définition |
Le coordonnateur de matière est un responsable pédagogique nommé par le chef d’établissement. Il collabore avec les responsables de cycles et les autres coordonnateurs. |
Les coordonnateurs forment un groupe de professionnels nommés par le recteur de l’école. |
Le coordonnateur de matière est généralement un membre de l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire nommé par la direction. Il collabore avec le chef d’établissement, les responsables de cycles et les autres coordonnateurs (les membres du conseil pédagogique). |
|
2. Diplôme.s et expérience |
· Licence d’enseignement dans sa matière. · Dix ans d’expérience au minimum. |
|
· Licence d’enseignement dans sa matière. · Expérience dans l’enseignement de sa matière. · Participer à des formations qui sont étroitement liées à sa matière, la gestion de l’équipe, la coordination, la technologie, les nouveautés des programmes de sa discipline… pour favoriser son développement professionnel. |
|
3. Compétences requises |
· Le sentiment d’appartenance à son école · Le sens de la coopération et de la collaboration · Les compétences relationnelles · La gestion d’équipe · Le discernement scientifique · Le dynamisme, la disponibilité et la créativité · La maitrise de la langue de sa discipline et la fluidité verbale |
|
· L’intelligence · Le dynamisme · La bienveillance · La gestion d’équipe
|
|
4. Fonctions didactiques |
· Assurer la coordination hebdomadaire et veiller à la continuité et la cohérence des programmes éducatifs adoptés par l’établissement scolaire dans les différents niveaux.
· Fixer avec les enseignants les objectifs d’apprentissage de chaque niveau et guider ces derniers dans l’élaboration de la progression annuelle.
· Prévoir er gérer les ressources matérielles et numériques mis à sa disposition pour sa matière et les partager avec les enseignants.
· Collaborer avec les membres de son équipe afin d’implanter de nouvelles stratégies didactiques pour enrichir les pratiques pédagogiques et aider les élèves à progresser au cours du processus enseignement/apprentissage.
|
· Assurer la coordination hebdomadaire avec les enseignants afin d’organiser le processus enseignement /apprentissage. · Planifier les programmes éducatifs avec les enseignants de chaque niveau (le plan annuel, semestriel et hebdomadaire). · Partager les ressources matérielles et numériques avec les enseignants et inciter ces derniers à utiliser le matériel mis à leur disposition afin de faciliter le processus enseignement /apprentissage. · Améliorer la qualité de l’enseignement de la matière concernée.
|
· Assurer la coordination horizontale et verticale avec les enseignants de sa discipline.
· Vérifier la progression annuelle et les objectifs d’apprentissage avec les enseignants de chaque niveau.
· Partager les ressources matérielles et numériques avec les enseignants afin de faciliter le processus enseignement/apprentissage.
· Encourager les enseignants à enrichir les stratégies didactiques des enseignants pour améliorer le processus enseignement/apprentissage
· Communiquer le calendrier des examens aux enseignants et élaborer les critères d’évaluation avec eux. · Participer avec les enseignants à l’évaluation des manuels scolaires à la fin de chaque année académique. · Discuter avec les enseignants le niveau d’acquisition des élèves et les difficultés qu’ils ont rencontrées dans l’enseignement. · Intégrer la pédagogie différenciée avec les enseignants dans le processus enseignement /apprentissage. · Vérifier les cahiers des élèves ainsi que les évaluations corrigées par les enseignants. · Identifier le niveau d’acquisition des élèves et leurs difficultés d’apprentissage en collaboration avec les enseignants. |
|
5. Fonctions évaluatives |
· Donner des conseils aux enseignants ainsi que des remarques constructives au cours des visites de classe périodiques pour aider ces derniers à évoluer au sein de leur profession.
· Remplir une fiche d’observation et la présenter en fin d’année à la direction avec le profil de chaque enseignant. · Faire un suivi régulier des évaluations formatives et sommatives des élèves et vérifier les épreuves avec les enseignants avant de les partager avec le responsable du cycle afin de discuter les critères d’évaluation. · Faire le point sur les résultats scolaires et revoir les copies corrigées afin d’identifier le niveau d’acquisition des élèves. · Remettre à la direction un bilan trimestriel de son plan d’action et un bilan annuel du profil de l’enseignant. |
· Superviser les enseignants grâce aux visites de classes périodiques pour évaluer la progression des élèves ainsi que les stratégies didactiques des enseignants.
|
· Faire des visites de classes périodiques afin d’évaluer les méthodes d’enseignement (le coordonnateur donne ses remarques constructives à l’enseignant au cours de l’entretien qui suit la visite de classe).
· Vérifier les cahiers de bord ainsi que les fiches de préparation des enseignants de chaque niveau.
|
|
6. Fonctions formatives |
· Proposer des formations aux enseignants pour favoriser leur croissance professionnelle. |
· Former les enseignants et organiser des sessions de formation et de développement (ateliers ou séminaires professionnels) pour les enseignants. |
· Assurer une formation continue aux enseignants en collaboration avec les responsables de cycles. (séminaires ou ateliers professionnels). |
|
7. Fonctions relationnelles |
|
· Encadrer les enseignants dans la résolution des problèmes complexes. |
· Résoudre des problèmes complexes en collaboration avec le responsable du cycle étroitement liés à sa matière et nécessitant son intervention. |
|
8. Responsabilités administratives |
|
· Assister le recteur dans les entrevues et la sélection de nouveaux enseignants. |
· Partager avec les responsables de cycles la planification des programmes éducatifs de sa discipline (le plan annuel, semestriel et hebdomadaire) qui ont été réalisés avec les enseignants de chaque niveau. · Vérifier la liste des manuels scolaires de chaque niveau avec les responsables de cycles à la fin de chaque année académique. |
4. Analyse des résultats
Après la mise en regard des fonctions du coordonnateur de matière dans les trois congrégations qui forment l’objet de la présente étude, nous passons à l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus, afin de répondre à la problématique posée.
A la suite de l’exploitation des fonctions du coordonnateur de matière, nous pouvons constater les points communs suivants, qui figurent dans les textes des trois congrégations libanaises :
Le coordonnateur de matière est nommé par la direction et il est généralement un membre de l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire. Les fonctions de ce dernier sont les mêmes dans les trois congrégations libanaises mais elles sont présentées d’une façon différente. Ainsi, elles reposent sur :
Le travail didactique du coordonnateur de matière avec les enseignants
Les trois congrégations ont expliqué que le coordonnateur de matière doit avoir une connaissance détaillée et approfondie du programme. Ses fonctions didactiques s’articulent sur la planification et l’organisation du processus enseignement/apprentissage (le plan annuel, semestriel et hebdomadaire) avec les enseignants. Les trois congrégations ont exposé également la nécessité de partager les ressources matérielles et numériques avec les enseignants pour enrichir les stratégies didactiques. Le coordonnateur coopère avec ces derniers et assure une coordination hebdomadaire aux enseignants afin de les soutenir et de les accompagner dans l’enseignement.
La formation continue des enseignants
Le coordonnateur de matière a une connaissance des méthodes d’enseignement efficaces dans sa matière et il aide les enseignants à développer leurs compétences de diagnostic et leurs stratégies didactiques. Ainsi, cet expert de la matière assure à ses enseignants des formations pour favoriser leur développement professionnel (des séminaires par exemple). Il encourage ces derniers à enrichir leurs méthodes d’enseignement.
L’évaluation à visée formatrice
Pour les enseignants : Le coordonnateur de matière fait des visites de classe périodiques pour évaluer les méthodes d’enseignement. Il évalue les enseignants objectivement et sa supervision a pour but de guider ces derniers au sein de la profession.
Pour les élèves : Cet expert de la matière fait le suivi régulier de la progression des élèves. Il fixe avec les enseignants les critères d’évaluation et revoit les copies corrigées afin d’identifier le niveau d’acquisition des élèves.
Après avoir présenté les points conjoints entre les trois congrégations libanaises sur le rôle du coordonnateur de matière, nous exposerons, dans ce qui suit, les points de divergence dans les trois congrégations libanaises :
A et C ont signalé les aptitudes requises pour être coordonnateur dans leurs écoles. Ces aptitudes sont presque les mêmes dans les deux congrégations : le coordonnateur de matière doit avoir une licence d’enseignement dans sa matière et une expérience dans l’enseignement. Il doit posséder des compétences bien déterminées (responsable, dynamique, intelligent…) afin de gérer son équipe et collaborer avec les membres de son groupe. Il est notable que B ne fait pas mention de ce point mais cette congrégation a signalé que les coordonnateurs au sein de ses écoles sont des professionnels. Autrement dit, les coordonnateurs qui se trouvent dans les écoles de cette congrégation sont des personnes qui exercent leur métier d’une manière très compétente. Ce qui implique cette absence.
B et C ont ajouté que le coordonnateur doit être capable d’arbitrer les conflits de travail qui sont étroitement liés à sa matière. Nous notons que le plan relationnel de sa fonction n’est pas mentionné dans le texte proposé par A. Or, selon le référentiel de compétences du CRDP (2017), la gestion des conflits est une fonction essentielle du coordonnateur de matière. Ainsi, afin de favoriser un environnement de travail amical et rassurant entre les enseignants, cet expert de la matière devrait « gérer calmement et patiemment les conflits et les problèmes imprévus » (Ministère de l’éducation et CRDP, 2017, p. 31).
B est la seule à signaler le rôle du coordonnateur de matière dans l’assistance du recteur au niveau des entrevues et de la sélection de nouveaux enseignants. Or, le côté pédagogique/didactique du recrutement d’un enseignant de la matière relève du coordonnateur selon les référentiels officiels (Ministère de l’éducation et CRDP, 2017) puisque le superviseur pédagogique examine les demandes en collaboration avec la direction et accompagne les différentes étapes de l’étude, selon le besoin.
La seule congrégation qui a mentionné que le coordonnateur de matière partage avec les responsables de cycles la planification des programmes éducatifs de sa discipline est C : le coordonnateur réalise le suivi de son travail avec eux et vérifie également la liste des manuels scolaires à la fin de chaque année académique.
Notre étude comparative a ainsi montré que le profil de fonction du coordonnateur possède des constantes entre les différentes écoles, malgré les divergences qui peuvent exister au niveau de certains détails. Le coordonnateur joue un rôle très essentiel au sein des établissements scolaires privées pour garantir la qualité de l’enseignement ainsi que l’implication des programmes éducatifs de sa matière dans les écoles. Il est un spécialiste qui agit comme un lien entre les enseignants, les élèves et l’équipe administrative de l’école en veillant à ce que les objectifs d’apprentissage soient atteints d’une manière interactive, cohérente et efficace.
Notre recherche nous a permis également de démontrer que le coordonnateur de matière accompagne les enseignants dans la mise en œuvre et l’enrichissement des stratégies didactiques, favorise la formation continue et le partage d’expériences entre collègues ainsi que l’harmonisation des méthodes d’enseignement dans sa discipline. Ainsi, cet expert de la matière occupe une place très importante dans le système éducatif diversifié libanais, accompagnant les enseignants et les aidant à adapter leurs pratiques en fonction des capacités de leurs apprenants et des spécificités de leurs établissements scolaires.
5. Synthèse et recommandations
Notre étude comparative du statut du coordonnateur libanais dans les trois congrégations, nous a permis de déduire que ce dernier possède des fonctions très variées au sein de l’école (didactique, évaluative, formative, relationnelle et administrative) afin d’aider les enseignants à évoluer au sein de la profession. Il collabore également avec le responsable de cycle afin d’assurer un suivi éducatif des programmes de sa matière dans les différents niveaux. Le rôle du coordonnateur de matière s’avère ainsi primordial au sein de l’établissement scolaire libanais pour actualiser la pratique professionnelle.
Néanmoins, nous avons pu remarquer que le statut du coordonnateur de matière varie d’un établissement scolaire à un autre, vu qu’il est étroitement lié à la structure de l’école, au programme adapté, aux ressources ainsi qu’à la politique de chaque établissement scolaire.
Nous pouvons également ajouter que la majorité des écoles n’explicitent pas le rôle du coordonnateur de matière dans le sens où il n’existe pas, dans ces établissements, de profil de fonction clair et consultable pour cette fonction.
Ainsi, puisque le Liban abrite une majorité d’écoles privées (1552 écoles privées contre 1228 écoles publiques, selon les statistiques du CRDP en 2023) qui accueillent la grande majorité des élèves (72 % des élèves, selon les statistiques du CRDP en 2023) et que chacune a sa propre structure administrative et pédagogique, le métier du coordonnateur de matière n’a pas toujours un statut officiel.
Dans cette optique, nous exposerons quelques recommandations et suggestions suite à notre recherche empirique :
· L’unification du statut du coordonnateur de matière
L’unification du statut du coordonnateur de matière dans les écoles privées au Liban pourrait constituer une étape importante pour améliorer la gestion pédagogique, la qualité de l’enseignement et la coopération entre les établissements scolaires privés. Elle nécessite une approche équilibrée qui tiendrait compte de la diversité des systèmes éducatifs, des structures organisationnelles de toutes les écoles et des réformes en cours. Selon Brière & Simonet (2021), une collaboration entre ces établissements scolaires pourrait « solliciter une réflexion professionnelle collective par l’élaboration de significations partagées et discutées » (Brière & Simonet, 2021, p. 50). Ceci conduirait à clarifier le rôle du coordonnateur de matière et à élaborer un modèle « flexible », qui engloberait les spécificités des diverses écoles privées.
· L’échange entre les bureaux pédagogiques des écoles et le CRDP
L’échange entre les bureaux pédagogiques des écoles et le Centre de Recherche et de Développement Pédagogique (CRDP) est extrêmement important en termes de collaboration, afin de réaliser une mise à jour des fonctions du coordonnateur de matière et d’unifier les responsabilités de cet expert. Ceci permettrait de garantir l’efficacité, la pertinence et l’actualisation des pratiques pédagogiques du coordonnateur de matière au Liban, comme cela renforcerait la coopération entre les différents acteurs du système éducatif, surtout entre les secteurs privé et public, en vue d’améliorer les ressources pédagogiques et soutenir la formation continue des enseignants. Selon Perrenoud (2012), un tel échange réflexif entre les différents partenaires permet de répondre « aux enjeux du changement qui sont multiples, de la réussite de l’action la plus technique au rapport au monde » (Perrenoud, 2012, p. 145)
· La reconnaissance des fonctions du coordonnateur de matière au niveau national
La reconnaissance des fonctions du coordonnateur de matière officialiserait non seulement son rôle, mais aussi sa contribution essentielle à la structure du système éducatif. Elle permettrait de clarifier les fonctions de ce spécialiste afin d’assurer une cohérence au niveau national puisque, selon Rached (2022), la situation pédagogique au Liban est soumise à des contraintes de tensions de diverses formes, qui exigent, tous les quatre ans, une mise à jour des différentes fonctions de tous les spécialistes en Éducation, afin d’aboutir à une vision pédagogique commune.
Conclusion
Ainsi, grâce à notre étude empirique, nous pouvons conclure que le coordonnateur de matière, loin d’être un dictateur qui impose ses stratégies de travail aux enseignants, est, au contraire, un formateur et un conseiller qui aide ces derniers et les accompagne au cours du processus enseignement/apprentissage.
Or, comme nous l’avons déjà mentionné, la formation continue des enseignants est un moyen important pour favoriser la croissance professionnelle et celle-ci relève des fonctions du coordonnateur de matière. De la sorte, former les enseignants à la professionnalisation est un facteur essentiel au sein de l’innovation pédagogique qui contribue, au fur et à mesure, à une éducation de qualité.
Or, nous pouvons nous demander quel est le type de formation qui permettrait d’instaurer une dynamique collective entre les enseignants et qui les aiderait à devenir des praticiens réflexifs dans leur milieu de travail.
Par ailleurs, que devrait faire le coordonnateur pour engager les enseignants dans le processus de formation afin que ces derniers parviennent à s’auto-évaluer et auto-réguler, par la suite, leur enseignement?
Bibliographie
Corpus
https://www.sioufi.sscc.edu.lb/Le-coordonnateur
https://ccj.edu.lb/fr/content?id=8
https://www.solidarity.org.lb/fr/our_partners/lordre-libanais-maronite/
Bureau pédagogique des Sœurs Antonines. (2014). An Nizam laam li madares jamiiat al Rahibat al Antounyat. Daleel al mouaallem.a wal mounassek.a.
Références
BouJaoude, S., & Ghaith, G. (2006). Educational reform at a time of change: The case of Lebanon. In Education reform in societies in transition (pp. 191-209). Brill
Bourgeois, F. (2010). Définir la Réussite éducative? Cahiers de l’action, 1, 57-72.
Brière, F. & Simonet, P. (2021). Développement professionnel et co-construction de savoirs de métier d’étudiants stagiaires dans l’activité conjointe avec le formateur-chercheur : analyses didactique et clinique de l’activité d’auto-confrontation croisée. Éducation & didactique, 15, 49-76.
De Verdalle, L., Vigour, C., & Bianic, T. L. (2012). S’inscrire dans une démarche comparative : enjeux et controverses. Terrains & travaux, (2), 5-21.
Duchesne, C. (2016). Complexité et défis associés aux rôles de conseiller pédagogique. McGill Journal of Education, 51(1), 635-656
Dupriez, V. (2010). Le travail collectif des enseignants : au-delà du mythe. Travail et formation en éducation, 7.
Haddad, K. (1998). Liban : quels défis pour l’école? Revue internationale d’éducation de Sèvres, 17, 69-77.
Kherroubi, M., & Lebon, F. (2017). Regards sur les mondes professionnels de la « co-éducation ». Introduction au dossier. Les Sciences de l’éducation – Pour l’ère nouvelle, 50 (4), 7-23
Ministère de l’éducation et CRDP. (2017). Les Cadres Référentiels. Soutenir un enseignement de qualité au Liban. Ministère de l’éducation et CRDP.
Ministère de l’éducation et CRDP. (2023). Statistical Bulletin. 2022-2023. Ministère de l’éducation et CRDP.
Perrenoud, P. (2012). Développer la pratique réflexive dans le métier d’enseignant. ESF
Rached, E. (2022). Le système scolaire libanais, une singularité à toute épreuve. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 90, 23-27.
Roberge, G. D. (2010). Une co-construction de la réussite. Le cas des expériences de formation en groupe de futurs enseignants. Travail et formation en éducation, 6.
Savoie, A. (2008). Les déterminants de la collaboration entre enseignants lors de la planification de l’enseignement selon le Programme d’indicateurs du rendement scolaire (PIRS), Évaluation de l’écriture III, 2002. Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa.
[1] – طالبة دكتوراه في علوم التربية في جامعة الروح القدس الكسليك، كلية الآداب والعلوم- جونية – لبنان