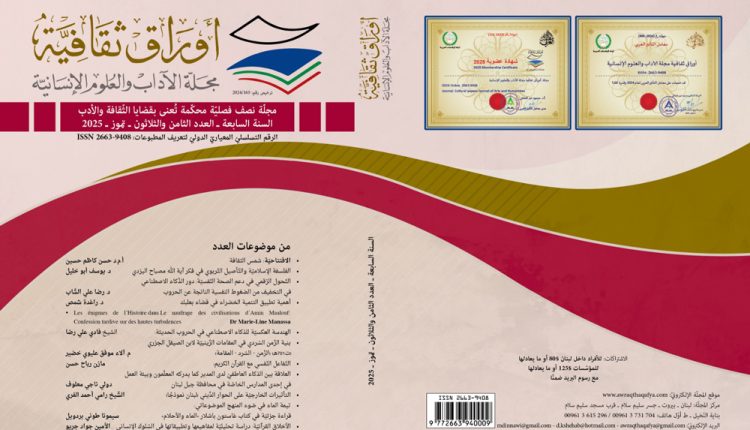Les énigmes de l’Histoire dans Le naufrage des civilisations d’Amin Maalouf: Confession tardive sur des hautes turbulences
عنوان البحث: Les énigmes de l’Histoire dans Le naufrage des civilisations d’Amin Maalouf: Confession tardive sur des hautes turbulences
اسم الكاتب: Dr Marie-Line Manassa
تاريخ النشر: 16/07/2025
اسم المجلة: مجلة أوراق ثقافية
عدد المجلة: 38
تحميل البحث بصيغة PDFLes énigmes de l’Histoire dans Le naufrage des civilisations d’Amin Maalouf: Confession tardive sur des hautes turbulences.
ألغاز التاريخ في كتاب أمين معلوف “غرق الحضارات”: اعتراف متأخر عن الاضطرابات العالية
د. ماري لين منسّى Dr Marie-Line Manassa [1]
تاريخ الأرسال:24-5-2025 تاريخ القبول:4-7-2025
Les historiens doivent reconnaitre qu’ils ne sont pas les maitres de la représentation du passé. (Laurens, 2022, p. 17)
Résumé
Chacun a sa manière de percevoir que tout change. Le naufrage des civilisations (Maalouf, 2019), Amin Maalouf l’a écrit pour raconter les imperceptibles moments de la modification d’un univers levantin dominé par de grands passés- les guerres, les résistances, les révolutions, les glissements, les lézardes, les points de vue qui tournent, les distances qui augmentent et diminuent, les chemins qui s’éloignent, sentant qu’il vit les privilèges épiques de l’Histoire. Il est heureux d’y être, il a l’impression d’en être et il s’en souvient. C’était le courage politique plein pour se plonger dans ce singulier essai qui permet de voir que les brusques changements ou revirements dans l’ordre du monde sont difficiles à saisir, non seulement parce qu’ils n’ont jamais de date précise mais parce qu’ils sont passés toujours depuis bien longtemps lorsque, enfin, nous nous en prenons conscience. Cette notion de changement a conduit Henri Laurens, dans Le passé imposé à une formule habile où l’évènement est évoqué comme étant «un changement considéré comme rétrospectivement important.» (Laurens, 2022, p. 24) Si les titres très imagés des 4 chapitres qui composent cet essai furent une des causes essentielles de son succès c’est parce que Maalouf ne voulait pas tricher avec le monde qui apporte à travers l’évolution complexe de ses évènements, ce naufrage des civilisations. Il a voulu montrer que le monde exige de notre part une conscience lucide, un perpétuel combat pour rétablir l’équilibre, et d’essayer alors, mais alors seulement, d’avancer sur des chemins plus lumineux où la dérive sera enrayée et les turbulences seront calmées.
Mots clés: mémoire collective, lieu de mémoire, obsession commémorative, histoire, civilisation, mondialisation.
الملخّص
يتمتع كل شخص بأسلوب خاص به في إدراك أن كل شيء يتغير.
كتب “أمين معلوف” كتاب غرق الحضارات” (معلوف، 2019) ليسرد اللحظات غير الملحوظة في تبدّل العالم المشرقي الذي سيطر عليه ماضٍ عظيم – الحروب والمقاومات والثّورات والتّحولات والتّصاعدات، ووجهات النظر التي تتقلب، والمسافات التي تزيد وتتقلص، والطرق التي تفترق، و يشعر أنّه يعيش امتيازات بطوليّة بمنحها التاريخ .
إنّه مسرور لوجوده في هذه الحقبة ، ولديه انطباع أنه جزءٌ من هذا التاريخ، ويتذكره. إنّها الشّجاعة السياسيّة بالكامل التي تجعله يغوص في هذا المقال الفريد الذي يسمح برؤية كيف أن هذه التّغيرات والتّحولات المفاجئة في تراتبية العالم والتي يصعب التقاطها، ليس فقط لأنه ليس لديها ابدا تاريخ محدد، بل لأنها تكون دائمًا قد حدثت منذ وقت بعيد، حين نستدرك الامر.
لقد دفعت فكرة التّغيير هذه هنري لورانس، في كتابه “التاريخ المفروض”، إلى صيغة بارعة يُشار فيها إلى الحدث على أنه “تغيير يُعدُّ مهمًا بأثر رجعي” (لورانس، 2022، ص.24). إذا كانت العناوين الرّمزيّة للفصول الأربعة التي يتألف منها هذا المقال واحدة من الأسباب الأساسيّة لنجاحه، فذلك لأنّ “أمين معلوف” لم يكن يريد أن يغشّ العالم الذي يسهم في غرق الحضارات من خلال التّفاقم المعقد لهذه الأحداث. فهو أراد إظهار أن العالم يفرض علينا وعيًا واضحًا، وكفاحًا أزليًا لاستعادة التّوازن، والمحاولة، فقط عندها، للارتقاء على طرق أكثر سطوعًا فتعرقل الانحراف، وتهدئة الصخب.
الكلمات المفتاحية: الذّاكرة الجماعيّة، مكان الذاكرة، الهوس التذكاري، التّاريخ، الحضارة، العولمة.
Introduction
Il est frappant de constater que Maalouf, «en entamant une méditation sur l’époque déconcertante» (Maalouf, 2019, p.327) où il lui a été donné de vivre, a cherché, très justement, à savoir «les turbulences qui ont conduit le monde au seuil de ce désastre» (Maalouf, 2019, p.18) avec un regard «d’observateur, quelqu’un qui essaie de comprendre avec un regard d’historien.” (Maalouf, 2011) Il convient en effet de se rappeler ce que Henri Laurens disait du travail de l’historien dans son livre le passé imposé, quand il écrivait «inlassable vérificateur de faits mais aussi interprète de ces dits faits pour les mettre en cohérence dans un récit.» (Laurens, 2022, p. 11) Dans une interview, en 2025, Maalouf revenait à ce thème décisif d’observateur attentif des dynamiques historiques et sociopolitiques et affirmait: «Nous sommes tous des enfants de notre temps et de notre lieu.» (Maalouf, 2025) Cette expression rappelle que son histoire personnelle est liée inextricablement à la grande Histoire, et c’est ainsi que commence son livre.
Je serai souvent amené à dire «je», «moi», et «nous». J’aurais préféré ne pas avoir à parler à la première personne, surtout dans les pages d’un livre qui se préoccupe de l’aventure humaine. Mais comment aurais-je pu faire autrement quand été, dès le commencement de ma vie, un témoin proche des bouleversements dont je m’apprête à parler; quand «mon» univers levantin a été le premier à sombrer; quand «ma» nation arabe a été celle dont la détresse suicidaire a entrainé la planète entière dans l’engrenage destructeur? (Maalouf, 2019, p.18)
C’est ainsi qu’il se voulait témoin des déchirures de son univers levantin, des bouleversements de sa nation arabe, et cet essai qui valut à son auteur le Grand Prix du GAFF multiplie les initiatives mémorielles, telles que la révolution de 1958, le drame israélo-arabe de juin 1967, la tragédie de la guerre civile libanaise en 1975, les différentes calamités engendrées par le communisme ou par l’anticommunisme. Autant dire tout de suite que Le naufrage des civilisations s’inscrit «dans une obsession commémorative» (Wood, 1994, p.141) et nous comprenons dès lors l’importance que revêtira dans cet essai ce passage minutieusement choisi.
En l’espace d’une vie, on a le temps de voir disparaitre des pays, des empires, des peuples, des langues, des civilisations. L’humanité se métamorphose sous nos yeux. Pour l’historien, le spectacle du monde est fascinant. […] Mais [l’univers levantin] est tellement oublié de nos jours que la plupart de mes contemporains ne doivent plus savoir à quoi je fais allusion. (Maalouf, 2019, p.12)
Le récit qui suivra constitue une véritable déclaration d’intention, tentera de nous retracer un inventaire de la mémoire levantine au moment où «elle risque de basculer dans un passé mort.» (Nora, 1984, p. 181) Paradoxalement, ce n’est pas l’univers levantin qui intéresse Maalouf. «Je n’ai pas connu le Levant de la grande époque, je suis venu trop tard, il ne restait plus du théâtre qu’un décor en lambeaux, il ne restait plus du festin que des miettes» (Maalouf, 2019, p.21), écrit Maalouf dans Le naufrage des civilisations (2019). Ce sont les souvenirs des phénomènes historiques et des changements sociaux et politiques, c’est-à-dire «la représentation d’un passé perdu» (Ammar, 2014, p.16) qu’il cherche à réactiver. Qu’on ne voie pas là un simple effort de célébration, de la part de Maalouf, du pouvoir de la mémoire, mais bel et bien une volonté «d’arrêter le temps et d’immobiliser le souvenir» (Nora, 1984, p. 181) des événements qui avaient éteints «les lumières du Levant.» (Maalouf, 2019, p.13) Ces mots expriment fondamentalement un souci maaloufien.
C’est pour éviter de tomber continuellement dans de tels travers que j’ai pris l’habitude de désigner toutes les tragédies qui ont affecté mon époque et ma propre existence par un même vocable, le plus anodin qui soit, celui de «tristesse» – quelquefois au pluriel, afin de relier le sentiment diffus à des réminiscences distinctes. (Maalouf, 2019, p.271)
Il y a là une intention délibérée et très nette qui ne saurait être l’effet du hasard; Maalouf recueille l’héritage moral de ceux qui l’ont précédé, part des souffrances et des violences et les appelle «tristesse» (Maalouf, 2019, p.271) et essaye d’incarner les détestations honteuses, d’illustrer les divisions qui deviennent «la règle» (Maalouf, 2019, p.13), ou d’officialiser un passé qui ne passe plus, de construire une image d’un passé collectif, ou de reconstruire, selon l’affirmation de Pierre Nora, «ce qui n’est plus.» (Nora, 1984, XIX) Maalouf écrit.
Mes tristesses racontent toutes la même histoire, celle d’une grande espérance qui a fini déçue, trahie, dénaturée ou anéantie. […] Tristesse pour les peuples du Levant, tous sans exception […] qui se noient dans le même marécage tout en continuant à se maudire. Tristesses récurrentes pour les sociétés arabes qui, une ou deux fois par génération, tentent de décoller, s’élèvent un peu, puis retombent lourdement à terre comme des faucons aux ailes brisées. (Maalouf, 2019, p.272)
Il nous faut dire encore quelques mots de ce souci maaloufien: garder une forte nostalgie «des maisons bâties par les miens entre l’Anatolie, le Mont-Liban, les cités côtières et la vallée du Nil qu’ils allaient toutes abandonner, l’une après l’autre sans même refermer la porter derrière soi.» (Maalouf, 2019, p.21) Ce souci correspond à ce souci fondamental de la mémoire à s’incarner dans les lieux; c’est parce que, comme l’affirme Gaston Bachelard, c’est dans le lieu que «l’inconscient séjourne. Les souvenirs sont immobiles, d’autant plus solides qu’ils sont mieux spatialisés.» (Bachelard cité par Petitier, 1989, p. 103) Qu’on ne voie pas là un simple effort de clarification d’une «souffrance transmise et alimentée par le milieu social” (Laurens, 2022, p.173) que Laurens désigne par ce mot suggestif: «névrose de guerre ou trouble de stress post-traumatique» (Laurens, 2022, p.173), mais bel et bien la réalisation d’une mémoire collective qui se compose, d’après la thèse halbwachsienne, de la mémoire individuelle pour «construire une image du passé collectif» (Jaisson, 1999, p.165)
Sans pouvoir ici entrer dans les détails d’un livre aussi riche que complexe, il convient de signaler l’importance que Maalouf accorde, dans cet essai, à la notion de «dérive» (Maalouf, 2019, p.113) ou encore de «tournant décisif» (Maalouf, 2019, p.113) dans l’histoire levantine. C’est la lecture de Laurens dans son imposant ouvrage Le passé imposé, en 2022, qui nous permet d’interpréter le crépuscule du monde arabe et de comprendre ce que le Premier ministre de l’empire britannique, Macmillan, nomme «Wind of Change.» (Macmillan cité par Laurens, 2022, p.10) De là, Maalouf ne peut sans péril et sans gêne évoquer ce vent du changement qui s’inscrit dans la longue litanie de la chute et du déclin de la civilisation levantine. Que voulait Maalouf en se souvenant de la détérioration du monde arabe? S’agit-il-là d’une sagesse «hypermnésique» (Laurens, 2022, p.15) qui lui permet délicatement «d’aborder l’histoire des mutations» (Petitier, 1989, p.106), de se consoler, ou de produire une histoire connaissance insoumise aux ravages du temps qui passe? Si, dans Le naufrage des civilisations (2019), une place si grande est faite à la notion de division Orient/Occident, pourquoi se place-t-elle sur le même rang que le partage entre répression et désir, entre folie et raison? Maalouf a-t-il le droit de partir de certains lieux auxquels il s’attache inévitablement pour faire une histoire et constituer ses archives en fonction de ces lieux de mémoire? Et dans quelle mesure ces lieux de mémoire permettent-ils de dépasser le simple constat du déclin pour proposer une relecture culturelle et politique de l’histoire?
Il s’avère donc indispensable de souligner ici l’entreprise commémoratrice de Maalouf: s’intéresser à aborder les grands «ébranlements historiographiques» (Nora, 1984, p.182) de façon à ce qu’ils soient retenus collectivement, plutôt que de les raconter exclusivement. De la méthode mnémotechnique de Henry Laurens (2022), à la visée historiographique et les idées de Maurice Halbwachs telles entre autres la mémoire collective qui constitue selon Ricoeur «le sol d’enracinement de l’historiographie» (Ricoeur, 2000, p. 83), ou encore au concept d’investigation historique et à la formule la plus neuve et la moins étudiée de Pierre Nora dans son œuvre monumentale Les lieux de mémoire (1984-1992) «l’histoire-mémoire» (Nora, 1993, p.4) qui amène vite à la «mémoire des lieux qui appelle les vrais lieux de mémoire» (Le Goff cité par Petitier. 1989, p.103), Amin Maalouf a évolué; il se dirige plus nettement, en effet, vers «un ancrage spatial de la mémoire.» (Valensi, 1995, p.127) Nous comprendrons, par conséquent, son projet spatial de la mémoire qui consiste à «dresser l’inventaire des lieux de toute nature dans lesquels s’est cristallisée la mémoire nationale» (Delva, 2017, p.12), qui a pour capacité «d’articuler ensemble et d’embrasser du même regard analytique l’histoire des faits de culture et l’histoire des faits sociaux qui donne à l’histoire symbolique son dynamisme et sa fécondité» (Nora, 1984, p.20) et qui a «pour fonction essentielle de réparer les déchirures de l’Histoire.» (Petitier, 1989, p.106)
En faisant ainsi jouer l’une avec l’autre, la méthode mnémotechnique et l’analyse historique, Maalouf a voulu donner une matière vivante à ce qui n’était qu’une «accumulation de connaissances» (Veyne cité par Laurens, 2022, p. 21), selon la formule décisive de Paul Veyne. Un tel effort s’inscrit incontestablement dans cette recherche intellectuelle ambitieuse qui caractérise toute l’œuvre de Maalouf: résister contre l’amnésie et repenser l’histoire à travers laquelle il sera possible de construire un avenir partagé.
I-Relecture de l’histoire: un new-deal
- Entre la détermination et la surdétermination
Ce qui frappe le plus le lecteur de Maalouf, ce sont les fameuses circonstances qui témoignent d’un passé empli de tensions et de combats inachevés. Qu’il s’agisse «des sociétés chaudes» (Lévi-Strauss, 1993, p.7-10) qui s’activent constamment en fonction des changements en cours, d’évènements surprenants; Maalouf prédit le passé, c’est-à-dire détermine les causes d’un évènement, en repère «les signes annonciateurs et pose les premières hypothèses causales.» (Veyne, 1978, pp. 97-98) Il nous faut en effet reconnaitre que l’auteur de Le naufrage des civilisations (2019) ne parle des évènements que pour essayer de les prédire, chercher leurs origines ou leurs moments premiers. Et Veyne de préciser sa pensée en écrivant: «Cette œuvre de prédiction du passé s’exprime à travers l’expression «es origines de». Il est toutefois plus savant, ou plus philosophique, de parler d’«archéologie» ou de «généalogie.» (Laurens, 2022, p.44) Ces moments premiers prennent dans son œuvre des dimensions surprenantes. Des expressions telles que «lapidations», «décapitations», «amputations», «crucifixions», «lynchages», «sauvagerie» (Maalouf, 2019, p.87) fourmillent ainsi dans cet essai. Les pages fameuses consacrées à la déduction des déterminations que connait la civilisation de son père sont bien significatives; les racines ou les causes y sont évoquées.
Ces pays qui se désintègrent, ces communautés millénaires que l’on déracine, ces nobles vestiges que l’on démolit, ces villes éventrées […] Rarement, dans l’histoire des peuples, la haine de soi a conduit à de telles extrémités. Ce qui est ancré chez les miens, […] c’est leur manque de confiance en eux-mêmes et en leur capacité à prendre leur destin en main. […] Tous ceux qui ont longtemps subi l’autorité pesante d’un colonisateur, d’un occupant, d’une métropole, connaissent ce sentiment de dépendance, ce besoin d’attendre l’aval d’une instance supérieure, cette crainte de voir ses propres décisions méprisées, sanctionnées, abolies. […] L’histoire de mon pays natal est éloquente à cet égard. Pendant des siècles, les ordres venaient d’Istanbul, de la Sublime Porte, comme on avait l’habitude de dire. […] C’est seulement au crépuscule des Ottomans que le Mont-Liban put échapper à leur emprise. Lorsqu’il y eut, au-dessus du sultan, des souverains bien plus puissants qui lui dictaient leurs propres exigences. Mais l’habitude d’obéir à une Sublime Porte n’a pas disparu pour autant. Les ordres qui ne venaient plus d’Istanbul, on les attendait désormais de Washington, de Moscou, de Paris, de Londres; et aussi de certaines capitales régionales, comme le Caire, Damas, Téhéran ou Ryad. (Maalouf, 2019, p.88) Cette citation nous montre, premièrement, que Maalouf part des évènements, de leurs retombées destructrices, afin d’en déterminer les causes. Cette synthèse de l’histoire est qualifiée par Veyne par «rétrodiction.» (Veyne, 1978, pp. 97-98)
Pourtant, et c’est là la deuxième caractéristique des textes de Maalouf, la dimension humaine n’y ai jamais niée; il y a «un parcours de vie» (Bourdieu, 1986, pp.69-72) qui correspond à cette affirmation fondamentale selon laquelle «certaines fractions des individus passent outre ces déterminations […] et connaissent une promotion inattendue dans l’espace.» (Bourdieu, 1986, pp.69-72) Il convient ici de signaler l’importance que Maalouf accorde, dans cet essai, au recueil de vie de Gamal Abdel Nasser; une personnalité historique qui ne peut être enfermée à l’intérieur d’un déterminisme dont les limites sont volatilisées par une conscience sociale. Dans L’illusion biographique (1968), Bourdieu décrit rigoureusement cette personnalité «désignée par le nom propre, c’est-à-dire l’ensemble des positions simultanées occupées à un moment donné du temps par une individualité biologique socialement instituée agissant comme support d’un ensemble d’attributs et d’attributions propres à lui permettre d’intervenir comme agent efficient dans différents champs» (Bourdieu, 1986, pp.69-72) De cette conception encore très théorique, à la visée descriptive d’une personnalité dont l’ascension fulgurante lui permettra de devenir «l’une des personnalités les plus en vue sur la scène internationale» (Maalouf, 2019, p. 38), Maalouf se permet de construire le destin de la vie «du leader incontesté de l’Egypte et l’idole des foules arabes» (Maalouf, 2019, p.54) qui ne se comprend, ne se ressent, ou ne se remémore qu’en perspective de son temps. En se rappelant ce que Laurens disait de l’approche biographique, nous ne pouvons lire sans intérêt cette affirmation où il parle des personnages historiques ou des grands hommes qui «par leurs comportements, leurs valeurs, ils sont considérés comme représentatifs de leurs sociétés respectives qu’ils ont influencées.» (Laurens, 2022, p. 60) Mais avons-nous véritablement le droit de boucler cet homme à l’intérieur d’une formule? Cet homme auquel sa nation était reconnaissante, ne réussira-t-il pas à incarner les divisions honteuses de sa patrie? Le tristement fameux «Il n’y a point d’homme dans le monde” (De Maistre, 1829, p.52) prononcé par Joseph de Maistre au début du chapitre IV, ne saurait-il trancher entre naturalisme et relativisme sur le thème du statut de l’être humain? Ne saurait-il résumer le poids du contexte qui le condamnait à être «prisonnier de l’univers colonial, de la tentation de l’Occident et de son rejet» (Laurens, 2022, p.131), selon une formule célèbre de Laurens? Maalouf résume d’ailleurs parfaitement cette notion de «poids de l’histoire», chère à Laurens.
Dans beaucoup de domaines, le rais était prisonnier des conceptions qui prévalait à son époque. Le colonialisme n’apparaissait pas encore comme un chapitre clos de l’histoire humaine. […] Et un jour, il se laissa entrainer dans une guerre dont il ne voulait pas, et qui allait se révéler fatale pour lui comme pour la nation qui croyait en lui. (Maalouf, 2019, pp.54-55)
Un autre passage du même essai éclaire, de manière remarquable, cette idée fondamentale dont l’importance n’a pas échappé au lecteur de Maalouf: l’enfermement de l’Orient dans le temps colonial et surtout les contraintes géopolitiques- autant de tragédies qui ont endeuillé, voire déréglé le monde levantin. «Les turbulences du monde arabe sont devenues, ces dernières années, la source d’une angoisse majeure pour l’humanité toute entière.» (Maalouf, 2019, p.83) S’il repasse en mémoire ces histoires c’est pour, redonner de l’épaisseur à ce passé qu’il tente de projeter avec «un souci d’objectivité» (Maalouf, 2019. P.260); il s’agit de «démasquer la fausse naïveté» (Petitier, 1989, p.104) de certaines images, et surtout d’entrainer son essai «de la surface vers la profondeur, de l’évidence du souvenir à la complexité de l’histoire» (Petitier, 1989, p.104), dit Petitier dans une très belle formule. Tel un archéologue, il saisit un passé calamiteux qu’il projette au présent. Il problématise sa représentation du passé, donc du présent, et essaye de comprendre le présent et de faire le bilan du XXème siècle par la recherche de «la nature et le sens du mémorisé, ainsi que la mise en forme et en ordre du souvenir» (Petitier, 1989, p.104) dit Petitier en parlant des lieux plutôt qu’images de mémoire dans une formule singulièrement évocatrice.
Lorsque j’essaie de faire le bilan du XXème siècle, il m’apparait qu’il fut le théâtre de deux «familles» de calamités, l’une engendrée par le communisme, l’autre par l’anticommunisme. A la première appartiennent toutes les exactions commises au nom du prolétariat, du socialisme, de la révolution, ou du progrès; les épisodes en furent très nombreux, sous tous les cieux- des procès de Moscou et des famines d’Ukraine aux outrances nord-coréennes en passant par le génocide cambodgien. A la seconde «famille» appartiennent les exactions commises au nom de la lutte contre le bolchévisme. Là encore, les épisodes furent innombrables, le plus dévastateur étant, bien-sûr, le cataclysme planétaire causé par la «peste brune» du fascisme et du nazisme. (Maalouf, 2019, p.20)
Cette citation explique de façon très claire le vocable choisi par Nora dans Les Lieux de mémoire (1985) pour évoquer la mémoire productive et sollicitée dans les moments de modifications importantes ou de rupture, il s’agit des ruptures du fil historique ou des «nœuds de mémoire» (Petitier, 1989, p.105) en lesquels «se trouvent condensés tant d’histoires qui éclaircissent l’imbrication des différentes strates et des différentes vitesses du devenir.» (Petitier, 1989, p.105)
Il serait impossible de conclure ces remarques sur l’importance de la mémoire qui s’incarne dans les lieux, ainsi que son pouvoir dans l’organisation et dans la célébration de l’histoire; «ces mémoriaux ont leur histoire» (Petitier, 1989, p.103) écrit Petitier excellemment dans Les lieux de mémoire (1989). Ce terme est la meilleure illustration que Nora ait donnée de la rencontre totale entre la mémoire et l’histoire. «La mémoire est toujours ce qui nous fait trouver du sens à l’histoire, […] en attendant que se recomposent les savoirs dans une nouvelle épistémé.» Cette association est fondamentale.
II- entre la sacralisation ou la désacralisation
Le projet de Maalouf n’est pas seulement une pure et simple discipline d’ordre historique ou évènementielle. L’influence de l’œuvre se ressent «dans la multiplication des initiatives mémorielles» (Delva, 2017 p. 12), selon un terme cher à Nora, telles la Révolution conservatrice de Deng Xiaoping et l’arrivée de Jean-Paul II à la tête de l’Eglise catholique en 1978, la Révolution islamique proclamée en Iran par l’ayatollah Khomeiny en février 1979, et la révolution conservatrice mise en place au Royaume-Uni par le Premier ministre Thatcher en mai 1979. A ces bouleversements s’ajoute principalement «deux facteurs qui ont pesé sur l’atmosphère de ces années-là; l’un est la crise terminale du régime soviétique, l’autre est le choc pétrolier.» (Maalouf, 2019, p.176) Cette «obsession commémorative» (wood, 1994, p.142) prend dans son œuvre des dimensions surprenantes, surtout quand il progresse dans les chemins d’une «doctrine commémorative» (Garcia, 2000, p.142) continuellement défendue par Nora dans les lieux de mémoire (1992) qui parle de la «boulimie commémorative.» (Nora, 1992, p.975) Le terme «homme-mémoire» (Nora, 1984, VII) redéfinit parfaitement Amin Maalouf et restitue minutieusement sa foi: «Ce qui compte, […] c’est le type du rapport au passé et la manière dont le présent l’utilise et le reconstruit.» (Nora, 1993, p.9) Le passage le plus fameux et le plus long de Les naufrages de civilisation (2019) à ce sujet est très significatif. Maalouf avance.
Quand on s’efforce de comprendre pourquoi une situation donnée a évolué de telle ou telle manière, on est souvent tenté de remonter très loin dans le passé. Ce qui devient quelquefois fastidieux, vu que chaque élément de la situation a sa propre histoire, qui peut s’étaler parfois sur des siècles. Si l’on ne veut pas se perdre dans la forêt touffue des dates, des personnages, des passions et des mythes, on doit parfois se frayer une perspective à coups de serpe. C’est ainsi que j’ai procédé quand je me suis plongé dans l’histoire des dernières décennies. […] La plupart des événements dont je m’apprête à parler, je me souviens d’en avoir eu connaissance au moment où ils se sont produits; quelquefois même, je me suis rendu sur place, à Saigon, Téhéran, New Delhi, Aden, Prague, New York ou Addis-Abeba, pour y assister en personne. Mais on voit les choses autrement avec le recul, lorsqu’on connait déjà les conséquences. (Maalouf, 2019, p.168)
Que voulait Maalouf par cet effort d’interrogation du passé par le présent? Le réveiller et le désigner comme révolu ou le disséquer pour le ressusciter? Avait-il le droit d’écrire et de s’incliner devant l’impératif du national” (Schrader, 1994, p.157) comme si, en s’engageant volontairement à son service? Des mots très significatifs vont, dans Les lieux de mémoire (1984), cerner cette notion; Nora parle ainsi d’une sacralisation ou d’une désacralisation d’une nation. Il est inutile de résumer ici les notes personnelles de Maalouf consacrées à évoquer les évènements significatifs qui ont marqué un tournant dans le cours de l’Histoire, «l’année du grand retournement-1979» (Maalouf, 2019, p.218), écrit Maalouf. Cette année révèle essentiellement des turbulences identitaires avec «l’irruption brusque, sur la scène mondiale, d’un islamisme paradoxal, socialement traditionnaliste mais politiquement radical, […] et la fondation de la République islamique d’Iran sur les décombres d’une monarchie jugée trop moderniste et occidentalisée» (Maalouf, 2019, p.219) ou avec «le puissant réseau jihadiste global qui prendrait un jour le nom d’Al-Qaida, la base, et qui se ferait connaitre par une série d’attentats spectaculaires, […] et dut redoubler ses efforts pour propager le wahhabisme et le salafisme à travers le monde» (Maalouf, 2019, p.237), rappelle Maalouf. Ces lignes très claires décrivent les déchainements identitaires d’une époque désespérément conservatrice- souvent fondée «sur la religion, la nation, la terre, la civilisation, la race, ou un mélange de tout cela.» (Maalouf, 2019, p.218) – comme une «désacralisation de la nation nourrissant une piété collective qui s’est exprimée par des croyances et des rites, qui a chargé symboliquement des lieux, des objets, des espaces et des temps.» (Willaime, 1988, p.126) Vu sous cet angle, ces djihadistes s’engagent à construire des mosquées «par le financement d’associations religieuses de Dakar à Djakarta» (Maalouf, 2019, p. 238) et leurs assauts s’achevaient absolument «dans un bain de sang.» (Maalouf. 2019, p. 219), précise Maalouf. C’est là qu’il nous impose à plusieurs reprises une «mémoire tyrannique, parfois terroriste» (Robitaille, 2008, p.2) qui raconte les réminiscences distinctes et les tristesses, les illusions, les désillusions et les égarements «des sociétés arabes qui, une fois ou deux fois par génération, tentent de décoller, s’élèvent un peu, puis retombent lourdement à terre comme des faucons aux ailes brisées.» (Maalouf, 2019, p.272)
Toutefois, il nous faut dire que Maalouf dans Le naufrage des civilisations (2019) sacralise l’Europe; il la nomme «mon continent d’adoption» (Maalouf, 2019, p.273) pour revitaliser le sentiment d’appartenance à ce continent. Cette glorification va de pair avec la célébration de certaines valeurs en rapport notamment avec la pérennité et l’universalité de ce continent porteur «de valeurs universelles, et réellement capable d’influer sur la marche de l’Histoire.» (Maalouf, 2019, p.273) Ce fameux passage témoigne d’une sacralisation du continent européen ou encore de son hyperpuissance. Il écrit.
Quand je contemple les turbulences de ce siècle, il m’arrive de regretter qu’il n’existe aucune autorité politique et morale vers laquelle nos contemporains pourraient se tourner avec confiance. […] Et quand je promène mon regard sur le monde en me demandant, non sans angoisse, qui pourrait aujourd’hui assumer une telle tâche, il m’apparait que seule l’Europe serait en mesure de le faire.» (Maalouf, 2019, p.273)
De tels propos ne sont-ils pas fondamentalement réflexifs? Maalouf tient-il à «faire de l’Europe l’avenir de l’Orient?” (Laurens, 2022, p. 99) Nous pouvons y voir une sorte de «processus de civilisation» (Laurens, 2022, p.99) qui permettrait, selon une formule habile de Laurens, à ceux «qui sont en retard de rattraper le monde civilisé.» (Laurens, 2022, p.99) Pourtant, l’Europe serait-elle la candidate naturelle pour ce rôle? Certes, ce continent «ne correspond plus à l’image traditionnelle de la superpuissance» (Corbin, 1988, p.125) et «celui-ci devrait plutôt échoir aux Etats-Unis d’Amérique qui ont depuis longtemps la volonté d’exercer un leadership global» (Maalouf, 2019, p.273), ajoute Maalouf. L’inévitable Occident est partout!
II-Ecriture de l’histoire: poison ou remède
- Enseigner l’histoire ou la produire?
Avant de pousser très loin cette analyse en nous attachant plus particulièrement au devenir occidental, le récit de Le Naufrage des civilisations (2019) est, à bien des égards, l’expérience mémorielle d’un tragique déclin des civilisations. Les paroles de Maalouf s’inscrivent sur ce point dans la longue litanie qui rappelle incontestablement les paroles de Macmillan; c’est le crépuscule ou «la chute de la civilisation occidentale qui a dû commencer avec le XXème siècle.» (Macmillan cité par Laurens, 2022, p. 10) Lors de la crise de Suez, Harold Macmillan a pu dire à ce sujet, à l’ambassadeur américain à Londres, ces mots pour le moins suggestifs.
Nous assistons probablement à la fin de la civilisation occidentale; dans 50 ans encore, les Jaunes et les Noirs auront pris le contrôle de la civilisation. Dans l’ensemble, nous aurons eu un très bon moment d’environ 500 ans.[2]
Le monde contemporain nous offre sans cesse le spectacle d’un conflit des civilisations; Maalouf l’appelle «affrontement entre les civilisations.” (Maalouf, 2019, p. 245) Des mots tels que «morcellement», «fractionnement», «clash», «décomposition» (Maalouf, 2019, pp.245-246) font là leur apparition et deviennent des spécificités liées à «l’esprit du temps.» (Maalouf, 2019, p.246) Dans Le passé imposé (2022), Laurens évoque en termes poignants, le conflit des civilisations au début du XXème siècle et rappelle que «la notion de civilisations au pluriel était une production de la grande divergence du XIXème siècle.» (Laurens, 2022, p. 127) Il est étrange de constater que plusieurs passages de cette analyse peuvent lui être appliqué mot à mot. Cette tendance aux morcellements et à la tribalisation, Maalouf l’évoque en prélude de sa réflexion sur les abimes de l’histoire occidentale. Il superpose les fragmentations successives des aires de civilisations, mauvaises et affligeantes, et réussit à faire de ces représentations ce que Paul Ricoeur appelle une «histoire de l’histoire» (Ricoeur, 2000, p.194) qui parle à l’angoisse et qui vise à produire l’histoire, non seulement l’enseigner. Maalouf ne cesse de construire l’architecture de la dé-civilisation «produit de la somme algébrique de nos égoïsmes planétaires.» (Maalouf, 2019, p.250) Il affirme alors excellemment.
On l’observe dans la société américaine, ce qui a conduit certains esprits malicieux à parler des «Etats-Désunis». On l’observe dans l’Union européenne, qui a été ébranlée par la défection de la Grande-Bretagne comme par les crises et les tensions liées aux migrations. On l’observe de manière particulièrement aigue dans quelques grands et vieux pays du continent, unifiés depuis des siècles, qui possédèrent jadis les plus vastes empires, et qui doivent aujourd’hui faire face- en Catalogne, en Ecosse, et ailleurs- à des mouvements indépendantistes puissants et résolus. Sans oublier l’ancienne Union soviétique et les autres pays autrefois communistes d’Europe orientale, qui formaient neuf Etats à la chute du mur de Berlin, et qui en comptent aujourd’hui vingt-neuf… (Maalouf, 2019, p.246)
C’est principalement sur ces divers morcellements au niveau de l’espace de l’humanité entière que Maalouf inscrit «les plus lentes oscillations que connaisse l’histoire.» (Ricoeur, 2000, p. 190) Nous ne retiendrons des riches analyses de Maalouf que ce qui concerne, «les économies-monde qui nouent une économie à une géographie» (Braudel, 1979.151) et qui prétendent, telles les appartenances religieuses «réunir les hommes alors qu’ils jouent, dans la réalité, le rôle inverse.» (Maalouf, 2019, p,246) Maalouf aborde ici le détail du «dirigisme socialiste athée» (Maalouf, 2019, p. 248) tombé dans les oubliettes de l’Histoire, qu’il confronte au capitalisme. Il explique.
L’échec cuisant du modèle soviétique, qui avait fait grand cas du caractère «scientifique» de son socialisme. Celui-ci était censé démontrer que seuls les pouvoirs publics étaient en mesure de rationaliser les processus de production et de distribution. Mais il a démontré l’inverse, à savoir que plus une économie était centralisée, plus son fonctionnement devenait absurde; plus elle prétendait gérer les ressources, plus elle provoquait les pénuries. (Maalouf, 2019, p.248)
Ayant montré que «les transformations réglées qui affectent simultanément la distribution et les déplacements à l’intérieur du pouvoir politique sont principalement marquées par un déplacement de l’intérêt politique vers l’économique» (Ricoeur, 2000, p.241) Maalouf s’efforce de faire d’une pierre deux coups: il élargit «la sphère de l’enquête historique au-delà du politique, […] et donne la réplique d’une histoire ancrée dans le social à l’histoire économique» (Ricoeur, 2000, p. 242) qui risquerait d’effacer la figure de l’homme tant célébrée par Boch et Febvre (1953) . Que voulait Maalouf en sortant aussi ostensiblement des sentiers battus? A-t-il le droit de «parler d’histoire éclatée, voire d’histoire en miettes?” (Dosse, 1997, pp.30-64), ou de produire une «nouvelle histoire, une histoire sans les hommes?” (Leroy-Ladurie, 1967, p.249), écrit Leroy-Ladurie d’une façon significative. Si le déplacement de puissance se produit au niveau des mentalités et de l’atmosphère intellectuelle, il nous faut reconnaitre aussi, que Maalouf, dans Le naufrage des civilisations (2019), ne rompt pas avec l’humanisme et montre que l’histoire des hommes s’émancipe au moment où le projet d’histoire des mentalités s’estompe. Il écrit.
Les idées qui avaient cours jusque-là, inspirées par le nationalisme, le socialisme ou le modèle des sociétés occidentales, furent peu à peu éclipsées par d’autres, qui provenaient de pays désertiques ayant longtemps vécu à l’écart des grands courants de pensées qui soufflaient sur le monde. Et l’on vit apparaitre dans la sphère politique de nouveaux acteurs, au profil inhabituel: des hommes jeunes, élevés dans des environnements très conservateurs et disposant parfois de moyens financiers considérables, […] On connait aujourd’hui le nom d’Oussama ben Laden et de quelques autres […] (Maalouf, 2019, p. 223)
Certes, nous pouvons ici savoir gré à Habermas qui éclaire de manière remarquable, cette idée fondamentale dont l’importance n’a pas échappé, le plus souvent, au lecteur de Maalouf: «Une atteinte à la couche la plus profonde de solidarité avec ceux ayant figure d’hommes.»[3] (Habermas, 1987, p.163) Maalouf éprouve l’invincible désir de se placer «en situation de responsabilité à l’égard du passé» (Ricoeur, 2000, p. 337), il atteste-proteste certains évènements historiques traumatiques dans lesquels «des agents ont été diversement investis» (Ricoeur, 2000, p. 335) et Maalouf, qui n’oublie rien, de s’élever à «une mémoire historique qui se fond dans la mémoire collective» (Halbwachs, 1997, p.105), de préciser sa pensée en écrivant: «Ce sont des centaines de milliers d’anonymes, peut-être même des millions, qui ont contribué aux combats d’Afghanistan, de Bosnie ou d’ailleurs, sans y avoir jamais mis les pieds, en envoyant simplement leur obole à quelque collecteur de fonds, avec la certitude d’accomplir ainsi un acte de piété» (Maalouf, 2019, p.223) ou encore: «Le jour où Brezinski vint demander à ses alliés, notamment aux Saoudiens, aux Egyptiens et aux Pakistanais, d’envoyer aux moudjahidines afghans de l’argent, des armes, et des volontaires prêts à se battre contre les communistes athées, son discours ne fut pas accueilli avec indifférence.» (Maalouf, 2019, p.225) Résultat: «Une détestation ne cesse de monter entre le monde arabe et le reste de la planète, c’est en son sein que se produisirent les pires déchirements, comme en témoignent les innombrables conflits sanglants qui s’y sont déroulés dans les dernières décennies, de l’Afghanistan au Mali en passant par le Liban, la Syrie, l’Irak, la Lybie, le Yémen, le Soudan, le Nigeria ou la Somalie.» (Maalouf, 2019, p. 245) Il s’agit bien là de ce que Nora nomme «rumination mémorielle.» (Nora, 1984, p.962) Par l’évocation «des ilots de passé conservés» (Halbwachs, 1997, p.115) qui relèvent de la mémoire générationnelle, Maalouf sacralise sa mémoire, immémorialise son passé afin de mieux mémorialiser son présent. (Nora, 1984, pp.955-964)
Il est nécessaire de dire fermement que les circonstances de la vie de Maalouf voulurent qu’il soit un spectateur proche des bouleversements que son époque avait connus. «La plupart des évènements dont je m’apprête à parler, je me souviens d’en avoir eu connaissance au moment où ils se sont produits; quelquefois même, je me suis rendu sur place, à Saigon, Téhéran, New Delhi, Aden, Prague, New York ou Addis-Abeba, pour y assister en personne» (Maalouf, 2019, p.168), dit Maalouf. En tant que journaliste, il s’engage à collecter et rassembler les documents, le processus «conduisant à la rédaction du livre» (Certeau, 1975, pp.84-89) écrit Certeau dans l’Ecriture de l’histoire. Quand il choisit de dévoiler le monde par ses écrits, il le fait par un «esprit historien» (Nietzsche cité par Ricoeur, 2000, p. 380), selon un terme cher à Nietzche. Il nous invite ainsi, du même coup, à croire que «le sens de l’existence se dévoile progressivement au cours d’un processus.» (Nietzsche cité par Ricoeur, 2000, p. 380) Autant dire qu’il ne regarde en arrière que «pour comprendre le présent à la lumière du chemin déjà parcouru et pour apprendre à convoiter plus hardiment l’avenir.» (Nietzsche cité par Ricoeur, 2000, p. 380) Une telle représentation mnémonique des drames de son temps est-elle un poison ou un remède? Il s’agit bien là de ce que Ricoeur nomme «un acte de sépulture qui prolonge au plan de l’histoire le travail de l’histoire et le travail de deuil, […] et sépare définitivement le passé du présent et fait place au futur.» (Ricoeur, 2000, p.649)
- Une nouvelle philosophie du monde: l’Orient ou la promesse de renouveau
Faire le bilan du XXème siècle a pris, dans l’existence de Maalouf, une telle dimension qu’il s’avère impossible de parler de l’écrivain sans évoquer simultanément les combats d’un historien-architecte. Il ne s’agit pas là de deux voies parallèles, mais d’une seule réalité; les œuvres littéraires et «les ouvrages d’architecture» (Laurens, 2022, p.17) de Maalouf qui transmettent à la postérité les spectacles affligeants «de toutes les faillites morales, et de toutes les trahisons» (Maalouf, 2019, p.207) que la planète présente en ce siècle, forment un tout. C’est dans ce sens que Le naufrage des civilisations (2019) s’inscrit en effet dans un cadre précis qui nous renvoie sans cesse aux drames de l’histoire des dernières décennies. Maalouf remonte très loin dans le passé, ce qui lui permet de comprendre la genèse d’une situation donnée et rétablir sa continuité et son évolution dans la chaine du temps. Il se plonge dans l’histoire afin de mieux la comprendre.
Depuis des années, je contemple le monde arabe avec angoisse, en m’efforçant de comprendre comment il a pu se détériorer de la sorte. Les opinions que l’on comprend à ce sujet sont innombrables, et contradictoires. Les unes incriminent surtout le radicalisme violent, le jihadisme aveugle, et plus généralement les rapports ambigus, dans l’islam, entre religion et politique; quand d’autres accusent plutôt le colonialisme, l’avidité et l’insensibilité de l’Occident, l’hégémonisme des Etats-Unis, ou l’occupation, par Israël, des territoires palestiniens. Si tous ces facteurs ont certainement joué un rôle, aucun n’explique à lui seul la dérive à laquelle nous assistons. (Maalouf, 2019, p.113)
Il va sans dire que ce regard postérieur sur cette foule d’évènements, émanant de plusieurs continents et de multiples domaines conduira-t-il à expliquer les terribles conflits qui s’enfoncent «dans les marécages de la mémoire?” (Laurens, 2022, p.189) Mettra-t-il fin «aux carcans hérités des siècles précédents par une série de destructions créatrices?” (Laurens, 2022, p. 58) Le fameux «Prométhée délivré», prononcé par Laurens dans Le passé imposé (2022) ne saurait-il résumer et apporter l’essentiel de l’ambition maaloufienne sur le thème de son rapport à l’histoire? Maalouf fait l’histoire. Prétendre le contraire, c’est mentir.
Maalouf a très heureusement exposé, dans cet essai, le processus d’alerte auquel devrait recourir toutes les civilisations et toutes les sociétés humaines qui cherchent à redresser le cap. C’est là une manière de nous expliquer, de nous exhorter, et même de nous prévenir. «Si le traumatisme renvoie au passé, la valeur exemplaire oriente vers le futur» (Ricoeur, 2000, p. 105), écrit Ricoeur. Todorov montre, de manière plus claire encore dans Les abus de la mémoire (1995), que «ce que le culte de la mémoire pour la mémoire oblitère, c’est, avec la visée du futur, la question de la fin, de l’enjeu moral.» (Todorov, 1995, p.150) Une telle analyse est incontestablement vérifiée dans cet essai, et nous comprenons que Maalouf ait pu l’illustrer à plusieurs reprises. Il écrit à ce sujet.
Par-delà les péripéties et les urgences de l’actualité quotidienne, par-delà le vacarme de ce siècle et ses bavardages assourdissants, il y a une préoccupation essentielle, qui devrait guider en permanence nos réflexions et nos actions: comment persuader nos contemporains qu’en demeurant prisonniers des conceptions tribales de l’identité, de la nation ou de la religion, et en continuant à glorifier l’égoïsme sacré, ils préparent à leurs propres enfants un avenir apocalyptique? (Maalouf, 2019, p.331)
Cette citation nous montre que l’humanité devrait «extraire des souvenirs traumatisants» (Ricoeur, 2000, p.105) des leçons à retenir. Il formule ses inquiétudes et insiste sur une thèse qui loin de semer l’aveuglement, la férocité, le péril et l’irresponsabilité, l’arrache définitivement de «toute dynamique asservissante, infantilisante et oppressive.
Il y a un équilibre à trouver, pour chaque génération, entre deux exigences: se protéger de ceux qui profitent du système démocratique pour promouvoir des modèles sociaux qui anéantiraient toute liberté; et se protéger aussi de ceux qui seraient prêts à étouffer la démocratie sous prétexte de la protéger.» (Maalouf, 2019, 311)
Le deuxième point mis en évidence par Maalouf, c’est le phénomène complexe de la mondialisation ou la globalisation, que Laurens appelle «la modernisation.» (Laurens, 2022, p.115) Alors qu’il renforcerait l’englobement des civilisations et des sociétés, il permettrait aux tensions identitaires de se dissiper mettant fin au morcellement et à la désintégration. Cette «resynchronisation» (Laurens, 2022, p.115) entre l’Occident et le reste du monde ou entre l’Orient traditionnel et l’Orient moderne connaitra une dimension révélatrice dans l’œuvre de Maalouf. Cette citation suffira à montrer que cette projection «de l’Occident sur les autres et intériorisation des Orients en Occident» (Laurens, 2022, 114) serait une solution radicale aux maux dont souffre précisément l’Orient.
La globalisation entraine, de par la nature même des technologies qui l’accompagnent, un mouvement puissant et profond qui pousse les différentes composantes de l’humanité à se rapprocher les unes des autres. (Maalouf, 2019, p.290)
Sans envisager ici la conclusion, d’ailleurs pessimiste, du récit de Maalouf, nous avons voulu souligner l’importance que pouvait revêtir l’interpénétration et le rapprochement des sociétés. Ainsi, l’autre sera de moins en moins autre, et le paquebot des hommes ne voguera plus vers sa perte «inconscient du danger, persuadé d’être indestructible, comme l’était jadis le Titanic- avant d’aller s’abimer dans la nuit contre sa fatidique montagne de glace, tandis que l’orchestre jouait Plus près de Toi, Seigneur, et que le champagne coulait à flots.» (Maalouf, 2019, p.332) L’optimisme n’est pas pour Maalouf un dû !
Il nous a paru salutaire de rétablir ici une certaine vérité. L’écriture mémorielle de Maalouf nous invite à repenser l’histoire, oublier les différences, abstraire. A tous ceux qui vont clamant que l’auteur de cet essai nous accule de désespoir, Maalouf ne répond-il pas par cette affirmation lumineuse selon laquelle «Le monde est à réinventer. Le monde est à construire. Le rôle de l’écrivain, c’est de ne pas semer le désespoir. Soyez ambitieux, imaginez un monde différent, croyez jusqu’au bout que vous pouvez changer le monde.» (Astruc, 2020) Que pouvons- nous exiger de plus et de mieux chez un écrivain qui espère que «la fête pourrait recommencer un jour” (Maalouf, 2019, p.21)?” L’espoir est une entreprise assurément coûteuse, mais nous ne saurions oublier que la liberté perçue sous l’angle de l’engagement ouvre en fait toutes grandes les portes de l’espoir d’un avenir plus brillant toujours possible.
Références bibliographiques
Corpus
Maalouf, A. (2019). Le naufrage des civilisations. Paris: Grasset
Autres œuvres de Maalouf
Romans
Maalouf, A. (1986). Leon l’Africain. Paris: Lattès.
(1988). Samarcande. Paris: Lattès.
(1991). Les Jardins de lumière. Paris: Lattès.
(1992). Le Premier Siècle après Béatrice. Paris: Grasset.
(1993). Le Rocher de Tanios. Paris: Grasset.
(1996). Les Echelles du Levant. Paris: Grasset.
(2000). Le Périple de Baldassare. Paris: Grasset.
(2004). Origines. Paris: Grasset.
(2012). Les Désorientés. Paris: Grasset.
(2020). Nos frères inattendus. Paris: Grasset.
Essais
Maalouf, A. (1983). Les Croisades vues par les Arabes. Paris: Lattès.
(1998). Les Identités meurtrières. Paris: Grasset.
(2009). Le Dérèglement du monde. Paris: Grasset.
(2016). Un fauteuil sur la Seine: Quatre siècle d’histoire de France. Paris: Grasset.
(2023). Le Labyrinthe des égarés. L’Occident et ses adversaires. Paris: Grasset.
Livrets musicaux
Maalouf, A. (2001). L’Amour de loin. Paris: Grasset.
(2002). Quatre instants. Paris: Grasset.
(2004). Adriana Mater. Paris: Grasset.
(2006). La Passion de Simone. Vienne.
(2010). Emilie. Lyon.
Discours
Malouf, A. (2014). Discours de réception de l’Académie Française. Paris: Grasset.
(2016). Un automne à Paris, chanson, avec Louane et Ibrahim Maalouf.
Préfaces
Maalouf, A. (1981). Pour une éducation bilingue: Guide de survie à l’usage des petits européens, Anna Lietti. Paris: Payot.
(1992). De la divination. Cicéron. Paris: Les Belles Lettres.
(1993). Le Prophète. Khalil Gibran. Paris: Le Livre de Poche.
(2007). La Batare d’Istanbul, Elif Shafak. (ISBN 978-2-264-04740-3)
Ouvrages de critique et de théorie littéraire
1-Ammar, A. B. (2014). De «lieux de mémoire» à «lugares de la memoria»: une étude interculturelle des «lieux de mémoire» de Pierre Nora sur leur conceptualisation, leur réception en France et leur adaptation en Espagne. Université de Gand. Mémoire de maîtrise.
2-Bourdieu, P. (1986). L’illusion biographique, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 62-63.
3-Braudel, F. (1979). Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme. XVè-XVIIIème siècle. Paris: Armand Colin.
4-Certeau, de M. (1975). L’Ecriture de l’histoire. Paris: Gallimard.
5-Corbin, A. (1988). Les lieux de mémoire, t. II, La nation by Pierre Nora.”Dans: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 43 (1), 125 – 133.
6-Delva, S. (2017). Les Lieux de mémoire de Pierre Nora et les Deutsche Erinnerungsorte Une étude comparative. Université Gent.
7-De Maistre, J. (1829). Considérations sur la France. Lyon: Rusand.
8-Dosse, F, (1997). L’histoire en miettes. Des «Annales» à la nouvelle histoire. Paris: La Découverte.
9-Garcia, P. (2000). Les lieux de mémoire, une poétique de la mémoire? Dans: Espaces Temps, 74 (1), 122 – 142.
10-Habermas, J. (1987). Une manière de liquider les dommages. Les tendances apologétiques dans l’historiographie contemporaine allemande. Francfort.
11-Halbwachs, M. (1997). Mémoire collective et mémoire historique. Albin Michel.
12-Jaisson, M. (1999). Temps et espace chez Maurice Halbwachs (1925-1945). Dans: Revue d’histoire des sciences humaines, 1, 163 – 178.
13-Laurens, H. (2022). Le passé imposé. Paris: Fayard.
14-Le Febvre, H. (1953). Combats pour l’histoire. Paris: Armand Colin.
15-Lévi-Stauss, C. (1993). «Un autre regard», L’Homme, numéro 126-128.
16-Nora, P. (1984). Les lieux de mémoire. Tome 1, La République. Sciences Po University Press. Numéro spécial: Étrangers, Immigrés, Français. pp. 180-183
17-La mémoire collective Dans: Le Goff, J. (éd.): La nouvelle histoire, 389 – 401. Bruxelles: Complexe. (1988).
18-Lieux de mémoire III. Les France. Paris: Gallimard. (1992).
19- La notion de ‘lieu de mémoire’ est-elle exportable? Dans: Den Boer, P. & W. Frijhoff (éds.): Lieux de mémoire et identités nationales, 3 – 10. Amsterdam: Amsterdam University Press. (1993)
20-Petitier, P. (1989). Les Lieux de mémoire, sous la direction de P. Nora.”Dans: Romantisme, 63, 103 – 110.
21-Ricoeur, P. (2000). La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil.
22-Schrader, F. E. (1994). Comment une histoire nationale est-elle possible? Dans: Genèses, 14, 153 – 163.
23-Todorov, T. (1995). Les abus de la mémoire. Paris: Arléa.
24-Valensi, L. (1995). Histoire nationale, histoire monumentale. Les Lieux de mémoire. Dans: Annales. Histoire, Sciences Sociales, 50, 1271 – 1277.
25-Veyne, P. (1978). Comment on écrit l’histoire. Paris: Seuil.
26-Willaime, J-P. (1988). De la sacralisation de la France. Lieux de mémoire et imaginaire national. Dans: Archives de sciences sociales des religions, 66 (1), 125 – 145.
27-Wood, N. (1994). “Memory’s Remains: Les lieux de mémoire.” Dans: History and Memory, 6 (1), 123 – 149.
Sites électroniques
28-Astruc, N. (2020). Amin Maalouf: L’espoir dans la tempête. La Source: forum de la diversité.
29-Maalouf, A. (2011). Amin Maalouf se découvre-t-il une vocation d’historien? 3 août 2011.
30-Amin Maalouf, architecte des histoires d’identité et d’exil. A LA UNE/ CULTURE/LITTERATURE. 8 février (2025).
[1]-Titulaire d’un Doctorat en Littérature contemporaine francophone de l’Université Saint- Esprit-Kaslik. Elle est professeure de Littérature à la faculté des lettres et des Sciences Humaines à la section I à l’Université Libanaise et à Lebanese International University (LIU), Email: marielinemanassa@gmail.com
حاصلة على دكتوراه في الأدب الفرنكوفوني المعاصر من جامعة الروح القدس – الكسليك. وهي أستاذة أدب في كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة – القسم الأول، وفي الجامعة اللبنانية الدوليّة.
[2] -We are probably witnessing the end of western civiliza tion; that in another 50 years yellow and black men would take over civilization and that, on the whole, we had all had a very good time of it for about 500 years.” cité par Rachel Bronson, Thicker than Oil: America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 72.
[3] . Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, Francfort, 1987, p. 163. L’article se lit en français dans Devant l’histoire, sous le titre: «Une manière de liquider les dommages. Les tendances apologétiques dans l’historiographie contemporaine allemande»